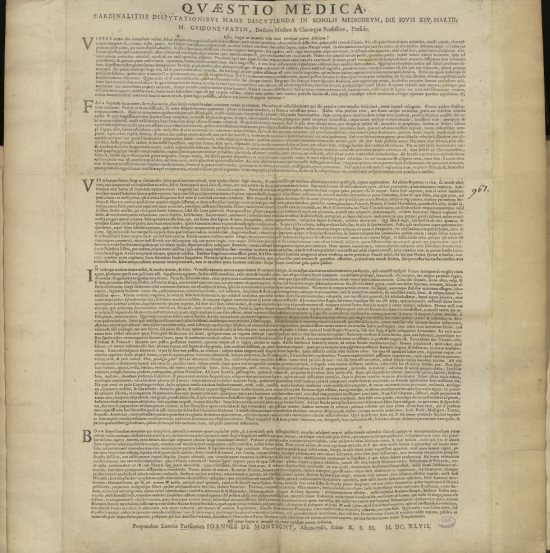Desmarets de Saint-Sorlin, Roland
Citer cette fiche
Imprimer cette fiche
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8228
(Consulté le 06/05/2024)
Beau-frère du médecin Jean Merlet et frère aîné de Jean Desmarets de Saint-Sorlin, [1] mais sans lien de parenté avec le théologien calviniste Samuel Desmarets, Rolandus Maresius [2] (Paris 1594-ibid. 1653) avait suivi quelque temps la profession d’avocat, puis l’avait abandonnée pour s’adonner entièrement à la culture des belles-lettres. Écrivain peu connu et érudit qui se complaisait dans la société d’hommes distingués, notamment du P. Denis Petau, son ancien maître, de Gilles Ménage, ou de Gabriel Naudé, Desmarets a laissé quelques ouvrages latins, dont :
- un recueil de 25 distiques intitulé Elogia Illustrium Gallorum, quorum imagines in tabellis depictæ cernuntur in porticu Ricelianum ædium [Éloges des illustres Français dont les portraits peints se voient dans la galerie du château de Richelieu] ; {a}
- le bref In Gabrielem Naudæum Epicedion [Épicède pour Gabriel Naudé] ; {b}
- deux livres d’Epistolarum philologicarum [Épîtres philologiques], {c} où sont imprimées les trois lettres latines non datées, qu’il a écrites à Guy Patin et que contient notre édition.
- Sans lieu, 1636, in‑4o de 5 pages ; v. note [30], lettre 237, pour la ville et le château de Richelieu, dans le Haut-Poitou.
- 1653, v. note [1], lettre 325.
- Paris, 1655, v. notre bibliographie.
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Une thèse cardinale de Guy Patin :
« La Sobriété » (1647)
Codes couleur
Citer cet écrit
Imprimer cet écrit
Imprimer cet écrit avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8223
(Consulté le 06/05/2024)
Quæstio medica,
cardinalitis disputationibus mane discutienda in Scholis medicorum die Jovis xiv. Martii,
M. Guidone Patin, Doctore Medico, et Chirurgiæ Professore, Præside.
Estne longæ ac iucundæ vitæ tuta certaque Sobrietas ? [1][1][2]
Article i [Texte latin]
« Tous veulent vivre longtemps et agréablement ; mais pour y parvenir, presque tous sont affligés de myopie quant à ce qui procure une telle existence ; à tel point qu’il n’y a pas de question plus ardue que la science de vivre correctement. Presque personne ne vit bien et longtemps, hormis tous ceux qui veillent à appliquer correctement et longtemps un petit nombre de moyens assurant l’intégrité de tout un chacun. L’isthme de cette vie est vraiment très court, et comme le passage d’une ombre ; [2][3] mais plus souvent par notre faute que par celle de la Nature. Elle exige légitimement son dû, que ce soit soit tôt pour certains, ou tard pour d’autres. Elle est tantôt bienveillante, tantôt sévère : à l’instar du juge décidant de châtier d’abord ceux dont la faute a été la plus vénielle, elle condamne à une mort prématurée quantité de parfaits innocents, avant qu’ils n’aient commencé à vivre, au moment même où ils s’y disposaient, [3][4] sans rien leur permettre que de voir le jour ; elle interrompt la course d’autres en la fleur de leur âge ; elle mène le reste jusqu’à l’extrême vieillesse, mais, si long soit-il, leur parcours ne compte que peu d’années. Il a certes duré tant qu’il a pu, mais à nos yeux, il paraît s’être écoulé rapidement, car il s’use en égarements : [4][5] on le passe à ne rien faire, à faire autre chose, ou à mal faire. [5][6] Chacun répugne distribuer ses biens à autrui, quand la seule avarice honorable est celle du temps dont on dispose, mais nous gaspillons notre vie presque entière à faire n’importe quoi ; et quand vient la fin, après l’avoir ainsi dissipée, nous voilà qui devenons prévoyants, nous méditons sur la fraction qui nous en reste et déplorons sa brièveté. Elle sera suffisamment longue si elle est tout entière bien employée, [6] si nous en avons confié plus que des miettes à de salubres conseils. Comment se fait-il que nous passions le plus clair du temps à trahir notre propre salut, et à nous ruiner la santé par la pire sorte de nourriture ? À la fois dociles et pervers, nous nous poussons mutuellement au vice ; [7] et dans cette folie qui nous est commune, nous nous perdons à suivre, sur l’exemple des autres et à la manière du bétail, les premiers à s’être engagés sur le mauvais chemin, car c’est par où on veut aller, et non par où il faut aller qu’il convient de passer. [8][7] Voilà pourquoi peu de gens jouissent d’une longue vie, et bien moins encore d’une agréable vie. En sont fort éloignés ceux dont les maladies sont les assidues compagnes, car ils traînent une âme misérable qui tire derrière elle, jour après jour, souffrance après souffrance. Nous ne savons compter le nombre de ceux pour qui la félicité n’est que déguisement, qui trouvent nécessaire de sembler heureux au milieu des chagrins qui leur rongent le cœur. [9] Si on ouvrait les cœurs des tyrans, que de coups et de déchirures ne pourrait-on y voir ! Comme le corps par le fouet, l’esprit est dilacéré par la violence, la débauche, le désir de vengeance, les mauvais desseins. [10][8] Que de gens sont profondément malheureux pour la seule raison qu’ils craignent constamment de le devenir un jour ! À ce troupeau appartiennent ceux qui, exhalant tous les parfums d’Arabie, cousus d’or et d’argent, aussi décorés que l’extérieur de leurs murailles, [11][9] ne possèdent pas, à l’intérieur, la moindre once d’esprit sain. Tout un chacun ne trouve-t-il pas sage de dire heureux ceux qu’une agitation stérile tient en haleine, et ceux qu’absorbe une molle tranquillité, comme sur une mer d’huile, ou le loisir de faire ce qu’ils veulent ? La paix du corps et de l’esprit procure certainement une riante et excellente raison de vivre. Pourtant, quant aux biens du corps, la condition d’une tête de bétail ne se mesure-t-elle pas autrement mieux que celle d’un homme ? Dénuée et privée de raison, la vie des mouches et des vers est un bien, [12] mais celle de l’homme en est un s’il est en bonne santé et s’il pense droit. De fait, nous ne vivons vraiment et agréablement que si, exempts de tout désagrément du corps, nous travaillons à acquérir une bonne intelligence : malade est celui qui, jouissant d’un corps solide, est moins valide d’esprit. La santé est donc parfaite seulement quand ces deux parties sont à égalité, comme deux chevaux attelés à un char, sans qu’aucun ne s’appuie sur l’autre. Bien que la possession d’un si grand bien soit aussi rare que fugace, a-t-on tort de juger qu’une vie sans but est brève et ingrate ? »
Article ii [Texte latin]
« Nous courons pour fuir le destin, mais nul ne lui échappe, bien qu’il saisisse les uns tôt, les autres plus tard. Personne ne s’oppose impunément à lui : même ceux qui ont soumis les peuples à grand fracas lui tendent à regret le cou. [10] Certes, nous naissons tous de manière semblable, mais nous affrontons la mort de façon dissemblable, tout autant qu’à des âges inégaux. Beaucoup s’en vont avant la maturité, mais peu hors des exigences de la nature. Nul ne vit au delà du temps imparti, [13][11] et nul n’a jamais, par faveur ou par artifice, retardé le terme fixé pour chacun. Esculape [12] en personne ne saurait pas même y ajouter un instant, sans parler d’un chimiste [13] vendeur de fumée avec son or potable (comptable) [14][14] Souvent pourtant les conseils d’un sage médecin retarderont la date du trépas, que hâte une erreur de régime. À qui veut jouir d’une très longue durée de vie, il faut un sang pur et un corps irrigué par une abondante chaleur native, bien tempérée par l’humide radical. [15][15] La riche conjonction de ces deux qualités ne garantit pourtant pas à tout homme de vivre extrêmement longtemps, bien qu’il lui appartienne entièrement d’empêcher cette salutaire humeur de se corrompre profondément ou de s’engorger. Parce qu’elle est le moindre de nos soucis, la mort s’avance en général à pas de loup et avant l’heure, elle est partout en embuscade, tant pour les jeunes qui quittent le port que pour les vieillards qui s’en rapprochent. Maints malheurs nous entourent en permanence, ils œuvrent pour elle et nous entraînent de-ci de-là, comme ballottés par les flots que secouent les ouragans du grand large. [16][16] La débilité innée n’y prend pas une part négligeable, car elle nous expose à toutes sortes d’accidents : le froid, la chaleur, le labeur nous offensent ; en revanche, l’inaction et l’oisiveté suffisent à nous anéantir. Nous ne tolérons pas tous les climats ; la faim et la soif nous menacent si nous n’y remédions pas promptement ; le défaut comme l’excès de boisson et de nourriture nous brisent ; le goût, l’odorat, l’éveil, le sommeil, etc., sont indispensables à la vie, mais il n’est pas rare qu’ils soient mortifères. Il est surprenant que l’homme supporte une telle accumulation de dommages, quand il peine à n’en supporter qu’un à la fois. Il s’agit de nous en tirer sains et saufs quand la tempérance ne nous a pas préservés en nous modérant ; mais qui jamais n’est séduit par les doux attraits de la volupté, [17][17] ou anéanti par un quelconque accident ? Un animal venimeux tue sur l’instant certains imprudents ; cet autre succombe, imprégné de vinaigre italien ; [18][18][19] ceux-ci sont emportés par la mer, ceux-là par la foudre ou par un éboulement ; des quantités meurent à la guerre, et ceux qui ont survécu aux batailles sont écrasés par leur maison, brûlés dans les incendies. Le jour et le lieu de la mort, qui est certaine, sont à ce point incertains que, pour l’éviter à toute heure, l’homme n’est jamais suffisamment sur ses gardes. À tant de causes si diverses de mort prématurée, s’ajoutent les maladies : bien plus fréquentes, elles sont dans la plupart des cas engendrées par nos propres vices. Quand par hasard elles ne nous ont pas tués, elles sont suivies d’affaiblissement et diminuent le nombre des années qui nous restent. Si une d’elles nous affecte intimement, nous courons sottement vers d’autres gens, chez qui on promet à chacun la vie pour de l’argent, [19][20][21] et où, la plupart du temps, c’est la mort qu’on achète à grand prix : les étiquettes des boîtes donnent le nom de remèdes, mais elles contiennent des poisons, ou peut-être souvent rien d’autre que de la crotte de souris. Quand la bourse qu’ils ont vidée chez ceux-là n’a pas atténué leur mal, vous verrez les malades caresser les genoux des médecins, très sérieusement résolus à dépenser tous leurs biens pour vivre et être soustraits au gibet de la mort, puis s’exposer sans relâche à de nouvelles souffrances [20][22] Une seule chaîne nous tient ici-bas liés les uns aux autres, c’est l’amour de la vie. [21] Pourtant, si la vie n’est rien d’autre qu’un mot, c’est en revanche et en réalité un pénible labeur, ou une lente mort, elle a bien plus le goût de l’aloès [23] que du miel. L’homme ne dispose-t-il vraiment de rien qui puisse balayer ces désagréments ? Nous en détournerions certes une grande partie et ne mendierions pas, par de honteux vœux pieux, une prolongation de quelques années, ou même quelques jours, si nous nous appliquions à prévenir les maladies, tout autant qu’à terrasser celles qui nous accablent ; mais une telle négligence de la santé nous possède que nous ne savons rien faire d’autre que la ruiner. Tu peineras à recouvrer celle que tu as perdue, même en ajoutant de l’argent à tes prières, mais il existe un chemin aisé et fort court pour conserver celle dont tu jouis à présent, pourvu que tu t’y engages sous de bons auspices. Toute l’affaire se résume au point qui suit. »
Article iii [Texte latin]
« Tu veux faire ton bonheur : sois frugal et sobre. Apprends que la plus grande maxime de l’art est de manger quand tu as faim. Fuis la diversité des vins [24] et les mets variés qui stimulent et flattent l’appétit, comme par enchantement. [22][25] Emploie le boire et le manger comme le viatique de ton existence, tout comme de ton trépas, et non pas comme de quoi remplir un récipient. Que ta main soit parcimonieuse, pour ne prendre que ce qui est suffisant, et que la modération des aliments te rende plus heureux que leur consommation. Le plus grand des biens est d’être privé de nourriture, au plus près du minimum indispensable. La plus salubre façon de vivre est de se conformer à la nature : elle demande peu, mais ce que désire l’opinion est sans limites. [23][26] C’est folie d’en désirer tant quand tu possèdes si peu. [24][27] Songe à quel point ton corps est petit : bien que l’intelligence le rende plus grand, elle n’en fera pas un géant. Nous avons souvent l’appétit plus gros que le ventre. [25] Du pain avec du sel l’apaisera quand il aboie, une collation l’aura calmé quand il gronde ; [26] s’il est bien éduqué, il ne sera pas un fâcheux trouble-fête, [27][28] un rien le fera taire, si tu lui donnes ce que tu dois, et non ce que tu peux, sinon il réclame tout ; s’il obéit mal, il te faut devenir sa marâtre, [28] car presque la seule faute à commettre est d’être clément à son égard. Ceci est l’unique et plus éminent précepte des médecins, qui te permettra de te passer d’eux : pour son maître, une bouche qui supporte d’être gouvernée vaut cent médecins. [29][29] Qu’on change une seule virgule à cette sentence quasi divine, et advient, finalement et dans tout son éclat, cette vieillesse que nul n’appelle de ses vœux, même malveillants : celle que proclament repousser les menteurs et les crédules, tout autant que les souffleurs chimistes, avec leurs tout-puissants artifices, leurs panacées, [30] leurs pantomimes, et autres herbes hermétiques, huiles incombustibles ou liqueurs énergiques. [30][31] Jamais le moly d’Homère, [32] le théômbrôtion [33] de Pline ou le dôdécathéos [31][34][35] n’ont égalé la puissance du précepte que j’ai énoncé : les maladies n’auront aucune prise sur celui qui ne se sera rien autorisé par delà ce que recommande la sobriété. Il n’est nul besoin d’avaler toutes ces pilules, de laper tous ces sirops et de vider presque toutes les pharmacies pour que la dégoûtante saburre des humeurs, fille de la gloutonnerie et mère des maladies, soit évacuée par le kermès de Cnide, [36] l’ellébore, [37] la scammonée, [38] l’antimoine (monstre diabolique parmi les remèdes) [32][39] et autres médicaments insensés, exotiques et souvent frelatés ; nous devrions plutôt en purger nos ordonnances, que les employer à nous purger le corps sans péril. [40] Ces remèdes sont propres aux intempérants qui, sachant bien qu’on troue les draps de lin aussitôt qu’on les lave avec du savon et du salpêtre, pensent qu’en avalant souvent des cathartiques [41] ils se nettoient promptement le ventre. Qui vit sobrement, sauf peut-être si sa naissance l’y a autrement destiné et si certaines de ses parties sont mal conformées, sera à l’abri de toute maladie et de toute corruption des humeurs, tant et si bien que jamais il ne manquera de remèdes. Si un coup le blesse, sa plaie n’ulcérera pas, mais cicatrisera toute seule et rapidement ; la peste elle-même, la reine des maladies, quel que puisse être son acharnement à tuer, respectera son excellence, comme elle s’inclina jadis à Athènes devant la tempérance et la quasi-divinité de Socrate. [33][42][43][44] Il va de soi que la vivacité de l’air, du lieu, du froid, du chaud et des causes externes s’affaiblit profondément quand ce que mangent et boivent les habitants ne procure aucune aide à l’ennemi. Mieux encore, sous l’empire d’un état paisible du corps, ce qui charme les sens procure un plus grand plaisir et paraît plus délicieux. Une mer calme est propice à l’éclosion des alcyons, [45] comme une bonne santé l’est à celle de la volupté. [34] Bien plus encore que le corps, l’âme tire grand profit d’une alimentation fort parcimonieuse. Une intelligence acérée fuit un gros ventre, et s’allie plus volontiers à un corps un peu mieux proportionné. Telle une étoile dans un ciel clair, l’esprit brille dans un corps svelte ; moins aussi il a de connivence avec le corps, moins il est habité par le vice. Un cœur paisible et maître de lui-même n’est pas troublé par la colère, n’agite pas de querelles, ne trame pas de révoltes ; il ne brûle pas d’assouvir ses envies ; la nourriture qu’il supporte n’est pesante ni pour son corps ni pour ses biens ; les voluptés ne le consument pas de feux dont il aurait à rougir. [35] Celui qui goûte à peine aux banquets sait imposer silence à son estomac en révolte. C’est à du pain, et non à des aliments sophistiqués, que songe une faim vraiment amie de la chasteté. [36] Les anachorètes chrétiens [46] (comme furent les Esséniens [47] en Palestine, peuple éternel chez qui pourtant nul ne naît) [37][48] veillaient jadis à la pureté de leurs mœurs par une alimentation simple, pour demeurer en bonne santé jusqu’à même atteindre l’âge de cent ans : le pain ou la datte du palmier, qui leur fournissait aussi de quoi se vêtir, composait leurs repas ; ils considéraient comme des gourmandises ce qui se mange chaud ou cuit ; ils buvaient de l’eau fraîche tirée de la source la plus proche ; ils se tenaient aussi éloignés du vin que des villes. Par la grâce de Dieu, les tout premiers tenants de cette frugalité et leurs successeurs vivaient quatre-vingt-dix ans, dans l’ignorance de la viande comme de la fourberie, mais satisfaits de ce que la Nature leur concédait d’elle-même ; nul en effet n’était encore contraint de répandre son propre sang pour ceux qui en sont altérés. [38][49] Avec la si rigoureuse et persévérante abstinence qui produisait ces anciens, dont les entrailles étaient presque d’érable et d’airain, nous irions vers le déclin d’un monde, où notre âge décrépit voudrait être traité plus mollement : [39] nous aimons tant notre intempérance que nous préférons l’excuser que la secouer, et c’est ainsi que le gosier tuerait plus de gens que le glaive. » [40]
Article iv [Texte latin]
« Dans la manière de se nourrir, qui ne sait tenir le juste milieu est en proie à la maladie et au vice. De même qu’une éducation relâchée ruine profondément les ressources de l’esprit et du corps, une frugalité trop stricte diminue l’entrain de l’un comme de l’autre : ainsi, pour apaiser leur faim, quelques-uns mènent une pénible vie de mulet [41][50] et se glorifient de ne pas dépenser un sou pour se nourrir. Priser la crasse, détester les plus simples raffinements, se nourrir de mets aussi dégoûtants que répugnants : voilà le propre de celui qui n’a jamais sacrifié aux Grâces. [42][51][52] Poursuivre avec ardeur les voluptés est luxure, mais fuir ce que l’usage a consacré et qui ne coûte guère est folie. Exigeons de nous la frugalité et non la mortification. [43] Que ta table soit belle mais chiche, et qu’un ami en soit le principal condiment : avec lui tu irrigueras et épanouiras l’amitié, qui est moins convive du ventre que de l’esprit. [44] Nourris-toi de pain : celui du vulgaire si tu n’en as pas d’autre, celui des maîtres si tu peux te le permettre. [45][53][54] Quant aux aliments que tu sers à ta table, qu’ils ne soient pas, s’il te plaît, ceux que prise l’opinion des hommes, [23] qu’artifice ou volupté a corrompue, mais ceux qui sont bien plus amis de ton estomac que de ton palais : ils ne manqueront pas d’agrément, pourvu que les condiments spartiates [55] n’y fassent pas défaut, bien plus salubres que ceux qu’on fait venir des Indes. [46] Qui a faim ne méprise rien, l’appétit n’est pas prétentieux, il te recommandera tout ce que tu devras prendre. Tu veux être mieux disposé de corps et d’esprit, tu veux garder raison et échapper à tout furieux mélange : [22] bois donc de l’eau ! [56] C’est l’aliment de la sagesse : l’eau nourrit, elle aide la digestion, elle vivifie les sens, aiguise le jugement, clarifie l’esprit et le dispose à l’étude ; si bien qu’elle est ce qu’il y a de meilleur pour les animaux, et même pour tous les êtres vivants, y compris pour les humains de quelque âge, sexe ou tempérament qu’ils soient. Le vin est le ciment d’un festin, le lait de l’amour charnel, la semence de la gaieté ; rien n’est plus agréable, la Nature n’a rien donné de meilleur aux hommes ; [47][57][58][59] on en boit par plaisir, et non par nécessité, c’est pourtant un fourbe lutteur, qui s’en prend d’abord au foie, [60] ensuite à la tête et aux pieds ; [48][61][62][63] sa couleur est rutilante, mais aussitôt il mord comme un serpent, et tel le basilic, [64] il répand son venin par tout le corps. [49][65] Les rois, tout autant que les autres hommes, font mieux de n’en pas abuser, s’ils doivent rester maîtres d’eux-mêmes. Certains pensent qu’il exalte l’esprit : sobres, ils sont timides et comme figés, mais s’ils viennent à trinquer, les voilà semblables à des statues de Jupiter cramoisi, [66][67] ils s’évaporent à la manière de l’encens que la chaleur a saisi. [50][68] Le vin pur [69] est le plus scélérat, plus il est fort et plus il est nocif : c’est un miel pour le palais, et un fiel pour la tête ; il a bon goût, il chauffe le ventre, il enfume la tête, mais il finit par attaquer à la gorge ceux qui l’aiment excessivement. [51][70][71] Alors que les plus robustes peinent à le supporter, il est étonnant de voir que certains médecins bafouent ce qu’autorise la Faculté, tant par ignorance que par impudence : ça n’est pas assez qu’à lui tout seul il fasse du tort aux malades, ils le leur font boire imprégné de vénéneux antimoine ; [72] et, Dieu me pardonne, aux remèdes de ceux que la puissance du destin a épargnés, ils mêlent deux poisons, comme si leur combinaison les rendait secourables ; [73] quelles mœurs, quelle époque ! [52][74] La jeune fille qui quittera les nymphes pour l’amour de Bacchus [75] te donne la marque certaine d’une virginité qui va s’envoler sous peu ; [53] et celle qui a abandonné la fleur de sa jeunesse au mari [54][76] est d’autant moins chaste qu’elle s’adonne fort au vin. Même dilué, tu n’en donneras ni aux nourrissons ni aux enfants. À mesure qu’ils avancent en âge, les vieillards le mouillent de plus en plus, et ne boivent plus que de l’eau quand ils approchent de la fin. Il intoxique agréablement les adolescents et les jeunes hommes ; mais quand ils en boivent trop libéralement, leurs entrailles, comme enflammées par les torches qu’elles ont approchées, bouillonnent du feu volcanique de l’amour ; alors, le délicieux méfait semble agréable, les yeux, qui expriment et perçoivent le désir, s’égarent, prêts à s’envoler vers toutes sortes de lascivetés, les mains les plus hardies enfreignent toutes les lois de la pudeur ; [55] alors, quand la furie incendie le foie, [77] la passion se rue à sa guise ; et ils ne font jamais cela furtivement, mais ouvertement, et nulle nuit n’est assez sombre pour les cacher ; [78] le pas qui mène de Liber pater [79] à Vénus, [80] qui brise les reins, [81] est si précipité [82] qu’il faut les dompter en leur interdisant purement et simplement le vin pour châtiment de leur gloutonnerie. [56] Tout le monde observe-t-il vraiment aujourd’hui la loi du régime alimentaire soigneux que les princes des médecins [57][83][84] ont ratifié ? Chacun cherche-t-il déjà à régler sa propre vie ? La sobriété est rare, et une santé solide et constante l’est tout autant, quand une telle cohorte de maladies s’est abattue sur nous parce que ce siècle ne s’est ingénié qu’à faire croître le luxe. [58] Devant un tel étalage de mets, s’il en est un qui ne se laisse emporter au-delà des barrières du strict nécessaire, celui-là est tout à fait remarquable ! [59][85] Le monde entier vénère deux divinités, Edulia et Potina : [86] partout rôdent à présent d’innombrables goinfres, dont le corps est noyé dans la graisse, et l’esprit perdu dans la maigreur. [60] Semblables à l’âne marin, [87] ils ont le cœur dans le ventre : [61][88][89] leurs mains saisissent tout ce qui s’avale, le plus grand de leurs soucis est ce qu’ils mangeront, ce qu’ils boiront, ils rêvent même de nourriture ; ils dévorent comme s’ils avaient un loup dans la panse ; l’indigestion les brise ; repus, ils sont près d’éclater ; ils cherchent des ragoûts [90] pour réveiller la paresse de leur estomac écœuré ; [62] et quand leur bouche est lasse, ils l’inciteraient à mordre encore. D’autres sombrent dans une si profonde hébétude qu’ils sont incapables de se rendre eux-mêmes compte qu’ils mangent : vois comme ils mâchonnent tout d’une dent dédaigneuse, et comment, rebelle, la nourriture s’accumule entre leurs molaires. [63][91] Ceux-là ont besoin d’un cuisinier qui déploie toute son adresse, afin que leur appétit émoussé éprouve quelque sensation de faim capable de leur faire passer au travers du gosier un aliment que la ruse a maquillé ; [64] et ce qu’elle y aura fait entrer sera facilement rendu, non sans quelque arrière-goût de bile. Le ventre ne cause que des souffrances, il est le pire organe du corps : la plus grande partie des mortels vit pour le satisfaire, mais en périt misérablement. Ô monstruosités de la gloutonnerie, hélas ! [65][92] Pour s’alimenter, leur désert suffit aux bêtes sauvages, et une seule forêt, à un tout un troupeau d’éléphants ; mais l’homme se gave de la terre et de la mer ; et pire, il ne se sent pas bien tant qu’il n’a pas accaparé la terre entière pour combler ses délices. On a connu un homme qui, à lui seul, a dépensé en un unique repas le revenu de < trois > provinces, et à qui une table ne semblait pas assez riche s’il n’y couvait pas du regard les animaux venus de tous les pays, pour n’en choisir que les meilleurs morceaux ; à tel point qu’il ne laisse ces bêtes en paix que s’il s’en est dégoûté. [66] La viande de bœuf, d’agneau, de mouton, de chevreau, de veau ne flatte pas le goût si elle n’est arrosée de sauce exotique. [67][93] On traîne sur les tables lièvre, daim, chevreuil, sanglier, cerf et tous les animaux qui sillonnent champs et forêts ; mais aussi tout ce qui vole dans le ciel, oiseaux de Scythie, [94] francolin d’Ionie, perdrix, pintades, [95] dindes, becfigues d’Afrique, bécasses, qu’accompagne très souvent le foie d’oie blanche engraissé par les figues. [68][96][97] Les eaux sont aussi invitées à nous fournir à profusion les poissons qu’elles cachent en leur sein : brochet, rouget-barbet, surmulet, turbot [98] plus que césarien, [69][99] esturgeon qui n’est réservé qu’à peu de gens ; [70][100][101][102] et d’autres, dont le prix tient moins à leur goût qu’à la difficulté de se les procurer, doivent se déposséder de leur chair dans nos ventres pleins. Le naufrage cherche aussi à engloutir les huîtres, qui sont les truffes de la mer ; [71][103][104] et encore ne plaisent-elles que venant du Lucrin. [72][105][106][107] Les champignons suspects ne font pas non plus défaut dans les dîners douteux : on les croit venus des prés, mais à tort car voilà un voluptueux poison qui vous tord les tripes, et que même les rudes intestins des moissonneurs sont incapables de supporter. [73][108][109] Pour ne rien omettre des sacrifices qu’on consent à la gourmandise, une infinité de fruits concluent ces somptueux festins : crus, cuits, confits, dénaturés par quantité de sucre ; [110] pommes adoucies au miel, [111] pain d’épices, friandises miellées, et autres vétilles pesantes pour l’estomac et tout à fait indigestes, engendrent un fâcheux amas de bile [112] et une abondance inouïe d’excréments. La débauche de boisson [113] n’est pas moins effrénée que celle de nourriture. Le froid se conserve pendant les chaleurs estivales et on obtient que dans les mois où elle fond la neige, qui est l’écume des eaux du ciel, reste glacée ; et l’ingéniosité du vice est allée jusqu’à découvrir qu’ainsi l’eau enivre aussi ; mais la plupart des hommes, séduits par l’ébriété, ne conçoivent pas d’autre plaisir qu’elle dans la vie. [74][114][115][116] Peu s’en abstiennent, et on se moquerait presque d’eux ; beaucoup sont des piliers de cabaret et des rameurs de coupes, [117] comme s’ils étaient nés pour gaspiller les vins. Très stupidement, pires que bétail, ils se poussent les uns les autres à boire. Ces hommes, ou plutôt ces amphores, n’appellent-ils pas perdre leur vie, [75] quand, dans de feintes réjouissances, ils passent souvent des jours et des nuits à boire, ajoutant une nouvelle ivresse à celle de la veille, pour, comme ils disent, dissiper la crapule par la crapule ? [76] Cela aide d’avoir la folie drôle et de délirer en plaisantant. [77] Pour ces veillées de Bacchus, par serment de la main droite, ils engagent leur parole que nul ne s’en ira ni ne déposera les étendards, pour tenir et lutter jusqu’à la dernière goutte. [78] Dans ce combat dionysiaque, on dispute à qui boira le plus et on loue pour leur crime ceux qui parviennent à l’emporter ; [79] les derniers de tous à devenir soûls, ceux qui se montrent capables d’ingurgiter le plus de vin, emportent la palme, et la seule chose qui les attriste est d’avoir été vaincus par les tonneaux eux-mêmes. Mais quelle débauche barbare ! quel amour monstrueux et presque incroyable de l’ébriété ! Même les peuples qui n’ont ni vignes ni vin s’enivrent : Indiens, [118] Perses, [119] Messagètes, [80][120] Tartares, [121] Chinois, [122] Américains [123] n’en ont point, mais ils ont découvert certains genres nouveaux de boissons qui induisent l’ivresse ; à tel point que l’ébriété n’est à tenir pour inexistante où que ce soit dans le monde. Pourquoi l’homme, qui est un être sacré et la représentation de Dieu sur Terre, [81][124] se tue-t-il donc à tant boire ? Et souvent étouffé par l’angine de vin, [82][125][126] il part au tombeau, après avoir été tant de fois englouti par d’immenses flots de vin. Il n’y a vraiment rien de bon dans le vin, à part la vérité, car il est une douce torture qui permet de la découvrir. [83] Sinon, il est une source de crimes et de toutes sortes de maux, et le père de quantité de maladies qui, pour la plupart, ont la mort pour seul remède, si l’abstinence n’y a pourvu dès le début. »
Article v [Texte latin]
« Tout va donc bien pour ceux qui placent leurs intérêts hors du gosier, ce très funeste fléau du genre humain : [127] affranchis de la soumission à la pernicieuse gloutonnerie, ils n’accordent à leur corps rien de plus que ce qui suffit à protéger leur santé. La punition suit bien sûr de près le péché d’intempérance : [84] enchaînement continu de maladies, ou mort aussi prématurée que méritée. Ainsi, en récompense de leur frugalité, les gens sobres récoltent-ils une abondante moisson, et y recueillent-ils une véritable vigueur : leur esprit et leur corps montrent qu’ils ont préféré une longue et heureuse santé à la volupté que procurent les délices de la nourriture et de la boisson, laquelle est brève, de funeste issue et sœur de la souffrance. Sur leur visage comme en toute l’habitude de leur corps, reluisent ce teint remarquable, et cette couleur verdoyante et inconnue du vieillard ; [85] leur esprit lui-même est heureux et gai, et semble déverser sa vivacité dans un corps qui jouit pleinement de toutes ses fonctions vitales, sans place pour le chagrin ni pour la souffrance. Tout danger de tomber malades leur est étranger : même si leur hérédité, leur faible constitution ou leur précédente manière de vivre les y a prédisposés, ils y échapperont, car s’y opposeront la salubrité de leurs organes et la conformité de leur régime alimentaire à la règle. [86][128] Pas même la vieillesse, elle qui désagrège tout, ne parvient à les briser, [87][129] et parvenus au port de leurs jours, ils apparaissent parfaitement gaillards : [88] leurs yeux jouissent de la pleine lumière, [130] leurs pieds ne traînent pas sur le sol ; leur ouïe est nette et perçante, leurs dents sont blanches et inébranlables, leur voix est éclatante, et leur corps solide et plein de bon suc ; leurs blancs cheveux contrastent avec leur teint vermeil ; leur vigueur dément leur âge ; une vieillesse fort avancée n’éparpille pas la ténacité de leur mémoire ; un sang refroidi n’émousse pas l’acuité de leur intelligence, [131] leur main ne tremble pas et tient fermement la plume sans s’égarer hors de la droite ligne ; [89][132] ils miment la jeunesse et ne diffèrent d’elle que par leur sagesse. La conservation d’une bonne santé ne requiert pas grand-chose : la nature se contente de peu, [90][133][134] le pain et l’eau satisfont le désir du sage ; et si tu y ajoutes un petit rien, il pourra disputer du bonheur avec Jupiter. [91][135][136] Polyphagie et polyposie sont, crois-moi, affaire d’habitude, et non de nature. [92][137] Qui consomme peu de vin, en le diluant beaucoup, [138] aime sa propre vie et se gratifie lui-même d’une infinité d’avantages ; mais une iliade de maux [93][139] immenses découle de son abus, en minant la substance qui produit la chaleur innée, [140] et en dissipant et engloutissant l’humide radical. Le vin est un douteux ami, un Protée [141] à deux têtes : aujourd’hui, il procure fort peu d’avantages, mais demain ses méfaits seront extrêmement pesants. Il rend la vie plus gaie et plus vaillante, mais plus courte. Il procure au corps ce que fait la chaux qu’on répand au pied d’un arbre, qui accélère certes la venue des fruits, mais tue l’arbre : ainsi en va-t-il du vin qui, par l’ardeur qu’il engendre, stimule les esprits et leurs facultés, mais qui en vérité hâte le trépas, [94] car il ouvre la porte à une infinité de maux que presque aucune massue d’Hercule [95][142][143] n’est capable d’abattre. Aucun émétique ne guérit l’apoplexie. [144][145] Nulle herbe de Phébus [146] ni nul amulette [147][148] ne vient à bout de l’épilepsie (qui n’est pas proprement la convulsion). [96][149] Nul sudorifique [150] ne guérit la paralysie, ni l’éphialte, qu’on dit mensongèrement être le fait de mauvais génies. [97][151] La saignée [152] et la consommation d’eau froide [153] sont les plus éminents remèdes du rhumatisme, [154] lequel vient d’une effusion des veines, phénomène presque inconnu des Anciens, mais qui est l’équivalent des synoques de Galien. [98][155] Rien ne soigne mieux l’angine que la saignée des veines jugulaires. [156][157] Dans les fièvres pestilentes, [158] pourprées et malignes, [159][160] aucun secours n’est à attendre du bézoard, [161] cette idole des sots, de la thériaque, [162] cette composition d’extravagance, [99] ou du mithridate, [163] cet infâme chaos d’herbes, masse informe et confuse d’une multitude de simples, qui sont ennemis de la chaleur innée par leur ferveur excessive, leur acrimonie ou leur nocivité ; non plus que de la confection d’alkermès [164] et d’hyacinthe, [165] du diamargariton, [166] ou d’autres chimères des Arabes ; [100][167][168] Les péripneumonies [169] ne rendent les armes devant aucun de leurs sirops ou de leurs béchiques, [170] dont il est inutile de donner les noms. La phtisie [171] n’est curable par aucun lait, pas même celui de femme. [172] Les aselles aquatiques n’ont aucun pouvoir contre l’asthme, et ceux qui les prescrivent sont pis que petits ânes. [101][173][174] Ni l’emploi des hydragogues [175] ni la paracentèse [176] ne suppriment l’hydropisie, [177] qui résulte d’une cause chaude, mais ne siégeant pas toujours dans le foie. La puissance ignée des diurétiques ne fait pas bouger, ne serait-ce que d’une ligne, un calcul des reins qui irrite le collet de l’uretère en provoquant d’atroces souffrances ; [178] pour celui de la vessie, [179] nul lithotritique [180] n’est capable de le dissoudre ni de le briser. La rhubarbe torréfiée [181] et les myrobolans [182] aggravent la dysenterie, [183] mais la phlébotomie [184] la supprime. Boire de l’eau froide atténue le flux hémorroïdaire. [185] La purgation [186] supprime chiragre [187] et podagre, qui sont les rejetons de maux < muets >. [102] Quand les sobres finiront par en venir là où tous ont à en venir, ils quitteront paisiblement le monde des vivants, pour sembler s’endormir et non pas mourir, en jouissant, en récompense de leur frugalité heureuse et bénie, de cette fameuse euthanasie [188] des vieux princes, que tant de gens ont vainement désirée. [103][189] À quoi bon en dire plus ? Nous conseillons de vivre dans la modération, non seulement pour notre propre bien, mais aussi et surtout pour celui de nos enfants : tant il est vrai que la sobriété, en bonne nourrice des hommes, accroît la vigueur de leur descendance ; car si on l’applique à la procréation, elle rend la semence saine et féconde, et l’utérus solide, et comble les heureux parents d’une belle et nombreuse progéniture ; et après qu’ils auront vécu très vieux et en bonne santé, ils vivront encore longtemps au travers de leurs enfants. Enfin, celui qui aura érigé la tempérance en principe de vie ne sera jamais incommodé d’aucune calamité ni d’aucune misère. [104][190]Une sobriété prudente et déterminée est donc la mère d’une longue et agréable vie.Question que Jean de Montigny, [105][191] natif d’Avranches, [192] a soumise en la 1647e année de la rédemption du salut humain. »
Dédicace [Texte latin]
« Au très noble et illustre M. Nicolas Le Bailleul, [106][193] président au Parlement de Paris et chancelier de la reine, [194] etc.Si la vertu impose de ne pouvoir porter un jugement sur soi-même, sauf à y être astreint, je ne puis vous prier (très illustre président) d’être le juste et impartial arbitre des avantages que procure une sobriété de vie observée en tout point. C’est elle qui a non seulement nourri, mais aussi accru et fait briller la gloire de la très noble famille des Le Bailleul ; celle dont a joui celui de vos ancêtres qui, au cours d’une bataille, à la tête des Bretons, fut désarçonné et presque saisi par les ennemis, mais remonta courageusement sur son cheval, ce qui lui a justement mérité les enseignes de Bretagne qui figurent sur vos armoiries. [107] Cela vous a été autorisé par les rois Henri le Grand [195] et Louis le Juste, [196] comme leurs prédécesseurs l’avaient fait pour votre très vigoureux père, dont la sobriété apparaît clairement, car nous ne doutons point de son mérite. [108][197][198] La tempérance est en effet la mère de toutes les autres vertus ou, pour parler comme Ficin, elle est toute la vertu. [109][199] C’est elle qui vous a mené à servir l’Église, le roi et le peuple, car vous avez été nommé magistrat, maître des requêtes, président au grand Conseil, [200] président au mortier, et enfin surintendant des finances. Votre sagesse à diriger une si éminente charge vous a valu toute la considération de notre grande reine, car elle a compris que seul un homme tempérant pouvait la mettre à l’abri de la cupidité. [110] Ainsi établi dans le royaume, à l’instar d’une grande maison, vous devez administrer les biens du roi comme notre patrimoine commun, c’est-à-dire avec autant de zèle que de fidélité ; vous appliquez en vérité tant de soin à cette affaire que vous ne laisserez pas d’autre héritier de vos biens personnels que le peuple, comme s’il s’agissait d’un domaine négligeable. Quelle est cependant la source de tout cela, sinon cette sobriété qui vous soustrait à tant et tant de plaisirs, et vous rappelle que vous n’êtes pas né pour votre bien propre, mais pour celui du public ? Il s’agit donc d’une vertu remarquable que doivent cultiver tous les éminents personnages, non parce qu’elle fuit les voluptés, mais parce qu’elle en poursuit de bien plus élevées. Le ciel vous rendra ce que vous avez donné à la terre : il vous procurera généreusement l’absence de chagrin que tous désirent vivement, la longévité que souhaitent les gens heureux, l’euthanasie qu’espèrent les sages, [103] et l’immortalité à laquelle aspirent les chrétiens. En effet, le tempérant ne redoute pas l’atrocité des souffrances que procure la mort car elle ne lui arrache pas violemment la vie, mais la lui soustrait furtivement ; son esprit quitte l’asile de son corps comme on sort d’une maison délabrée, mais sans en être expulsé, car les sobres paraissent plutôt s’endormir que périr. La fin d’une vie sobre ne peut être qu’aisée. Jouissez donc (très éminent Monsieur) du bien que vous possédez, vous qui menez une vie digne d’être vécue, dont tous admirent le renom, mais que peu imitent, et à peine quelques-uns y parviennent. Voilà ce pourquoi prie, sans peut-être en être digne, mais du fond du cœur,
très illustre président,votre très obéissant et dévoué serviteur, Jean de Montigny. »
Commentaires (Loïc Capron)
Strictement consacrée aux « choses non naturelles », c’est-à-dire à l’hygiène, [201] cette thèse est parfaitement conforme à l’esprit d’une question cardinale. [111]
Sans aucune originalité, Patin liait avec conviction et enthousiasme la santé à la sobriété, vertu qu’il tenait pour l’unique véritable panacée, au profond mépris de toutes celles que, de bonne ou de mauvaise foi, les charlatans de tout poil vantaient alors, et vantent encore de nos jours. Pour l’essentiel, les mœurs de l’homme sont responsables de ses maladies et de sa trop brève existence. On retrouve ici les préceptes que Patin avait développés avec moins d’intransigeance et plus d’esprit (à mon goût) dans son Traité de la Conservation de santé (1632). Sa démonstration se fonde sur des convictions morales, et non sur une observation rigoureuse et objective des faits : bel exemple du dogmatisme [202] opposé à l’empirisme, [203] en pleine fidélité avec le courant qui prévalait encore dans l’École médicale parisienne. La sobriété promet, voire garantit une longue et agréable vie, sans se pencher un instant sur le paradoxe entre les tempérants qui peuvent mourir tôt (Jean de Montigny n’en a été qu’un exemple), [105] et les libertins effrénés [204] à qui il arrive de vivre fort vieux. La seule limite que Patin met à son tout-puissant principe est, à la fin de l’article iii, une timide réserve sur ce que deviendrait le monde si tous y respectaient l’ascèse des anachorètes antiques. [37]
La Sobriété de 1647, consacrée au rôle de l’acquis (environnement) sur la santé, se faisait le pendant de L’homme est par nature tout entier maladie de 1643, consacrée à l’inné (hérédité), mais sans intention d’en être le complément, car la seconde ne dit presque rien de la première, hormis de brèves allusions aux « parfaits innocents », innocentissimi, qu’une « débilité innée », innata imbecillitas, a défavorisés. Patin laissait aux bienveillants lecteurs le soin de concilier à leur guise les deux points de vue, en apparence contradictoires, sur la « grâce » que représente la santé humaine. [112]
Les deux textes recourent toutefois au même sidérant procédé d’écriture. La Sobriété est aussi un long centon : du début à la fin, elle coud bout à bout des citations latines empruntées à des écrivains qui ne sont jamais nommés. Sans prétendre les avoir tous identifiés, j’ai compté 146 emprunts à 40 auteurs.
- Ils se répartissent en 26 antiques et 14 modernes, dont seuls 5 étaient médecins : Jean Fernel, trois fois ; [16][51][94] Nicolas-Abraham de La Framboisière, [13] Jean-Antoine Sarrasin, [104] Daniel Sennert, [101] René Moreau, [93] chacun une fois.
- Sénèque le Jeune, [3] enfoui derrière 31 fragments, vient très largement en tête des inspirateurs de Patin, devant Pline l’Ancien (15 fois), [19] Horace (13 fois) [18] et Érasme (9 fois). [13] La forte influence du philosophe romain imprègne toute la thèse de stoïcisme, [205] mais sans bien sûr aborder la délicate question de la mort volontaire, [206] qui était l’un de ses grands sujets de réflexion.
- L’auteur le plus inattendu est Jeremias Drexel, [29] qui est la source de 9 copieux passages. Ce jésuite allemand contribue plus que la Bible (citée 4 fois) à l’esprit chrétien de la thèse.
Ainsi rapiécé, le latin de Patin n’est ni limpide, ni partout des plus simples à comprendre : pour en trouver le sens exact, j’aurais parfois peiné à le traduire correctement sans remonter aux sources où il a puisé. En fouillant pour les identifier, j’ai d’ailleurs constaté que maints auteurs ultérieurs ont repris ses phrases, bien souvent sans citer, eux non plus, leur origine. Je me suis aussi dit que les apothicaires parisiens, en dehors des attaques transparentes et frontales des articles iii et v contre plusieurs médicaments, avaient dû peiner à entendre ce texte sans la complicité de quelques docteurs antimoniaux de la Faculté, ennemis de son clan antistibial, alors encore majoritaire. [207]
Tout cela ne surprend en rien qui a lu les lettres de Patin antérieures à 1647, mais ses propos y étaient privés, tandis que sa thèse proclamait publiquement ses avis du haut des bancs de la Faculté, avec une emphase et une virulence bien plus acérées que dans son Traité de la Conservation de santé.
Le plus notable point commun à la quodlibétaire de 1643, L’homme est par nature tout entier maladie, et à la cardinale de 1647, sur la Sobriété, mère de longue et agréable vie, est d’avoir toutes deux traîné Patin devant le Parlement pour répondre aux plaintes respectives de Théophraste Renaudot [208] et des pharmaciens. [209] Absolument sûr de son fait, sans la moindre crainte du ridicule et soutenu par la cabale dogmatique de la très salubre Faculté, il est sorti vainqueur de ces deux procès et en a tiré une grande part de sa célébrité naissante, pour sa meilleure comme pour sa pire fortune.
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Lettre de Guy Patin introduisant le Borboniana manuscrit >
Codes couleur
Citer cet écrit
Imprimer cet écrit
Imprimer cet écrit avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8221
(Consulté le 06/05/2024)
Lettre de M. Patin écrite à son fils,
servant de Préface à tout ce recueil [a][1]
« Mon fils,
Je parle à vous comme si c’était ici mon testament. Tous ces cahiers que vous voyez sont un ramas sans aucun ordre de plusieurs choses fort différentes, que j’ai apprises et ouï dire aux uns et aux autres ; mais la plus grande part vient de la conversation que j’ai eue durant quelques années avec le clarissime et très savant M. Nicolas Bourbon, dans l’Oratoire à Paris. [1] Il y a quantité de bons mots qu’il fait bon savoir ; il peut y avoir quelque mécompte ou fausseté, mais il y en a peu : la plupart des citations y sont vraies, car j’y ai pris plaisir en les vérifiant. Il y a quelques points bien libres et bien délicats touchant la religion et le gouvernement des princes, qu’il vaudrait mieux bien savoir et les avoir dans l’esprit que de les rédiger par écrit (cela étant meilleur à taire qu’à être divulgué). Je les ai néanmoins écrits tant pour moi que pour vous : faites-en votre profit, mais ne les montrez jamais à personne, non plus que s’ils n’étaient pas écrits. Ayez-les pour vous, étudiez-les, lisez-les ; mais ne dites jamais que vous ayez cela en des cahiers écrits de ma main, car enfin, vous vous trouveriez embarrassé et peut-être obligé de les prêter à quelqu’un ; ce que vous ne devez jamais faire, pas même à votre frère, si vous ne le jugez fort capable de tout secret ; néanmoins, si vous pensez que cela lui serve, ne lui déniez pas. Si vous y découvrez quelque faute, amendez-la sagement. Tout ce que j’y ai dit des jésuites, croyez-le comme très vrai, mais ne le dites jamais que très à propos, de peur de vous charger à crédit en vain, et même à votre grand regret, de la haine de ces gens-là, qui ne valent rien et qui même ne pardonneraient pas à Jésus-Christ s’ils le tenaient pour avoir de l’argent : autres Judas, Mézences ressuscités, hommes tout à fait perdus, tenez-les pour païens et publicains. [2][2][3][4] J’ai prêté quelques-uns de mes cahiers à trois de mes amis, l’un après l’autre ; mais je m’en suis toujours repenti ; c’est pourquoi je vous le dis encore un coup, ne les prêtez jamais, ni ne les faites voir à personne. Gardez-les pour vous, gardez-les pour vous et pour les Muses. Lisez-les, et les brûlez plutôt que de les prêter jamais à personne. Mais avant que de les brûler, apprenez-les : il y a là-dedans quelque chose de bon, qui m’a quelquefois servi extrêmement et qui vous servira bien aussi, si vous en savez faire votre profit. Tout ce qui est là-dedans n’est pas toujours mon avis : j’ai parfois parlé suivant l’avis des autres. Il y a du mauvais, du médiocre et beaucoup de bon, c’est l’Ægyptus Homerica. [3][5][6] Pensez à en faire sagement votre profit. Croyez-moi, et vous vous en trouverez bien. »
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Ana de Guy Patin :
Introduction de René Pintard au Grotiana >
Codes couleur
Citer cet écrit
Imprimer cet écrit
Imprimer cet écrit avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8222
(Consulté le 06/05/2024)
René Pintard [1] a donné la première édition complète du Grotiana. [1] En hommage à son remarquable talent critique et à la qualité de ses recherches, je reprends ici son commentaire introductif (Pintard a, pages 59‑61).
« […] les ana de Guy Patin ne rassemblent pas des traits cueillis au hasard, mais les fruits de conversations patientes et précises, menées avec le désir persévérant de s’instruire. [2]On peut le vérifier par exemple dans le Grotiana, que nous reproduisons plus loin intégralement. C’est au domicile même de l’ambassadeur qu’ont eu lieu les entretiens d’où Guy Patin a tiré les détails qu’il rapporte. [3][2] Le médecin est venu, sans nul doute, muni de ces “ billets ” avec lesquels Godefroi Hermant [3] le voyait aborder les doctes “ pour s’éclaircir avec eux de 5 ou 6 questions ”, [4] et c’est grâce à eux qu’il a pu se rappeler tant de noms propres, ou tant de dates. Il a mis aussitôt son interlocuteur sur le propos des grands humanistes qui ont brillé en Hollande, comme Joseph Scaliger. [4] Un mot de Grotius, sur la responsabilité des jésuites dans certaines attaques contre Scaliger, a fait un instant dévier la conversation sur la Compagnie, [5] mais elle est vite revenue à son objet premier et elle s’est longuement fixée sur Juste Lipse. [5][6] Est-ce quelques instants plus tard, ou un autre jour, qu’il a été question des juifs, [7] de la Bible, de Job, [8] puis du cardinal Richelieu ? [9] Cette fois, Guy Patin a dit son mot, en citant une épigramme contre Richelieu, et Grotius lui a répondu par son appréciation personnelle. [6] Même intervention, un peu après, au sujet de Jérémie Ferrier, [10] puis d’Érasme, [7][11] et répliques variées de Grotius : nul doute que ce ne soient les péripéties véritables d’un entretien authentique que le médecin a relatées, le soir, sur les pages de ses cahiers.
S’étonne-t-on que, plus loin, la discussion saute brusquement du prince d’Anhalt [12] aux livres du P. Petau ? [8][13] “ Comme je visitai un jour ce M. Grotius, raconte Patin dans une de ses lettres, je vis ces trois tomes sur la table ; je lui en demandai son avis. Il me répondit sur-le-champ : le P. Petau, qui est mon ami, me les a donnés, je les ai lus tout entiers. C’est un étrange fatras, cela n’est point de la théologie ; il n’y a là-dedans qu’une chose de bien, c’est que l’auteur entend bien le grec, lequel y est fidèlement traduit. ” [9] Et voilà une nouvelle version du jugement de Grotius, un peu trop appuyée peut-être, mais accompagnée de l’indication des circonstances où il a été prononcé. Elle nous permet d’évoquer d’autres scènes analogues, et d’abord d’en imaginer le cadre avec exactitude. Ce n’est pas dans un salon que le médecin et ses amis échangent, avec la légèreté des allusions mondaines, des reparties rapides : ils sont réunis dans l’“ étude ” de l’un d’entre eux, parmi ses livres ; c’est de belles-lettres et d’histoire qu’ils s’enquièrent l’un auprès de l’autre, sérieusement ; viennent-ils à mentionner un texte d’un auteur, ils vont rechercher la citation dans ses œuvres, ils en vérifient la référence, que les mémoires ou les tablettes de Guy Patin notent presque toujours avec précision ; l’un après l’autre, ainsi, ils confrontent et confirment réciproquement leurs souvenirs, qui seront, le soir même, consignés dans les précieux cahiers : de là le médecin les tirera, quelque jour, pour en faire part à l’un de ses fidèles correspondants.
Sans nul doute, il pourra, à la longue, sous l’influence de ses préjugés et de ses manies, déformer ces souvenirs, durcir ces opinions ; mais sur le moment même, il les enregistre avec une parfaite loyauté. Avant même, par exemple, qu’il ait vu Grotius, il a eu vent de ses projets de conciliation entre les Églises, et il les a jugés chimériques : cela ne l’empêche pas de transcrire le témoignage sympathique que Grotius porte sur l’entreprise de son précurseur, G. Cassander. [10][14] Bientôt après, de même, il fera sans bienveillance, dans ses lettres, allusion au double penchant du Hollandais pour le socinianisme [15] et pour le catholicisme : il laisse néanmoins, dans le Grotiana, son ami exprimer tout au long sa condamnation des réformateurs qui ont quitté l’Église et des réformés qui ne veulent pas y entrer, et il reproduit, sans y mêler ses propres sévérités, d’anodines remarques sur Lælius et Fauste Socin. [11][16] Sa partialité pour Jansenius [17] et les jansénistes ne le détourne pas davantage de citer les réserves que fait Grotius sur l’Augustinus [18] et sa théologie prédestinatienne. [12][19] Ainsi l’étroite communauté de sentiments qui rapproche les deux hommes en d’autres domaines – haine des ordres religieux, hostilité à l’égard de l’autorité papale, condamnation vigoureuse des abus ecclésiastiques, souhait d’une religion amendée et simplifiée – n’empêche pas Patin d’accuser honnêtement leurs divergences ; ailleurs, il dira, âprement s’il le veut, ce qu’il pense ; pour le moment, il ne s’agit pour lui que d’écouter. »
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
< Ana de Guy Patin :
L’Esprit de Guy Patin (1709),
Faux Patiniana II-7
Codes couleur
Citer cet écrit
Imprimer cet écrit
Imprimer cet écrit avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8220
(Consulté le 06/05/2024)
Pages 300‑380 (et dernière) [1]
Notre ami M. D…, qui est un savant modeste et qui ne veut point être connu, m’envoya il y a quelques jours un petit manuscrit qu’il appelle sa conversation ambulante ou l’enjouement de sa solitude. Pour se délasser d’une étude austère et pénible, il s’applique à recueillir les principaux traités de l’histoire qui l’intéressent davantage.
« Je me suis aperçu que l’esprit se relâche par les ouvrages mêmes de l’esprit. Vous en ferez l’épreuve si vous le souhaitez : comme je ne crois rien hasarder avec vous, je m’oblige de fournir tout ce qui me sera adressé dans ce genre récréatif. » [1][2]
La « Conversation ambulante » de Monsieur D…
ou les 98 emprunts de L’Esprit de Guy Patin au Grand Dictionnaire de Louis Moréri (pseudo-Moreriana)
- Moréri 1707, tome 1, page 592 – Homme ne fut jamais plus studieux que le cardinal Bessarion, [3] sa grande application à l’étude fut même cause de ce qu’il ne monta pas sur la chaire de saint Pierre. Après la mort de Paul ii, [4] les cardinaux avaient élu pape Bessarion. Trois d’entre eux étant allés chez lui pour lui en annoncer la nouvelle, Nicolas Perrot, [5] son camérier, ne voulut jamais leur ouvrir la porte du cabinet où il étudiait. Piqués de ces refus, ils se retirèrent et élurent Sixte iv. [6] Le cardinal Bessarion ayant depuis appris ce qui s’était passé, en témoigna son ressentiment à Perrot, car il n’y a personne qui puisse voir sans regret échapper une telle dignité. Paul Jove, [7] qui rapporte cette particularité, ajoute qu’il lui dit : « Perrot, ton incivilité me coûte la tiare, et elle te fait perdre un chapeau de cardinal. » [2]
- Moréri 1707, tome 4, page 859 – Nous n’avons de Monsieur de Vaugelas [8] que deux ouvrages considérables, qui sont les Remarques sur la langue française et sa traduction de Quinte-Curce. [9] Il y a travaillé l’espace de trente ans afin de la rendre parfaite. Monsieur de Balzac [10] a dit au sujet de cette belle traduction : « L’Alexandre de Quinte-Curce est invincible, et celui de Vaugelas est inimitable. » On remarque une heureuse repartie que fit Vaugelas au cardinal de Richelieu [11] qui, pour l’engager au travail du Dictionnaire de l’Académie, [12] avait fait établir sa pension de 2 000 livres. Le cardinal de Richelieu le voyant entrer dans sa chambre et prêt à le remercier de sa libéralité, le prévint et lui dit : « Hé bien, Monsieur, vous n’oublierez pas du moins dans le Dictionnaire le mot de pension ! – Non, Monseigneur, répondit Vaugelas, et moins encore celui de reconnaissance. » Rien n’a jamais été répliqué si à propos. [3][13]
- Moréri 1707, tome 1, page 204 – Une des belles fortunes qui se soit faite dans l’Église est celle de Jacques Amyot, évêque d’Auxerre et grand aumônier de France. [14] Son père était un courroyeur de la ville de Melun. [15] La crainte du fouet le fit sortir très jeune de la maison paternelle. Il tomba malade dans la Beauce et demeura étendu sur un chemin ; un cavalier charitable le mit en croupe derrière lui et le conduisit jusqu’à Orléans, [16] où il lui procura place dans l’hôpital ; aussitôt qu’il fut guéri, on le renvoya ave seize sols pour son voyage. Arrivé à Paris, il fut obligé d’y demander l’aumône ; une dame le prit chez elle pour suivre ses enfants au collège. Il profita de cette occasion et cultiva le génie merveilleux que la nature lui avait donné pour les belles-lettres ; surtout, il excella dans la langue grecque. Sous peine de favoriser les nouvelles opinions, il se retira en Berry chez un gentilhomme qui le chargea de l’éducation de ses enfants. Henri ii [17] vint loger par hasard dans la maison de ce gentilhomme ; Amyot composa une épigramme grecque à l’honneur du roi, à qui elle fut présentée par les enfants dont il conduisait les études. Le roi voyant ce que c’était : « C’est du grec, dit-il en jetant le papier, à d’autres ! » Monsieur de l’Hospital, [18] depuis chancelier, qui accompagnait le roi, lut l’épigramme, la trouva admirable et dit au roi que si ce jeune homme avait autant de vertu que de génie, il méritait d’être précepteur des Enfants de France. Cela mit Amyot en crédit, il obtint l’abbaye de Bellozanne, [19] et eut ordre enfin d’aller au concile de Trente, [20] où il prononça cette judicieuse et hardie protestation qui nous reste. À son retour, il commença d’exercer sa charge de précepteur des Enfants de France auprès du dauphin, qui fut depuis le roi François ii, [21] et le fut aussi de Charles ix [22] et de Henri iii. [23] On dit qu’un jour, durant le souper du roi Charles ix, la conversation étant tombée sur Charles Quint, [24] on loua cet empereur d’avoir fait son précepteur pape, c’était Adrien vi. [25] Le roi regarda Amyot et dit : « Si l’occasion se présentait, j’en ferais bien autant pour le mien. »
Quelque temps après, la charge de grand aumônier de France vaqua, elle lui fut donnée. La reine mère, [26] qui avait eu d’autres vues, fit appeler Amyot, où elle lui tint ce fier discours : « J’ai fait bouquer les Guise, les Châtillon, les connétables et les chanceliers, les princes de Condé et les rois de Navarre, et je vous ai en tête, petit Prestolet. » Amyot eut beau protester qu’il n’avait pas voulu accepter cette charge, la conclusion fut que s’il la conservait, il ne vivrait pas vingt-quatre heures : c’était là le style de ce temps-là. Amyot prit le parti de se cacher pour se dérober également à la colère de la mère et aux libéralités du fils. Le roi, inquiet de ne le point voir, attribua cette absence aux menaces de la reine. Il s’emporta si fort qu’elle fit dire à Amyot qu’il pouvait paraître et qu’elle le laisserait en repos. [4][27] Ce grand homme ayant eu le chagrin de voir mourir les trois monarques qu’il avait eu l’honneur d’instruire, se retira dans son diocèse, où il mourut le 7 février 1593, âgé de 79 ans. Il fit par son testament un legs de 1 200 écus à l’hôpital d’Orléans en reconnaissance des seize sols qu’on lui donna pour venir à Paris.
- Moréri 1707, tome 2, pagec 800‑801 – Félibien [28] rapporte un trait bien généreux des Fouckers : [29] ils avaient amassé de grandes richesses et étaient connus dans l’Allemagne pour les plus opulents négociants. Charles Quint passant en Italie, et delà par la ville d’Augsbourg, [30] leur fit l’honneur de loger chez eux. Pour lui marquer leur reconnaissance, ils le régalèrent d’un fagot de cannelle, [31] marchandise, comme l’on sait, de très grand prix ; et lui ayant montré une promesse d’une somme considérable qu’ils avaient de lui, ils y mirent le feu et en allumèrent le fagot. Cette action plut sans doute à l’empereur : il devenait quitte d’une dette que les affaires ne lui permettaient pas alors de payer facilement. [5]
- Moréri 1707, tome 2, pages 22‑23 – Caligula [32] affectait de représenter en sa personne toutes les divinités : pour être appelé le nouveau Jupiter, [33] il se fit dorer la barbe et prenait un foudre à la main ; tantôt, il se parait du trident de Neptune, [34] du caducée de Mercure, [35] de la lyre d’Apollon, [36] du bouclier de Mars [37] et de la massue d’Hercule ; [38] quelquefois, il s’habillait comme Vénus, [39] avec une couronne de myrrhe, [40] quelquefois comme Diane, [41] avec le javelot et le carquois. Lorsque, lassé de ressembler aux dieux, il voulait rentrer dans la condition des hommes, son habit ordinaire était un manteau brodé d’or, enrichi de perles et de diamants. Souvent, pour se donner la réputation de brave, il endossait le corselet d’Alexandre, [42] qu’on avait tiré de son tombeau, et presque toujours, il marchait avec les ornements triomphaux la couronne d’or et de laurier, le bâton d’ivoire, la robe bordée de pourpre et la casaque brochée à palmes. [6][43]
- Moréri 1707, tome 4, page 95 – Les rois de France n’ont pas été les premiers qui aient fait publier des ordonnances rigoureuses contre le luxe. Il y avait chez les Romains la loi Oppia, ainsi nommée du nom de C. Oppius, tribun du peuple : [44] cette loi défendait l’excessive dépense des habits, et même l’usage des carrosses ; il n’était pas permis aux dames romaines de porter plus d’une demi-once d’or sur leurs robes, encore ne devaient-elles être que d’une seule couleur ; elles ne pouvaient aussi aller en carrosse dans la ville ou à mille pas environ, à moins qu’elles ne fussent engagées par une cérémonie de religion et par la nécessité bienséante d’assister aux sacrifices. Au reste, il faut remarquer que cette loi ne fut exécutée que pendant vingt ans. Les femmes, toujours ambitieuses de paraître magnifiques, exercèrent tant de brigues qu’elles la firent abolir. Elles n’attendent pas aujourd’hui que la loi soit abolie car elles ne laissent pas, malgré les défenses, de continuer leur luxe et d’augmenter leur faste. [7][45]
- Moréri 1707, tome 3, page 475 – Il est étrange que les Romains, si judicieux dans leurs lois, aient autorisé un crime le plus directement opposé à la justice : ils consacrèrent un temple à la déesse Laverne, [46] qu’ils croyaient être l’intendante des larcins et la protectrice des voleurs ; ce temple leur servait d’asile et ils pouvaient en assurance y aller partager le fruit de leur brigandage. Horace a ainsi exprimé le caractère de cette divinité : [47]
Pulchra Laverna
Da mihi fallere, da justo sanctoque videri,
Noctem peccatis et fraudibus objice nubem. [8]Quelle religion, qui adorait des divinités auxquelles on pouvait faire de telles prières, et adresser des vœux aussi criminels !
- Moréri 1707, tome 2, page 209 – La joie produit quelquefois des accidents aussi funestes que la plus grande tristesse. Chilon, [48] un des sept Sages de la Grèce ; [49] mourut de plaisir en embrassant son fils qui avait été couronné aux Jeux olympiques. [9][50]
- Moréri 1707, tome 2, page 697 – Le pape Étienne vii, [51] successeur de Formose, [52] fâché de ce que ce pape avait été transféré du siège de Port [53] à celui de Rome, regarda cette action comme une espèce de concubinage, d’adultère, de bigamie, car il disait que c’était quitter une épouse légitime pour en prendre une nouvelle, contre les lois. Étienne vii, peut-être plus animé par la haine qu’il avait contre Formose que par un vrai zèle de religion, fit déterrer son corps et l’ayant mis, revêtu des ornements pontificaux, dans la chaire papale, il lui reprocha qu’il avait violé les règles de l’Église et le condamna, comme s’il eût été vivant : on le dépouilla des ornements sacrés, on lui coupa les trois doigts qui lui servaient à donner la bénédiction, et on le jeta ensuite dans le Tibre avec une pierre au col. Quand même Formose aurait mérité une condamnation si rigoureuse, cette punition exercée après sa mort scandalise plus la religion qu’elle n’est capable d’en maintenir la pureté. [10][54]
- Moréri 1707, tome 2, page 652 – Quelques auteurs attribuent à Eschyle, [55] poète grec, l’invention de la tragédie. Sans entrer dans cette dissertation, une remarque suffit : les représentations de ses pièces étaient si terribles que, la première fois qu’il fit jouer les Euménides, plusieurs enfants qu’on avait menés au théâtre y moururent de frayeur, et quelques femmes grosses y accouchèrent. Ce grand succès n’empêcha pas que Sophocle, [56] beaucoup plus jeune que lui, ne lui fût préféré. [11][57]
- Moréri 1707, tome 3, page 172 – Le philosophe Hegesias, [58] qui vivait du temps de Platon, [59] avait le don de persuader, jamais homme n’a été plus pathétique. Si nous en croyons Valère Maxime, [60] les paroles de ce philosophe exprimaient tellement, dans l’esprit de ses auditeurs, l’usage des choses qu’elles représentaient, qu’ayant parlé des maux de la vie, la plupart de ceux qui l’écoutaient prenaient la résolution de se tuer de leurs propres mains. [61] Afin d’empêcher le cruel effet d’une si vive persuasion, l’on défendit à Hegesias de prononcer de semblables discours. [12]
- Moréri 1674, page 633 – Qu’il est bien vrai que le mérite n’est pas toujours récompensé, et que la fortune est rarement l’apanage de la science ! Homère était si misérable qu’il se vit contraint de mendier son pain. [13][62] Si le sort d’un bon poète fut tel, doit-on plaindre celui des mauvais auteurs qui languissent dans la misère ? ou plutôt, n’est-on pas en droit d’envier la fortune de quelques gens qui parviennent sans esprit, et qui vivent honorablement de leurs biens, pendant que leurs écrits les déshonorent ?
- Moréri 1707, tome 2, page 194 – Le maréchal Taunequi du Châtel, [63] grand favori du roi Charles vii, [64] eut pour récompense de ses importants services un triste exil. Une preuve qu’il ne le méritait pas, ou qu’il conservait toujours une parfaite reconnaissance pour son maître, fut l’empressement qu’il eut de revenir à la cour, quoique fort âgé, sitôt qu’il apprit la mort de ce prince : il dépensa 30 000 écus pour les funérailles de Charles vii, que tout le monde avait négligées. Cette générosité a donné lieu à l’inscription mise depuis sur le drap mortuaire du roi François ii, « Où est maintenant Taunequi du Châtel ? ». Par là, on reprochait aux courtisans le peu de soin qu’ils avaient < à > rendre les derniers devoirs à leur maître. [14]
- Moréri 1707, tome 3, pages 257‑258 – Le Sénat avait mis un rude impôt sur les femmes de Rome. Aucun avocat n’osant parler en leur faveur, Hortensia [65] prit seule le parti de toutes les personnes de son sexe : elle plaida leur cause devant les triumvirs avec tant d’éloquence et de feu qu’elle obtint que la plus grande partie de l’argent qu’elles devaient payer leur soit remboursé. [15][66]
- Moréri 1707, tome 1, page 237 – Aulu-Gelle [67] rapporte qu’un esclave nommé Androclus [68] prit la fuite et se cacha dans une caverne. Là il trouva un lion qui le caressa en lui présentant le pied, d’où il lui arracha une épine. Quelque temps après, cet esclave fut exposé aux bêtes dans l’amphithéâtre ; le lion, qui avait aussi été pris et mis dans le même lieu, reconnut son bienfaiteur et le défendit. Cette aventure surprenante valut la liberté à Androclus. [16]
- Moréri 1707, tome 3, page 599 – Lycurgue, roi de Thrace, [69] voyant que ses sujets étaient trop adonnés au vin, [70] fit arracher toutes les vignes de son royaume. Les poètes ont pris là occasion de feindre que ce roi était ennemi de Bacchus [71] et que les dieux, pour le punir, avaient permis que, dans le transport d’une fureur violente, il se coupât les jambes. [17][72]
- Moréri 1707, tome 4, pages 240‑241 – Phocion, [73] général d’armée des Athéniens, avait trois belles qualités : il était bon citoyen, grand orateur, illustre capitaine. Alexandre eut plusieurs occasions d’estimer son courage et son désintéressement. Lorsque ce roi mourut, le peuple d’Athènes voulut faire des réjouissances publiques parce qu’il se trouvait débarrassé d’un ennemi puissant et d’un vainqueur toujours terrible. Phocion s’y opposa adroitement, soit qu’il crût toujours indigne de se réjouir de la mort d’un grand homme, soit qu’il voulût faire entendre aux Athéniens que braves comme ils étaient, ils n’avaient point d’ennemis à craindre. Aussi les fit-il alors souvenir qu’ils n’avaient perdu qu’un seul homme contre Philippe [74] dans la bataille de Chéronée. [75] Le peuple, qu’un trop grand mérite blesse, condamna injustement Phocion comme traître à sa patrie ; mais les Athéniens connurent bientôt le tort qu’ils avaient eu de le faire mourir. Pour réparer une faute si grande, ils élevèrent une statue et condamnèrent à mort Agnonidès, [76] son accusateur. Une chose bien digne de la générosité de Phocion, interrogé avant que de mourir s’il n’avait rien à dire à son fils, [77] fut de répondre qu’il lui recommandait seulement d’oublier les injures du peuple athénien. Il s’en souvint, ce fils tendre et reconnaissant, car par ses soins, les auteurs de la mort de son père se virent condamnés à celle qu’ils méritaient. [18][78]
- Moréri 1707, tome 2, page 731 – On n’est jamais blâmé de se montrer jaloux des prérogatives de son rang. Quintus Fabius Maximus, fils d’un ancien dictateur, [79] voyant son père qui venait à lui sans descendre de cheval, lui envoya dire de mettre pied à terre. Bien loin de murmurer contre l’orgueil apparent de son fils, il l’embrassa et lui dit : « Je voulais voir si tu savais ce que c’est d’être consul. » Cet illustre romain, plus dévoué à l’honneur de sa patrie que sensible aux complaisances de la nature, aimait mieux avoir un fils qui sût maintenir à propos les droits de sa charge que de se voir à contretemps respecté par un consul, à qui lui-même devait alors du respect. [19]
- Moréri 1707, tome 2, page 732 – Un médecin célèbre dans le seizième siècle nommé Fabrizio [80] avait en partage deux choses très rares : une science fort étendue, un désintéressement parfait. Il exerçait son art gratuitement ; les amis piqués de reconnaissance l’obligèrent d’en recevoir des marques ; il mit tous leurs présents dans un cabinet particulier où l’on voyait cette inscription sur la porte : Lucri neglecti lucrum. [20][81] La République de Venise [82] lui assigna un revenu de deux mille écus, et l’honora d’une statue et d’une chaîne d’or.
Nous n’avons point de médecin en France qui soit curieux d’une telle inscription. Moi-même, qui me pique quelquefois de désintéressement, je ne voudrais pas que tout le monde me connût cette qualité : des gens qui ne l’auraient pas en abuseraient ; et faciles à retenir leur argent, ils se moqueraient du médecin qui mépriserait les richesses.
- Moréri 1707, tome 4, page 526 – Jean-Baptiste Sapin, [83] conseiller au Parlement de Paris, envoyé à Tours et en Espagne en qualité d’ambassadeur de Charles ix, roi de France, fut pris par un parti de la garnison d’Orléans. Le chef du parti, violant toute sorte de droits, le fit pendre dans la place de l’Étape, [84] la condamnation < étant > fondée sur ce qu’il avait persécuté ceux qui faisaient profession de la Religion évangélique. [85] On apporta à Paris le corps de cet illustre conseiller. Le Parlement prit la défense et déclara solennellement que c’était lui-même qu’on avait outragé indignement. Il lui rendit en corps les derniers honneurs par de magnifiques funérailles dans l’église des Augustins, [86] où est dressée cette épitaphe digne d’un vrai défenseur de la foi ; la glorieuse cause de sa mort y est marquée en ces termes :
Quod antiquæ et Catholicæ Religionis adsertor fuisset, turpissimæ morti addictus < … > honestam et gloriosam pro Christi nomine et Christiana Republica mortem perpesso.
Ainsi le nom de Jean-Baptiste Sapin malgré l’infamie de son supplice, dont toute la honte retombe sur les huguenots, fera toujours très grand honneur à ces illustres descendants. C’est la juste réflexion du Père Maimbourg [87] qui rapporte ce trait dans son Histoire du calvinisme. [21]
- Moréri 1707, tome 2, page 556 – Horace [88] se moque ingénieusement d’un nommé Druso, misérable historien qui vivait du temps d’Auguste : [89] comme il était fort riche et qu’il prêtait de l’argent aux uns et aux autres, il obligeait ses débiteurs d’entendre et d’applaudir ses ouvrages. [22] Quand de certains auteurs voudront me lire leurs pièces, il faudra que je leur doive ou qu’ils payent entièrement ma complaisance. Encore y en a-t-il de si pitoyables que tout l’or du monde ne m’engagerait pas de les approuver.
- Moréri 1674, pages 372‑373 – On dit d’un avare qu’il a l’âme crasse, je porte l’origine de cette expression jusqu’au consul Crassus, [90] qui était extrêmement riche et qui, pour le devenir encore plus, faisait un vil commerce d’esclaves. Il acquit tant de biens qu’il fit un festin public au peuple romain ; il donna même à chaque citoyen autant de blé qu’il en pouvait manger durant trois mois. Ses richesses se montaient à près de cinq millions : aussi n’estimait-il pas un homme opulent s’il n’avait de quoi entretenir une armée. Son avarice était insatiable, il pilla le trésor du Temple de Jérusalem [91] et emporta de la Judée des dépouilles inestimables. Ce lâche et vil attachement au bien lui fit entreprendre la guerre contre les Parthes ; ils le prirent, lui coupèrent la tête et l’apportèrent à Clau, l’un de leurs rois ; [92] ce prince fit couler de l’or fondu dans la bouche de Crassus afin d’assouvir la passion qu’il avait eue pour les richesses. [23][93][94]
- Moréri 1707, tome 3, page 753 – Mermeroë, [95] capitaine persan, après avoir passé sa jeunesse dans les fatigues de la guerre et se voyant réduit à ne pouvoir marcher ni se servir de ses bras, se fit porter en litière au milieu des troupes pour y donner conseil et inspirer du courage. La récompense de ses belles actions fut l’honneur que l’on faisait aux personnes de mérite : selon la coutume des Persans, ses parents exposèrent son corps en pleine campagne sans autre sépulture, persuadés, suivant la superstition extravagante du pays, qu’ayant vécu en homme de bien, il ne manquerait pas d’être aussitôt dévoré par les chiens ou par les bêtes féroces, ce qui était pour eux la marque la plus infaillible de leur prédestination ; au lieu qu’ils croyaient que ceux dont les cadavres n’étaient point mangés par les bêtes étaient tombés en la puissance des démons, et c’étaient ceux-là dont les parents déploraient la misérable destinée. [24][96][97]
- Moréri 1707, tome 2, page 515 – Sénèque [98] parle d’un certain Didyme, [99] natif d’Alexandrie et fils d’un vendeur de Salines : jamais homme n’a été si laborieux que ce Didyme, il composa jusqu’à trois mille cinq cents traités différents, ce qui le fit nommer Bibliolathas, voulant dire que ses livres étaient en si grand nombre que lui-même l’oubliait ; il a la réputation d’un habile grammairien. [25][100] Nous n’avons point d’auteurs qui produisent tant d’ouvrages : ce n’est pas qu’ils aient moins de démangeaisons d’écrire, mais le talent leur manque ; au reste, on n’en voit que trop qui pourraient fort bien se passer de mettre au jour un nombre infini de volumes, car cette fécondité de leur plume ne prouve que mieux la stérilité de leur esprit, c’est une terre fertile en chardons qui ne produit jamais de bon grain.
- Moréri 1707, tome 1, page 413 – Atticus, [101] fils d’un illustre Athénien, [102] eut si peu d’esprit qu’il ne put apprendre l’alphabet. [103] Son père, qui était riche, lui donna vingt-quatre serviteurs ; chacun avait figure d’une lettre peinte sur l’estomac ; à force de les voir et de les appeler, Atticus connut ses lettres et apprit à lire, mais il n’apprit que cela. [26][104]
- Moréri 1707, tome 1, pages 109‑110 – L’Albane, [105] fameux peintre bolonais, [106] épousa en secondes noces une femme qui n’avait pas beaucoup de biens, mais qui était belle. Ce parti lui fut plus avantageux qu’un autre : il servit à le perfectionner dans son art, car la beauté de sa femme devint son modèle toutes les fois qu’il voulait peindre une Vénus, les Grâces [107] et les autres déesses. Il eut des enfants si beaux qu’ils furent les originaux de tous les petits Amours que l’on voit représenter dans les tableaux. Monsieur Mignard [108] a suivi en cela la manière de l’Albane : tous les beaux visages que l’on voit dans la galerie de Saint-Cloud [109] sont d’après celui de sa fille. [27][110]
- Moréri 1707, tome 1, page 611 sur Mattheo Bissario – On loue avec raison la piété de Constantin [111] qui, pour faire honneur au pape Sylvestre, [112] dans Rome, prit la bride de son cheval. L’empereur Vinceslas témoigna le même respect pour le pape Grégoire xi. [113] Anastase [114] rapporte que Pépin, [115] père de Charlemagne, [116] rendit un semblable honneur au pape Étienne iii < sic pour : ii > [117] lorsqu’il vint en France. [28][118]
- Moréri 1674, page 630 – Les femmes ne sont plus sensibles au vrai mérite, et on n’en verrait point aujourd’hui qui porteraient l’amour des sciences aussi loin que l’a porté Hipparchia : [119] elle devint si passionnée de la sagesse de Crates [120] que ni les prières de ses parents ni les richesses des plus beaux hommes ne purent l’éloigner de celui qu’elle s’était elle-même choisi. Crates même lui représenta sa pauvreté ; l’amour de la philosophie l’attacha davantage à lui, elle l’aima jusqu’au tombeau et lui fut autant fidèle que si elle avait trouvé en sa personne tous les agréments imaginables. [29]
- Moréri 1674, pages 268‑269 – Une charge dont l’établissement serait fort nécessaire est la charge de censeur autrefois connue chez les Romains : [121] une de ses fonctions était de prendre garde à ce qui se passait dans les familles, et d’examiner si l’on y avait soin de l’éducation des enfants. [30] La vigilance d’un tel magistrat n’accommoderait guère certains pères avares qui craignent de pourvoir leurs enfants et qui acquièrent, en ne dépensant rien pour les élever, le droit de différer leur établissement.
- Moréri 1698, tome 2, page 32 – Une épitaphe bien burlesque est celle que Politien [122] a faite pour Companus, < sic pour : Campanus > [123] célèbre auteur d’Italie :
Ille ego laurigeros cui cinxit et infula crines,
Campanus, Romæ delicium hic jaceo.
Mi joca dictarunt Charites, nigro sale Momus, [124]
Mercurius niveo, tinxit utroque Venus ;
Mi joca, mi risus, placuit mihi uterque Cupido. [125]
Si me fles, procul hinc, quæso, < viator, > abi. [31]Il y a un plaisant fort agréable dans cette pensée : « J’ai toujours eu envie de rire, passant, ne t’avise pas de me pleurer, ou retire-toi de moi », Si me fles, abi.
- Moréri 1707, tome 1, pages 656‑657 – Anne de Boulen [126][127] introduisit le schisme en Angleterre [128] et causa la perte de sa patrie. L’origine de cette malheureuse est fort incertaine. Voici un extrait tiré de Sandere, auteur anglais : [32][129][130][131][132]
« Henri viii, roi d’Angleterre, [133] devint amoureux de la femme de Thomas Boulen, chancelier < sic > de l’Ordre de la Jarretière, il le relégua en France avec la qualité d’ambassadeur. Ce commerce donna la naissance à deux filles pendant l’absence de Thomas Boulen. [33] Le roi fit successivement ses maîtresses de l’aînée et de la cadette, qui était Anne ; il ne put jamais corrompre celle-ci, quoiqu’à l’âge de quinze ans, elle eût été débauchée par le maître d’hôtel de l’aumônier de Thomas de Boulen ; François ier, [134] à la cour duquel elle parut, eut aussi part à ses faveurs ; ces prostitutions la firent nommer la Mule du roi et la Haquenée d’Angleterre. Ce fut dans ce temps qu’elle embrassa les erreurs luthériennes ; [135] revenue à la cour de Henri viii, ce prince la vit et l’aima ; elle sut si bien animer sa passion par ses résistances affectées qu’il résolut de l’épouser. Thomas de Boulen, surpris de ce dessein, se rendit premièrement en Angleterre, il dit au roi qu’ayant voulu répudier sa femme, elle lui avait avoué que Sa Majesté était père de cette fille. Henri lui imposant silence, répondit que trop de gens avaient eu part aux bonnes grâces de sa femme pour connaître le véritable père de celle qu’il voulait épouser. [34] Il est nécessaire de remarquer ici que le mariage d’Artus [136] avec Catherine, fille du roi d’Espagne, [137] n’ayant point été consommé, Henri viii, frère d’Artus, épousa la même princesse avec la permission du pape. [35] Tous les enfants moururent, du moins les mâles ; cela donna aux flatteurs l’occasion de lui proposer le divorce ; il en poursuivit la dispense afin d’obtenir le droit d’épouser Anne de Boulen. La dispense refusée, il épousa en secret sa maîtresse, bien que son Conseil lui eût persuadé que c’était une débauchée ; il lui fit prendre la qualité de marquise de Pembroc. Le pape Clément vii, [138] qu’on accuse d’avoir trop tôt employé les foudres du Vatican, excommunia le roi d’Angleterre ; ce prince, entier dans ses sentiments, irrité par un tel procédé, se sépara de l’Église par un schisme déplorable. Ses partisans déclarèrent son premier mariage nul, et < il > rendit le second public la veille de Pâques de l’an 1533 ; et le 2 juin suivant, Anne de Boulen fut couronnée reine d’Angleterre. Le roi fit bientôt une inclination nouvelle qui désespéra sa femme, d’autant plus que, n’ayant eu qu’une fille, étant à sa première couche, et la seconde étant devenue inutile, [139] elle perdit l’espérance d’avoir un fils de Henri. Le désir de donner des héritiers à la Couronne la détermina de s’abandonner à son propre frère. Cet inceste ne la rendit point féconde. Elle se prostitua ensuite à toutes sortes de personnes. Le roi ne put l’ignorer, mais il dissimula jusqu’à ce qu’il eût découvert que sa femme jetait de la fenêtre son mouchoir à un de ses amants. Il la fit prendre ; convaincue d’inceste et d’adultère, elle eut la tête coupée le 19 mai 1535. [140] Le roi voulut que Thomas Boulen, son père prétendu, fût un de ses juges. L’on fit aussi mourir son frère et ses autres amants, dont le nombre n’était pas petit. » [36]
- Moréri 1707, tome 3, page 186 – Le sujet qu’eut Henri viii de se déclarer chef de l’Église anglicane mérite d’être rapporté dans toutes ses circonstances. Ce prince, devenu amoureux d’Anne de Boulen, voulut faire dissoudre son mariage légitime et en contracter un nouveau, contre toutes les lois. Le pape nomma des juges pour examiner la chose. Henri, trop impatient, sans attendre leur décision, se servit du ministère de Thomas Crammer, archevêque de Cantorbéry, [141] qui déclara nul son mariage avec Catherine d’Aragon. Il épousa Anne de Boulen d’une manière clandestine. Le pape, qui en apprit bientôt la nouvelle, prononça sa sentence d’excommunication contre ce roi ; il différa de la publier à la prière de François ier, qui dépêcha Jean Du Bellay, [142] évêque de Paris, pour exhorter Henri à ne se point séparer de la communion de l’Église romaine. Henri le promit au prélat, pourvu que le pape différât de publier l’excommunication. Jean Du Bellay vint à Rome annoncer cette bonne nouvelle et demander du temps, afin de réduire l’esprit inquiet et variable de ce prince. Les partisans de Charles Quint firent limiter ce temps à un espace très court. Le jour fixé étant expiré sans que le courrier envoyé en Angleterre fût de retour, ils précipitèrent la publication de la sentence et la firent publiquement afficher deux jours après ; mais ce fut trop tard < que > le courrier apporta des pouvoirs très amples par lesquels le roi se soumettait au jugement du Saint-Siège. Le Saint-Père reconnut sa faute : faute à jamais irréparable, cause du schisme épouvantable qui divisa éternellement l’Angleterre de l’Église romaine. Henri, transporté de fureur de ce qu’on avait affiché cette sentence ignominieuse, n’eut plus de ménagement, il renonça à l’obéissance du pape, se déclara chef de l’Église anglicane, persécuta tous ceux qui s’opposaient à son changement. Le cardinal Jean Fisher, [143] Thomas Morus [144] et plusieurs autres perdirent la tête sur un échafaud ; une alliance ouverte fut faite avec les hérétiques, il démolit les maisons religieuses, pilla leurs biens, abolit l’Ordre de Malte [145] et poussa l’impiété jusqu’à faire faire le procès à la mémoire de saint Thomas de Cantorbéry [146] et brûler ses os. Ce roi a eu six femmes, il en répudia une et fit couper la tête à deux ; il porta les armes contre la France et l’Écosse. Près de mourir, il voulut rétablir l’Église dans sa première autorité ; il n’était plus temps ; on dit qu’il communia sous une seule espèce [147] et qu’un moment avant que d’expirer, regardant avec un œil affligé ceux qui environnaient son lit, il leur adressa ces paroles : « Mes amis, nous avons tout perdu, l’État, la renommée, la conscience et le ciel. » [37]
- Moréri 1674, page 747 – Julie de Gonzague, si renommée dans le seizième siècle par son esprit et par sa beauté, était veuve de Vespasien Colonna. [148] Barberousse, [149] qui avait ouï parler de sa beauté, envoya des troupes à Fondi [150] où elle demeurait, avec ordre de l’enlever durant la nuit pour en faire un présent à Soliman. [151] L’alarme s’étant donnée à la ville, elle prit la fuite et, sans autre habillement que sa chemise, elle monta à cheval. Les barbares, désespérés d’avoir manqué leur coup, brûlèrent cette ville. [38]
- Moréri 1707, tome 2, pages 434‑435 – La Providence permet que les auteurs des mauvais conseils soient les premières victimes de leur cruauté. Thomas de Cromwell [152] porta Henri viii à ordonner que les sentences rendues contre les criminels de lèse-majesté, [153] quoiqu’absents et non défendus, seraient exécutées comme celles des Douze Juges, qui est le plus célèbre tribunal d’Angleterre. Cromwell subit la première rigueur de cette loi car il fut condamné sans avoir été entendu. Voici de quelle manière : Henri, commençant à se dégoûter d’Anne de Clèves, [154] résolut d’épouser une autre ; mais premièrement, il voulut perdre Cromwell, auteur de ce mariage ; on prit pour prétexte la liberté qu’il s’était donnée de signer au nom du roi un traité avec les protestants d’Allemagne contre l’empereur ; on lui fit son procès sans lui permettre de se défendre. Tout préparé pour la ruine de ce malheureux, le roi feignit d’avoir des affaires importantes à lui communiquer : Cromwell y vint, prit sa place au Parlement, [155] commença même à parler ; le duc de Norfolk [156] l’interrompit et lui dit qu’il le faisait prisonnier de la part du roi ; dix jours après, le roi l’ayant accusé lui-même, le Parlement condamna Cromwell à la mort, pour crime d’hérésie, de trahison et de félonie. Cet arrêt fut exécuté publiquement en 1540. [39]
- Moréri 1707, tome 2, page 546 – La mort de Dracon, [157] ancien législateur d’Athènes, fut glorieuse, mais également funeste : occupé à recevoir les acclamations du peuple pour les lois sages qu’il avait établies, il fut étouffé sous la quantité des robes et des bonnets qu’on lui jeta de tous côtés ; la manière ordinaire de prouver son estime était alors de jeter des robes et des bonnets sur celui à qui l’on voulait applaudir, comme si on eût voulu lui persuader qu’il était seul digne de porter les marques de l’autorité et les ornements de la justice. [40]
- Moréri 1707, tome 2, pages 117‑118 – Nos Anciens avaient une coutume que quelques gens ne seraient pas fâchés de voir rétablir : quand un homme devenait amoureux d’une femme, le mari lui cédait honnêtement plutôt que de se laisser emporter aux éclats d’une jalousie violente. Caton d’Utique [158] apprit qu’Hortensius [159] était amoureux de sa femme Martia, [160] il la lui céda avec une bonne grâce digne d’un tel philosophe ; sitôt qu’Hortensius fut mort, Caton reprit sa femme. Cela fournit occasion à César de lui reprocher qu’il l’avait donnée pauvre pour la reprendre quand elle serait plus riche. Des gens à qui ce trait d’histoire n’a pu échapper m’ont dit que s’il n’y avait plus de maris assez complaisants pour céder ainsi leur femme, il y en avait encore d’assez indulgents pour les reprendre après une infidélité publique. [41]
- Moréri 1707, tome 2, page 67 – On compte jusqu’à vingt mille personnes massacrées par l’ordre de l’empereur Caracalla ; [161] sa cruauté alla jusqu’à faire donner la mort aux médecins parce qu’ils ne l’avaient pas avancée à son père ; [162] il tua son frère Geta [163] entre les bras de sa mère ; le jurisconsulte Papinien, [164] qui n’avait voulu ni excuser ni défendre son parricide < sic >, fut aussi condamné à la mort. Se trouverait-il aujourd’hui des hommes assez intrépides, assez dévoués au bien de la justice, pour ne la pas trahir en faveur des grands, puisque même on s’abandonne aux sollicitations des particuliers qui savent à propos flatter l’intérêt. Caracalla avait plus d’un vice : outre les marques de sa cruauté, il en donna < bien d’autres preuves, et > je ne sais de quelle manière exprimer l’audace qu’il eut d’épouser Julie, [165] veuve de son père. Tant de crimes ne demeurèrent pas impunis : après six années d’un règne, funeste dès les premiers jours, il fut massacré par un de ses centeniers. [42]
- Moréri 1674, page 757 – Il y avait dans Sparte [166] une maison obscure où l’on enfermait les filles, et les jeunes hommes à marier venaient en prendre une au hasard. C’est pour cela que Lysandre [167] fut blâmé d’avoir quitté une fille laide qu’il avait prise ; le choix d’une plus belle fut regardé comme une désobéissance aux lois de la patrie. Le hasard à peu près semblable conduit les hommes dans leurs engagements, éblouis par la fortune, aveuglés par l’intérêt, ils prennent tout ce qui se présente et s’ôtent eux-mêmes la liberté de chasser le mérite personnel. [43]
- Moréri 1707, tome 3, pages 313‑314 – L’élection de Jean xxii, [168] successeur de Clément v [169] en 1316, se fit d’une manière qui n’a point d’exemple. Le Siège avait déjà vaqué plus de deux ans et les cardinaux assemblés à Carpentras [170] ne pouvaient se déterminer. Philippe le Long, comte de Poitiers, depuis roi de France, [171] alla à Lyon par ordre du roi son frère, Louis x, dit Hutin, [172] pour travailler à remplir le Siège vacant ; il agit avec tant de zèle et d’adresse qu’ayant assemblé tous les cardinaux à Lyon, il les enferma en conclave dans le couvent des Jacobins, [173] avec protestation qu’ils n’en sortiraient qu’après avoir nommé un pape. Ce compliment les étonna, et comme après quarante jours ils ne pouvaient s’accorder, ils donnèrent au cardinal Dossa le pouvoir de nommer celui qu’il voudrait ; il se nomma lui-même, disant Ego sum Papa ; cette élection fut approuvée de tous. Ce pape était fils d’un cordonnier de la ville de Cahors, [174] il se donna en sa jeunesse à Pierre, archevêque d’Arles, [175] chancelier de Charles ii, roi de Naples, comte de Provence ; [176] après la mort de ce prélat, Robert, [177] fils de Charles, lui donna les sceaux et le fit son chancelier. Depuis, il parvint à l’archevêché d’Avignon et deux ans après, il le fit cardinal. Louis de Bavière, [178] en 1328, étant à Rome, le fit dégrader de la papauté et substitua en sa place Pierre Ramuche de Corberia, [179] général des cordeliers. [180] Celui-ci, après diverses aventures, s’étant laissé prendre, fut mené à Avignon, [181] où il demanda pardon au pape, la corde au col. Jean xxii mourut en 1334, âgé de 90 ans ; on lui trouva la valeur de vingt-huit millions de ducats, et d’autres disent dix-sept cent mille florins d’or. [44][182]
- Moréri 1707, tome 2, page 636 – La philosophie donne quelquefois la constance qu’elle inspire. Épictète [183] reçut un grand coup sur la jambe ; il dit froidement à celui qui le lui donnait, « Prenez garde de la rompre » ; l’autre redoubla, en sorte qu’il lui cassa l’os ; Épictète lui répondit avec la même tranquillité : « Ne vous avais-je pas bien dit que vous jouiez à me rompre la jambe. »
La lampe de terre dont ce philosophe éclairait ses veilles fut vendue trois milles dragmes, c’est-à-dire près de deux cents livres de notre monnaie. [45]
- Moréri 1698, tome 2, page 123 – Charles Quint était plus grand coureur que grand conquérant. Il fit cinquante voyages différents : neuf en Allemagne, six en Espagne, sept en Italie, dix en Flandre, quatre en France, deux en Angleterre, deux en Afrique, autant sur l’Océan et huit sur la Méditerranée. [46]
- Moréri 1707, tome 4, page 873 – Les Romains placèrent l’Honneur au rang des divinités et lui érigèrent des statues. On les mettait ordinairement avec la Vertu. [184] Les temples étaient disposés de manière qu’on ne pouvait aller à celui de l’Honneur sans passer par celui de la Vertu. Marius, [185] qui les fit bâtir, ordonna qu’on ne les élevât pas beaucoup, pour insinuer aux personnes qui y entraient de demeurer toujours dans de bas sentiments d’eux-mêmes. Une réflexion que nous devons faire est celle-ci : il n’y a pas de plus belle gloire que celle où l’on parvient par des voies innocentes, il n’y a point de solide gloire que celle dont on jouit sans orgueil. [47]
- Moréri 1707, tome 2, page 27 – Jacques Callot [186] était un bon graveur, encore meilleur citoyen. Louis xiii [187] ayant assiégé la ville de Nancy [188] envoya quérir Callot et lui dit de représenter cette nouvelle conquête, comme il avait fait le siège de La Rochelle [189] et la prise de l’île de Ré. [190] Callot, qui était lorrain, supplia Sa Majesté de l’en dispenser parce qu’il avait trop de répugnance à faire quelque chose contre l’honneur de son prince et la reconnaissance qu’il devait à sa patrie. Le roi approuva cette délicatesse et estima le duc de Lorraine [191] d’avoir des sujets aussi affectionnés. Plusieurs courtisans portèrent Louis xiii à se faire obéir ; Callot, qui craignait qu’on le forçât de graver le siège de Nancy, répondit avec fermeté qu’il se couperait plutôt le pouce ; mais bien loin que le roi lui fît aucune violence, il continua de le traiter favorablement et lui promit 3 000 livres de pension s’il voulait demeurer en France ; Callot, peu tenté de ces offres, témoigna qu’il ne pouvait abandonner le lieu de sa naissance, il y mourut peu de temps après. [48]
- Moréri 1707, tome 1, page 218 – Les habitants d’Amyclas, [192] ville d’Italie, s’étaient si ridiculement attachés à la doctrine de Pythagore, [193] qui défend de tuer les animaux, qu’ils aimaient mieux se laisser piquer aux serpents et prendre la fuite que de faire mal à des insectes ; où on ajoute qu’ils se laissèrent égorger par leurs ennemis plutôt que de rompre le silence ; de là est venu le proverbe Amyclas perdidit silentiam < sic pour : silentium >. [49]
- Moréri 1707, tome 4, pages 167‑168 – Le mot pasquinade n’est inconnu à personne. [194] Celles de Monsieur Le Noble, [195] qui parurent vers la fin du dernier siècle, ont trop diverti le public pour ne pas lui avoir donné une idée juste de la signification de ce mot. En voici l’origine : dans une des places de Rome, il y avait une statue de marbre qu’on nommait Pasquin ; ce Pasquin était un savetier qui vivait il y a environ deux cents ans, il était railleur et raillait même assez finement ; sa boutique était remplie de gens qui prenaient plaisir à entendre les traits qu’il lançait contre toutes sortes de personnes ; après sa mort, on trouva sous terre, proche de sa boutique, une statue de gladiateur à laquelle, faute de savoir son nom, on donna celui de Pasquin ; elle fut élevée en cet endroit, l’on y attachait pendant la nuit des billets satiriques contre ceux dont l’on < n’>osait médire ouvertement. Cette licence continue, et même augmente de jour en jour. Il semble qu’elle soit autorisée car ces vers latins sont gravés sur le marbre :
Pasquinus eram, nunc lapis ;
Forsan Apis, quia pungo.
Dii tibi culeum, si spernis aculeum.
Etiam mellibus ungo : veritas dat favos ;
Et felle purgo. Si sapis,
Audi Lapidem,
Magis lepidum quam lividum.
Fruere salibus, insulse,
Ut bene sapias.
Calcibus calceos olim optavi,
Nunc rectos pedibus gressus inculco.
Abi in lapidicinam, si spernis lapidicinium. [50][196] - Moréri 1707, tome 1, page 610 – Le maréchal de Biron [197] se distingua par ses services importants sous le règne de Henri le Grand. [198] Ce prince l’honora de ses bonnes grâces et le combla de bienfaits. Monsieur Biron, dont l’esprit était violent et emporté, fit quelques remuements. La perte de la charge de grand amiral de France acheva de lui faire oublier ce qu’il devait au roi : il traita avec les ennemis de l’État ; son obstination fut si grande à avouer sa faute à Henri le Grand, qui l’en sollicita quatre fois, que Sa Majesté le mit entre les mains de la justice. Le maréchal, convaincu de lèse-majesté, fut condamné d’avoir la tête coupée, ses biens confisqués et la duché de Biron éteinte. On exécuta cet arrêt dans la cour de la Bastille [199] le 31 juillet 1602 et on enterra son corps dans l’église Saint-Paul. [51][200]
- Moréri 1707, tome 1, pages 149‑151 – Alexandre le Grand aimait fort les savants. Chacun sait l’estime qu’il faisait d’Homère ; il mit son Iliade [201] dans cette précieuse cassette qu’il trouva dans les dépouilles de Darius, [202] ut pretiosissimum animi humani opus quam maxime diviti opere servaretur ; c’est ainsi que Pline [203] en parle, dans le plus fort de ses conquêtes, temps où il avait besoin d’argent pour subvenir aux dépenses de la guerre. Il fit présent à Aristote [204] de quatre cents talents qui composent près de 150 000 livres de notre monnaie, et cela pour avoir les choses nécessaires aux expériences publiques. Lorsque ce prince ordonna qu’on mît tout à feu et à sang dans la ville de Thèbes, [205] il fit défense, en même temps, qu’on touchât à la maison où Pindare, [206] ce fameux poète grec, avait demeuré cent années auparavant ; cette seule maison fut conservée. [52]
- Moréri 1674, page 747 – Julien, dit l’Apostat [207] parce qu’il abandonna lâchement la religion chrétienne, et Gallus, [208] son frère, avaient reçu la cléricature dans un même temps et exercé les mêmes fonctions ; et étaient néanmoins d’une humeur très différente, et Dieu même montra ce qu’on devait craindre de l’impiété de Julien. Ils entreprirent de bâtir à frais communs une église en l’honneur du martyr Mammas ; [209] la portion que faisait faire Gallus fut bientôt achevée ; au contraire, l’ouvrage de Julien ne pouvait avancer, la terre repoussait toujours les fondements et une main invisible abattait durant la nuit les murailles qu’on avait élevées le jour. [53]
- Moréri 1674, page 913 – Maurice, [210] général des armées de l’empereur Tibère, empereur d’Orient, [211] ayant besoin de gens de guerre, ordonna en 592 que pas un soldat ne pourrait se faire moine qu’après avoir accompli le temps de la milice. Saint Grégoire, [212] qui trouvait cette loi injuste, en écrivit à l’empereur. Dans ce temps, un roi des Arabes < sic pour : Avares > [213][214] s’étant avancé dans la Thrace, [215] menaçait la ville de Constantinople [216] d’un siège terrible. La maladie contagieuse [217] qui se mit dans l’armée de ce barbare, et qui lui emporta les fils qu’il avait, l’empêcha d’avancer davantage. Il avait fait environ douze mille prisonniers, et comme on parlait de la paix, il offrit de les délivrer à condition que l’empereur donnerait un demi-écu pour la rançon de chaque soldat. Maurice le refusa et le prince barbare les fit tous passer au fil de l’épée. Le peuple de Constantinople, indigné de ce refus, se révolta. L’empereur témoigna un grand repentir et fit prier tous les saints ecclésiastiques et religieux d’offrir des vœux au ciel pour lui, afin que Dieu lui pardonnât et le punît plutôt en ce monde qu’en l’autre. Phocas, [218] qui, de simple centurion, s’était fort avancé à l’armée, se fit proclamer empereur en 601 et poursuivit Maurice jusques auprès de Calcédonie < sic pour : Chalcédoine >, [219] où il fit mourir quatre de ses fils, et ensuite il le fit mourir lui-même. On dit que, dans ce pitoyable état, il ne se plaignait jamais et qu’il prononçait seulement ces paroles de David : [220] Justus est Dominus et rectum judicium tuum, « Vous êtes juste Seigneur et votre jugement est équitable ». [54]
- Moréri 1707, tome 4, pages 339‑340 – Le tableau de Jalysus, fameux chasseur de l’île de Rhodes, [221] peint par Protogène, [222] conserva cette ville, et voici comment : Démétrius, roi de Macédoine [223], assiégeait Rhodes ; elle ne pouvait être prise du côté où était Protogène ; ce roi aima mieux lever le siège que d’y mettre le feu et de perdre un ouvrage qui devait être à jamais conservé. Les historiens ont remarqué une autre circonstance : Demetrius ayant su que Protogène avait choisi, pendant le siège, une maison hors de la ville, où il travaillait sans être distrait par les instruments de guerre ni épouvanté par la crainte des armes, fit venir ce peintre et lui demanda s’il se croyait en sûreté au milieu des ennemis des Rhodiens ; il répondit avec confiance, « Je suis persuadé qu’un grand prince comme Demetrius ne fait la guerre qu’à ceux de Rhodes, et non pas aux arts. » [55]
- Moréri 1707, tome 2, pages 193‑194 – François de Vivonne La Châte<g>neraye, [224] ayant reçu un démenti de Guy de Jarnac, [225] demanda au roi la permission de se battre ; la permission accordée par Henri ii, successeur de François ier, qui l’avait refusée, le combat [226] se fit le 10 juillet 1547 dans le parc de Saint-Germain. [227] Le roi voulut être témoin et toute la cour y assista. La Châte<g>neraye reçut plusieurs blessures qui le mirent bientôt hors de défense. Jarnac, qui pouvait le tuer, pria le roi d’accepter le don qu’il lui faisait de La Châte<g>neraye, qui ne voulut point se rendre. Le roi ordonna qu’il fût porté dans sa tente afin d’y être pansé. Le chagrin qu’il eut d’avoir été vaincu lui fit débander sa plaie, il mourut trois jours après. [56]
- Moréri 1707, tome 1, pages 359‑360 – Les ouvrages d’Aristote [228] ont eu un sort bien contraire : un concile tenu à Paris en 1209 ordonna que les livres de ce philosophe seraient brûlés, et fit défense de les lire sous peine d’excommunication, [229] parce qu’ils favorisaient, dit-on, les erreurs des hérétiques. En 1231, le pape Grégoire ix [230] renouvela les mêmes défenses jusqu’à ce qu’on eût revu et corrigé ce qui pouvait donner lieu aux hérésies. Albert le Grand [231] et saint Thomas d’Aquin [232] ne laissèrent pas néanmoins de faire des commentaires sur Aristote, on croit qu’ils en avaient une permission du pape. En 1448, le pape Nicolas v [233] approuva les ouvrages d’Aristote et en fit faire une nouvelle traduction latine. Depuis ce temps, on a continué d’enseigner sa doctrine ; et en 1624, ceux qui voulurent soutenir des opinions contraires furent condamnés par l’Université et par le Parlement de Paris. v [234] Tout cela prouve bien que les hommes ne décident pas avec lumières, et que la vérité ne se montre qu’imparfaitement à leur esprit. [57]
- Moréri 1674, page 623 – Hérode [235] poussa sa cruauté si loin qu’il entreprit de punir, même après sa mort, la joie qu’il savait que les Juifs en auraient. Il donna ordre d’égorger toutes les personnes de qualité qu’il tenait en prison, aussitôt qu’il aurait rendu l’esprit, afin que chaque famille considérable eût sujet de verser des larmes quand il sortirait du monde, et qu’on pût confondre leur douleur en l’attribuant à la perte de sa personne. [58]
- Moréri 1707, tome 2, pages 532‑533 – Une femme de Smyrne [236] fut accusée devant Dolabella, [237] proconsul dans l’Asie, d’avoir empoisonné [238] son mari parce qu’il avait tué un fils qu’il avait eu d’un premier lit. Dolabella se trouva embarrassé : il ne pouvait absoudre une femme criminelle, mais il ne pouvait aussi condamner une mère qui n’était devenue coupable que par un juste excès de tendresse. Il renvoya la connaissance de cette affaire à l’Aréopage, qui ne put la décider ; il ordonna seulement que l’accusateur et l’accusée, c’est-à-dire le mari et la femme, comparaîtraient dans cent ans pour être jugés en dernier ressort. [59]
- Moréri 1707, tome 1, page 125 – Le pape Urbain v [239] demanda un jour au cardinal Albornez [240] à quoi il avait employé les grandes sommes d’argent qu’on lui avait fait tenir pendant la conquête d’Italie. Le cardinal, à qui il était glorieux de rendre compte, fit amener un chariot chargé de gonds, de verrous, de serrures et de clés, et dit au Saint-Père : « Donnez-vous la peine de regarder dans la cour de votre palais, les sommes que vous m’avez envoyées ont été employées à vous rendre maître de toutes les villes dont vous voyez les clés dans ce chariot. » Le pape, charmé de la générosité d’Albornez, l’embrassa et le remercia des grands services qu’il avait rendus à l’Église. [60]
- Moréri 1707, tome 1, page 651 – La Bibliothèque de Saint-Victor [241] est un effet de la libéralité de M. du Bouchet, [242] conseiller au Parlement, mort en 1654, âgé de 61 ans. Il laissa ses livres au public par son testament, et les mit comme en dépôt entre les mains des chanoines réguliers de l’abbaye de Saint-Victor. [243] Il leur a légué un revenu considérable pour l’entretien et l’augmentation de cette bibliothèque. Messieurs les avocats généraux du Parlement, qu’il a suppliés de veiller à l’exécution de ses volontés, y font une visite tous les ans. Elle est ouverte le lundi, le mercredi et le samedi. [61]
- Moréri 1707, tome 1, page 625 – Monsieur Boileau, [244] intendant des menus plaisirs du roi et frère aîné de l’illustre Monsieur Despréaux, [245] montra dès sa première jeunesse beaucoup d’inclination pour l’étude. Il eut pour père Gilles Boileau, [246] greffier de la Grand’Chambre du Parlement de Paris. Cette profession engagea le fils à suivre le Palais, il exerça quelque temps celle d’avocat. Ennuyé peut-être de ce métier ingrat pour la fortune et presque incompatible avec les belles-lettres, il prit une charge à la cour. Son père mourut avec le seul titre d’homme de probité car il ne laissa pas beaucoup de bien à ses enfants. Voici une épigramme en forme d’épitaphe que fit Monsieur Boileau, son fils aîné, qui était alors très jeune et avocat nouvellement reçu :
« Ce greffier dont tu vois l’image,
Travailla plus de soixante ans ;
Et cependant, à ses enfants,
Il a laissé pour tout partage
Beaucoup d’honneur et peu d’héritage,
Dont son fils Laurent < sic pour : l’avocat > enrage. » [62] - Moréri 1707, tome 4, page 330 – Cambize, roi de Perse, [247] avait choisi Prexaspe [248] pour son confident. Ce favori, usant de la liberté que donne ce titre, s’avisa de remontrer à son maître que ses excès continuels obscurcissaient l’éclat de mille belles actions. Cambize, indigné de la licence de Prexaspe, résolut de s’en venger : quelques jours après, étant ivre, il tira une flèche dans le cœur du fils de cet indiscret confident, et lui demanda, pour lui insulter davantage, s’il connaissait quelqu’un qui eût plus d’adresse avant même que d’avoir bu. Prexaspe, pour ne pas irriter son roi, lui répondit qu’un dieu ne pouvait pas mieux tirer. Les hommes passent d’une extrémité à l’autre : Prexaspe reprend trop hardiment son maître, et ensuite il le loue d’une manière odieuse. La nature blessée devait lui arracher des termes d’indignation, mais la flatterie qui l’emporte sur ces sentiments lui fournit des expressions détestables. [63][249]
- Moréri 1674, page 66 – L’Antiquité a fourni de grands exemples de piété ; Plutarque et Valère Maxime donnent de grandes louanges à l’action de Luce Albin : [250] aussitôt qu’il aperçut le prêtre de Romulus et les vestales [251] qui emportaient à pied les images des dieux pour les sauver de la fureur impie des Gaulois vainqueurs, il fit descendre sa femme et ses enfants d’un chariot qu’il conduisait, pour mettre à leur place des personnes que leur titre lui rendait sacrées, préférant ainsi l’honneur de la religion au salut de sa famille. Il les mena jusqu’au bourg de Ceré [252] où ils se retiraient. [64]
- Moréri 1674, page 118 – Anaxarque, [253] philosophe, fut particulièrement estimé d’Alexandre le Grand, qui commanda de lui donner tout ce qu’il voudrait ; il demanda cent talents ; les officiers étonnés rapportèrent la chose à Alexandre ; ce prince ordonna qu’ils lui fussent comptés et il dit : Je connais qu’Anaxarque est de mes amis puisqu’il exige une chose digne de ma grandeur et de mon pouvoir. Ce fut ce philosophe qui détourna Alexandre de la folle pensée qu’il avait de se faire appeler dieu. Un jour qu’il était à la table de ce roi qui lui demandait ce qu’il disait du repas, il lui répondit qu’il n’y aurait rien à souhaiter si l’on avait servi la tête d’un certain grand seigneur ; en même temps, il regarda Nicocréon, tyran de Chypre, [254] son ennemi. Ce dernier en fut tellement offensé qu’après la mort d’Alexandre, il le fit piler dans un mortier avec des marteaux de fer. Le philosophe intrépide bravait la cruauté de ce tyran, et comme Nicocréon menaçait de lui couper la langue, Je t’en empêcherai, bien efféminé jeune homme, répondit Anaxarque : et en effet, l’ayant coupée avec ses dents et tournée durant quelque temps en sa bouche, il la jeta contre le visage du tyran qui en écuma de colère. Il faut avouer que la philosophie a quelquefois affecté des constances aussi rares que la religion est capable de produire. [65]
- Moréri 1707, tome 1, page 608 – Le philosophe Bion [255] était un homme à bons mots. Plutarque en rapporte quelques-uns, en voici les meilleurs : il n’approuvait pas le mariage, fondé sur ce qu’une laide faisait mal au cœur, et une belle, à la tête ; un grand lui demandait une grâce, il lui répondit : Si vous voulez que je vous l’accorde, faites-m’en prier, mais n’y venez pas vous-même. On ne sait, disait-il d’un envieux mélancolique, [256] s’il lui est arrivé du bien, ou du mal aux autres. [66]
- Moréri 1707, tome 1, pages 32‑36 – La plus majestueuse procession [257] que l’on ait jamais vue est celle qui se fit en 1535. Ce qui y donna lieu fut la hardiesse des hérétiques qui avaient semé publiquement des libelles remplis de blasphèmes horribles contre la Sainte Eucharistie, et de cruelles menaces contre la personne du roi, jusqu’à les afficher aux portes du Louvre [258] et à celles de la Chambre. François ier, qui était alors à Blois, [259] revint à Paris. Les auteurs et les complices d’un si abominable attentat furent pendus, [260] et on les décréta hérétiques. Il ordonna dans le même temps une procession solennelle pour réparer l’outrage fait à la religion. Tous les ordres religieux, tous les prêtres séculiers, le chancelier, le Conseil, le Parlement en robes rouges, la Chambre des comptes, les autres compagnies et la ville, avec ses officiers, y assistèrent. L’évêque de Paris, Jean Du Bellay, [261] tenait le Très-Saint-Sacrement sous un dais magnifique porté par Monseigneur le dauphin, [262] par ses deux frères, les ducs d’Orléans [263] et d’Angoulême, [264] et par le duc de Vendôme, [265] premier prince du sang. Le roi suivait immédiatement, tête nue et un flambeau à la main, accompagné des princes, des officiers de la Couronne, des cardinaux, évêques et ambassadeurs, marchant deux à deux ; et chacun tenait un cierge allumé. Cette auguste cérémonie fut mêlée d’une agréable et nombreuse symphonie. On alla ainsi jusqu’à Notre-Dame. [266] Le roi monta dans la grande salle de l’archevêché où, après s’être assis dans un trône magnifiquement préparé, il exhorta par un discours très pathétique les assistants à professer constamment la religion des rois très-chrétiens. Le même jour, vers le soir, six luthériens qui avaient été condamnés par arrêt du Parlement, furent brûlés à petit feu. Il semble que, par cette punition exemplaire, on voulût achever de réparer l’audace et l’impiété des profanateurs. [67][267]
- Moréri 1707, tome 2, page 245 – La loi Munérale dont Cincius, [268] sénateur romain, fut l’auteur, défendait à ceux qui briguaient les charges de paraître aux assemblées avec une double robe, sous laquelle ils pussent cacher de l’argent, comme ils avaient coutume de faire, pour acheter les suffrages du peuple, qui n’était que trop disposé à les vendre. [68]
- Moréri 1707, tome 2, pages 181‑182 – Toutes les histoires ensemble ne renferment rien d’aussi tragique que les troubles de la Grande-Bretagne, où il est parlé de la mort funeste de Charles Stuart. [269] Les Communes nommèrent un président et des commissaires pour lui faire son procès. Jean Couk, [270] procureur général, l’accusa au nom du peuple d’être tyran, meurtrier, ennemi irréconciliable des libertés d’Angleterre. Le roi, sommé de répondre, déclara qu’il ne reconnaissait point de tels juges. Cependant, il demanda un entretien avec les Seigneurs et avec les Communes. Cette grâce lui fut refusée. On le condamna d’avoir la tête tranchée. L’évêque de Londres ayant prêché le lendemain devant lui, les chefs des conjurés lui présentèrent un mémoire où les lois de la religion du royaume étaient entièrement blessées. Ils promirent, s’il le signait, de lui sauver la vie. Sa Majesté témoigna qu’elle préférait la mort la plus infâme à une aussi lâche complaisance. La Chambre des Communes, piquée de ce refus, ôta dès ce moment toutes les marques de la royauté, fit arracher les armes et briser la statue de Charles Stuart qui était dans la Bourse de Londres. Le mardi trent<ièm>e de janvier, sur les dix heures du matin, il fut conduit du palais de Saint-Jacques à celui de Witehal, environné d’un régiment d’infanterie qui marchait tambour battant, enseignes déployées. Le roi entra dans sa chambre ordinaire et se prépara à mourir chrétiennement. On a observé que l’Évangile de ce jour était le vingt-septième chapitre de saint Matthieu, [271] où est décrite la cabale des Juifs contre Jésus-Christ. L’échafaud dressé pour cette horrible exécution était couvert de drap noir. La hache était sur un billot, et le billot paraissait revêtu de quatre gros anneaux de fer pour y attacher le roi au cas de résistance. Le même < sic pour : menu > peuple accourut à ce funeste spectacle et n’eut pas le courage de s’opposer à la cruauté des conjurés. Le roi monta sur l’échafaud d’un air intrépide et déclara qu’il mourait innocent. Il aperçut deux scélérats masqués qui avaient été choisis pour exécuter cet abominable dessein, car l’exécuteur de haute justice avait refusé de tremper ses mains dans le sang de son roi. Sa tête fut abattue d’un seul coup. Elle fut mise avec son corps dans un cercueil de plomb. L’évêque de Londres le conduisit à Windsor et le fit mettre dans la chapelle royale, auprès de Henri viii, sans autre inscription que celle-ci, Charles, roi d’Angleterre, parce que les conjurés ne permirent pas les cérémonies ordinaires. Ainsi finit ce juste et malheureux prince dans la quarante-neuvième année de son âge et dans la vingt-cinquième année de son règne. Le lendemain de sa mort, arrivée le 30 janvier 1649, les Communes défendirent sur peine de trahison de proclamer roi le prince de Galles, [272] et ordonnèrent que la Nation serait gouvernée comme une république par un Conseil de quarante personnes choisies. Cromwell [273] sut habilement se rendre maître de toute l’autorité. [69]
- Moréri 1707, tome 2, page 652 – Eschine, [274] Athénien de nation, fut aussi bon poète qu’orateur. Les Grecs donnèrent les noms des trois Grâces à trois oraisons qui restent de lui, et celui des neuf Muses à neuf de ses épîtres ; ce qui a été fait de même en faveur de l’Histoire d’Hérodote. Eschine ne voulait pas de bien à Démosthène ; [275] dans l’impuissance de se venger ouvertement, il accusa Ctésiphon qui le protégeait. Démosthène défendit sa cause, Eschine fut exilé, il vint à Rhodes [276] où il enseigna la rhétorique. Un jour qu’il lisait devant les Rhodiens sa pièce contre Ctésiphon, il en reçut des louanges extraordinaires, ils ne pouvaient s’imaginer qu’il avait été envoyé en exil. Après avoir prononcé cette harangue, Eschine, bien loin de se prévaloir de tant d’applaudissements qui semblaient favoriser sa jalousie contre Démosthène, leur répondit modestement : « Vous ne seriez point surpris si vous aviez entendu Démosthène. » Par ce procédé honnête et généreux, il persuada que la haine ne le dominait point assez pour le rendre injuste. L’envie qui règne aujourd’hui parmi les savants ne leur inspire pas la même modération, ils méprisent tout ce qu’ils n’ont point fait et ne peuvent jamais croire que leurs concurrents soient dignes de louanges. [70]
- Moréri 1707, tome 2, page 235 – Un des capitaines de Cyrus [277] nommé Chrysante [278] était si exact observateur de la discipline qu’ayant son ennemi en sa puissance, il lui fit grâce et ne voulut pas le tuer parce qu’il entendit sonner la retraite. Cyrus loua cette action. [71]
- Moréri 1707, tome 2, page 497 – Démonice, jeune fille éphésienne, [279] promit à Brennus, [280] prince des Gaulois, de lui livrer la ville d’Éphèse, [281] pourvu qu’il lui donnât tous les joyaux de cette ville. Brennus les lui promit. Aussitôt qu’Éphèse fut prise, il commanda à ses soldats de jeter dans le sein de Démonice tous les joyaux qu’ils avaient pillés. La quantité en était telle que cette fille en fut accablée, et se trouva ensevelie dans les colliers, les bracelets et les diamants. [72]
- Moréri 1707, tome 1, page 508 – C’est abuser de la victoire que de la signaler par des cruautés. Basile second, [282] dit le Jeune, empereur d’Orient surnommé le Dompteur des Bulgares, eut en 1013 un grand avantage contre Samuel, [283] qui était leur prince. L’empereur tua une partie de ses troupes et lui prit quinze mille prisonniers. On peut dire qu’ils furent plus malheureux que ceux qui moururent les armes à la main, car Basile leur fit crever les yeux et donna un borgne pour guide à chaque compagnie de cent hommes. Il les envoya ainsi à Samuel, qui mourut de déplaisir après les avoir vues. Cette barbare action a beaucoup diminué la gloire de Basile, qui d’ailleurs était illustre par l’éclat de quelques vertus. Il mourut subitement après un règne de cinquante années. [73]
- Moréri 1707, tome 3, page 176 – L’Histoire des amours de Théagène et de Cariclée a pour auteur Héliodore de Phénicie, [284][285] qui vivait dans le quatrième siècle. Il composa ce livre dans sa jeunesse et fut depuis élevé à l’épiscopat. Cette dignité, qui le vouait entièrement aux choses saintes, ne le rendit pas insensible à la gloire criminelle d’avoir fait un ouvrage profane. Il ne voulut ni le supprimer ni le désavouer. Cet entêtement obligea les évêques de Thrace assemblés de le déposer. Il n’y a pourtant que Nicéphore [286] qui parle de cette déposition prétendue, les autres n’en disent mot. [74]
- Moréri 1707, tome 4, page 260 – Simon, convaincu d’un crime, fut condamné à mourir de faim dans une prison. Sa fille obtint du geôlier la permission de le voir tous les jours, elle lui donnait à téter et lui sauva ainsi la vie. Le geôlier, surpris qu’un homme qui ne mangeait point vécût aussi longtemps, car il empêchait avec soin que cette fille ne lui portât aucune nourriture, examina ce qu’elle faisait avec son père. Il s’aperçut qu’elle lui présentait ses mamelles comme à un enfant. [287] Cette action fut rapportée aux juges, ils firent grâce au père coupable en faveur de la fille tendre et reconnaissante, et assignèrent à l’un et à l’autre une pension. Le lieu où était cette prison fut consacré par un temple à la déesse Piété, [288] on y peignit un tableau qui représentait l’action dont l’on vient de parler. Les copies de ce tableau, qu’on appelle une Charité romaine, sont nombreuses. [289] Comme on prétend que celle qui nourrissait son père était fille, on regarde comme un miracle de la nature le secours qu’elle procurait à son père. [75][290]
- Moréri 1707, tome 3, pages 56 et 335 – Le corps de Germanicus [291] ayant été brûlé selon la coutume des Romains, son cœur parut tout entier au milieu des flammes. On a remarqué la même chose de la Pucelle d’Orléans. [292] À l’égard de Germanicus, il y avait une circonstance particulière : l’empereur Tibère [293] le fit empoisonner par le ministère de Pison, gouverneur de Syrie, [294] et c’est l’opinion commune que cette partie étant une fois imbue de venin ne peut jamais être consumée par la violence du feu. [76]
- Moréri 1707, tome 2, page 195 – Paul du Chastelet, [295] avocat général au parlement de Rennes, [296] depuis maître des requêtes et enfin conseiller d’État, était fort considéré de Louis xiii. Un jour qu’il sollicitait avec chaleur la grâce du duc de Montmorency, [297] le roi lui dit : « Je pense que Monsieur du Chastelet voudrait avoir perdu un bras pour sauver Monsieur de Montmorency » ; il fit cette belle et prompte réponse, « Je voudrais, Sire, les avoir perdus tous deux car ils sont inutiles à votre service, et en voir sauvé un qui vous a gagné des batailles et qui vous en gagnerait encore. »
Monsieur Pellisson remarque de lui un autre trait : Monsieur du Chastelet avait été conduit à Villepreux [298] par les ordres du roi ; quelque temps après être sorti de cette prison, il revint à la cour ; le roi feignit de ne le pas regarder, comme par une espèce de chagrin de voir un homme qu’il venait de punir ; Monsieur du Chastelet s’approcha de Monsieur de Saint-Simon [299] et lui dit : « Je vous prie, Monsieur, de dire au roi que je lui pardonne de bon cœur, et qu’il me fasse l’honneur de me regarder. » Ce trait fit plaisir au roi, il fit bonne mine à Monsieur du Chastelet et le caressa. [77]
- Moréri 1674, page 338 – Valère Maxime parle de deux frères nommés Coëlius [300] qui, accusés d’avoir tué leur père, Titus, qu’on avait trouvé égorgé dans une chambre voisine de la leur, furent renvoyés parce qu’on les avait surpris dans un tranquille et profond sommeil. Les juges ne purent jamais se persuader que la nature, toujours la première à nous reprocher certains crimes, permît à des parricides un repos que de moindres coupables n’auraient pas eu. En effet, on est agité malgré soi, le trouble au cœur s’empare du visage, il saisit toute la personne du criminel, et < sic pour : qui > s’accuse par son propre silence ; où s’il parle, c’est plutôt pour hâter sa condamnation que pour travailler à sa défense. [78]
- Moréri 1674, page 642 – Hunéric, [301] roi des Vandales en Afrique, qui vivait dans le cinquième siècle, a été un des plus grands persécuteurs de l’Église : à la persuasion d’un évêque arien, [302] il bannit près de cinq mille ecclésiastiques, publia divers édits contre les catholiques et en fit mourir jusqu’à quatre cent mille par des tourments inouïs. Son frère et ses enfants furent les victimes de sa cruauté. [79]
- Moréri 1707, tome 3, page 475 – Jean de Launoy, [303] docteur < en théologie > de Paris, de la Maison de Navarre, [304] originaire de Normandie, au diocèse de Coutances, [305] est mort en 1678 après avoir passé sa vie dans un travail continuel. Il n’y a pas d’homme qui ait plus écrit que lui : il a laissé près de 70 volumes de sa façon, presque tous en latin. Il était bon critique, il avait beaucoup profité des entretiens familiers qu’il avait avec le Père Sirmond. [306] Il a combattu presque toutes les anciennes traditions des églises de France, fondant son sentiment sur les époques de Sulpice-Sévère [307] et de Grégoire de Tours. [80][308]
- Moréri 1707, tome 1, page 365 – François Armellino [309] naquit à Pérouse [310] de parents peu illustres. Il résolut de s’établir à Rome, où il commença par solliciter des procès. Il se rendit habile maltôtier, cette industrie le fit connaître au pape Léon x. [311] Ce pontife, satisfait des moyens qu’Armellino donnait pour trouver de l’argent, le créa cardinal en 1517, lui donna un gouvernement et le fit intendant de ses finances. Cette élévation lui suscita des envieux et son nom devint en exécration parmi les peuples ; jusque-là que dans un consistoire où l’on parlait de chercher un fonds pour subvenir aux nécessités de l’Église, le cardinal Pompée Colonna [312] dit hautement : « Il ne faut que faire écorcher Armellino et exiger un quatrain de tous ceux qui seront bien aises de voir sa peau. L’argent qu’on en tirera produira une somme considérable. » Mais le cardinal de Médicis, dans la famille duquel il avait été adopté, prit son parti ; et ayant depuis été élevé au pontificat sous le nom de Clément vii, il le gratifia de l’archevêché de Tarente [313] et de plusieurs autres bénéfices considérables. Bientôt après, il fut assiégé avec le pape dans le château Saint-Ange [314] et il mourut de déplaisir d’avoir perdu tous les amis qu’il avait à Rome, dans le temps que les Impériaux s’en rendirent maîtres. Le pape se consola de cette mort qui lui procurait deux cent mille écus en terres, il s’en servit pour payer sa rançon car Armellino mourut sans avoir fait de testament. [81]
- Moréri 1707, tome 2, page 94 – Jean de Carvayal, [315] gentilhomme espagnol injustement accusé d’avoir commis un meurtre, fut précipité, par ordre de Ferdinand, roi de Castille, [316] du haut d’un rocher. [317] On remarque qu’avant son exécution, il ajourna ce prince trop crédule à comparaître devant le Tribunal de Dieu dans trente jours, et que trente jours après son exécution, Ferdinand mourut subitement. [82][318]
- Moréri 1707, tome 2, page 41 – Lorsque Félix Peretti, depuis appelé le cardinal de Montalte, eut été créé pape sous le nom de Sixte v, [319] la Signora Camilla, [320] sa sœur, fut mandée à Rome. Quelques cardinaux, avertis de son arrivée, jugèrent à propos d’aller au devant d’elle ; et croyant faire leur cour au pape, ils firent habiller en princesse cette sœur qu’il aimait avec distinction ; ils la présentèrent ainsi au pape ; mais Sixte v, surpris de la voir dans un tel équipage, feignit de ne la pas connaître ; Camilla, qui s’aperçut de la délicatesse de son frère, parut le lendemain au Vatican avec ses habits ordinaires ; alors le pape l’embrassa et lui dit : « Vous êtes à présent ma sœur, et je ne prétends pas qu’un autre que moi vous donne la qualité de princesse. » Il la pria de ne lui demander aucune grâce, chose qu’elle observa avec tant d’exactitude qu’elle se contenta d’obtenir des indulgences pour une confrérie dont on l’avait faite protectrice. [83][321]
- Moréri 1707, tome 3, pages 272‑273 – Jean Hus, [322] qui renouvela dans le xive siècle les erreurs des vaudois [323] et de Wiclef, [324] fut condamné en 1415 à être brûlé avec ses livres. Un auteur de sa suite, qui était présent à son supplice, dit que Jean Hus monta sur le bûcher avec une intrépidité extraordinaire et qu’il mourut en chantant des psaumes et invoquant le nom de Jésus-Christ. Nous, qui sommes persuadés de la vérité de notre religion, aurions-nous à la défendre le même zèle qu’ont les hérétiques à soutenir leurs erreurs ? [84][325]
- Moréri 1707, tome 1, page 372 – Monsieur < Arnauld > d’Andilly, [326] père de Monsieur Arnauld de Pomponne, [327] secrétaire d’État et ambassadeur en Suède, quitta le monde à l’âge de 55 ans, et il se retira en l’abbaye de Port-Royal-des-Champs, [328] où sa mère, [329] six de ses sœurs et cinq de ses filles ont été religieuses. C’est pendant tout ce temps qu’il a fait ces excellentes traductions imprimées en 8 volumes in‑fo. Il a vécu près de 86 ans. [85]
- Moréri 1707, tome 1, page 656 – François Brian, [330] chevalier de l’Ordre < de la Jarretière > [331] et de la Maison de Bouillon < sic pour : Boulen >, connu sous le nom de Vicaire infernal, y reçut ce titre de Henri viii, roi d’Angleterre. Ce prince, dont les désordres ont fait la honte du siècle où il a vécu, avait habitude avec la femme de Thomas Boulen, il en eut deux filles qu’il aima, dont il eut ensuite des enfants. Demandant un jour à François Brian si c’était un grand crime d’entretenir la mère et la fille, Brian, qui n’avait pas l’âme fort scrupuleuse, répondit : « C’est comme si l’on mangeait la poule et le poulet. » Le roi ayant trouvé cette réponse plaisante, lui dit qu’il le prenait pour son Vicaire infernal, le nom lui en est resté. [86]
- Moréri 1707, tome 2, page 28 – Ce fut une certaine femme romaine, nommée Calpurnia, [332] qui plaida elle-même sa cause avec tant d’emportement et si peu de pudeur que les magistrats furent obligés de faire un édit par lequel ils défendaient aux femmes de plaider. [87]
- Moréri 1707, tome 3, page 489‑85 – Léon l’Isaurien, [333] empereur de Constantinople, se nommait auparavant Conon, dans le temps qu’il n’était que petit mercier. Portant ses marchandises de village en village, il fut rencontré par deux magiciens qui lui prédirent qu’il parviendrait à l’Empire. Il quitta son métier et s’enrôla. Après s’être signalé par quelques actions, il acquit la confiance de Justinien. [334] Celui-ci fut assassiné ; Bardanès, [335] son successeur, eut les yeux crevés ; Artemius, proclamé empereur sous le nom d’Anastase, [336] donna l’armée et la préfecture de l’Orient à Léon ; Théodose, [337] à qui Artemius avait été contraint de céder l’Empire, y renonça quelque temps après en faveur de Léon. Ainsi fut accomplie la prédiction des deux magiciens. Ce Conon persécuta l’Église et introduisit l’hérésie des Iconoclastes. [88][338]
- Moréri 1707, tome 2, pages 519‑520 – Chacun raconte à sa fantaisie l’histoire de Lucrèce. [339][340] Ceux qui ne la peuvent point révoquer en doute y donnent des interprétations malignes ; mais voici un trait de vertu qu’il est, ce semble, impossible de ne pas admirer : lorsque la ville d’Aquilée [341] en Italie fut prise par Attila, [342] une femme nommée Dugna, [343][344] voyant que ce prince, charmé de sa beauté, formait des desseins sur son honneur, le pria de monter dans une haute galerie, comme si elle eût voulu lui communiquer un secret important ; aussitôt qu’elle se vit en un lieu propre à se jeter dans la rivière qui arrosait les murailles du palais, elle se précipita en criant à ce barbare « Suis-moi si tu veux me posséder ! » Voilà une résolution bien hardie et un exemple de chasteté hors de tout soupçon. [89][345][346]
- Moréri 1707, tome 3, page 720 – François de Meinard, [347] de l’Académie française, [348] était de très bonne famille. Il fut président au présidial d’Aurillac [349] et on l’honora avant sa mort d’un brevet de conseiller d’État ; et fut secrétaire de la reine Marguerite, [350] ami de Des Portes, [351] camarade de Régnier, [352] et disciple de Malherbe. [353] Il fut connu très particulièrement du pape Urbain viii, [354] qui prenait plaisir de s’entretenir souvent avec lui de belles choses, et qui lui donna un exemplaire de ses poésies latines écrit de sa propre main. Le cardinal de Richelieu le connaissait, jamais il ne lui a fait de bien ; Meinard lui présenta un jour cette épigramme :
« Armand, l’âge affaiblit mes yeux,
Et toute ma chaleur me quitte,
Je verrai bientôt mes aïeux,
Sur le rivage du Cocyte. [355]C’est où je serai des suivants
de ce bon monarque de France,
Qui fut le père des savants,
En un siècle plein d’ignorance. [356]Dès que j’approcherai de lui,
Il voudra que je lui raconte
Tout ce que tu fais aujourd’hui
Pour combler l’Espagne de honte.Je contenterai son désir
Par le beau récit de ta vie,
Et charmerai le déplaisir
Qui lui fit maudire Pavie. [357]Mais s’il demande à quel emploi
Tu m’as occupé dans le monde,
Et quels biens j’ai reçus de toi,
Que veux-tu que je lui réponde ? »Le cardinal rebuta cette épigramme et il répondit brusquement, contre sa coutume, au dernier vers : « Rien ! » Cela fut cause des pièces que Meinard fit contre lui après sa mort. [358] Quelque temps avant la sienne, il avait fait mettre sur la porte de son cabinet cette inscription, qui témoignait son dégoût pour la cour et pour le siècle :
« Las d’espérer et de me plaindre,
Des Muses, des grands et du sort,
C’est ici que j’attends la mort,
sans la désirer ni la craindre. » [90] - Moréri 1707, tome 2, pages 421‑422 – Crœsus, [359] roi de Lydie, [360] eut trois fils, dont l’histoire a remarqué trois choses fort particulières. L’aîné, mis en otage dans le palais de Cyrus, trouva le secret de machiner une trahison contre ce roi ; elle fut bientôt découverte ; Cyrus, offensé de cette témérité, le fit tuer aux yeux mêmes de son père. Le puîné était muet ; Crésus consulta l’oracle sur sa cause et la durée de ce défaut naturel ; la réponse qu’il reçut fut qu’il ne devait pas souhaiter que son fils cessât d’être muet parce que le moment le plus malheureux de sa vie serait le moment où ce fils commencerait d’avoir l’usage de la parole ; la prédiction de l’oracle s’accomplit quelque temps après, car le jour même que Sardes, [361] capitale des États de Crésus, fut assiégée, un soldat persan, levant son cimeterre pour le tuer, le prince muet trouva, par un effort de crainte et de tendresse, moyen de s’expliquer ; la nature, qui le lui avait refusé, lui suggéra aussitôt ces paroles : « Arrête, soldat, ne porte point la main sur mon père » ; depuis ce moment, il continua de parler. Au contraire, le dernier des trois de Crésus eut de bonne heure la facilité de s’énoncer ; dès le berceau, il s’exprimait distinctement. [91]
- Moréri 1707, tome 1, pages 5‑6 – Pierre Abélard, [362] qui vivait dans le douzième siècle, fut estimé comme un des plus beaux esprits de son temps. Pendant qu’il enseignait la théologie à Paris, il s’instruisait chez un chanoine nommé Fulbert, [363] dont la nièce avait beaucoup d’inclination pour les hautes sciences. Cette fille, qu’on appelait Héloïse, [364] ne résista point à la passion qu’Abélard avait conçue pour elle. Leur amour éclata, et les preuves de leur commerce devinrent publiques. Fulbert prit le parti de chasser Abélard de sa maison, et Héloïse prit aussitôt celui de l’aller trouver en Bretagne, où elle accoucha d’un fils. Ils revinrent à Paris, le docteur fit à sa maîtresse des propositions de mariage ; elle refusa de les agréer, ne voulant priver l’Université d’un si habile professeur, ni l’Église, d’un homme qui devait devenir un de ses premiers ornements. Ces raisons touchèrent peu Abélard, il épousa Héloïse en secret et il la mit chez les religieuses d’Argenteuil. [365] Fulbert se plaignit et après avoir intéressé son valet à venger un tel outrage, il le fit eunuque. [366] Ce malheur le couvrit de honte. Pour la cacher, il se retira dans l’abbaye de Saint-Denis, [367] où il prit l’habit de religieux après qu’Héloïse eut fait profession dans le monastère d’Argenteuil. Les affaires que sa doctrine équivoque lui suscita l’obligèrent de sortir de l’abbaye. Il établit enfin son séjour dans le diocèse de Troyes, [368] il nomma son oratoire le Paraclet, [369] pour exprimer les douze consolations dont le Saint-Esprit le comblait. Sa solitude fut bientôt remplie d’un grand nombre de disciples, que sa réputation lui attirait de toutes les parties de l’Europe. Alors Suger, [370] abbé de Saint-Denis, persuadé que les religieuses d’Argenteuil ne vivaient pas régulièrement, les fit sortir de ce monastère, où il envoya des bénédictins. [371] Abélard offrit le Paraclet à Héloïse, elle s’y retira et vécut très saintement. Ce grand homme entretint avec elle ce pieux commerce de lettres, où il lui donne une forme de vie religieuse et l’éclaircissement de quelques endroits de l’Écriture. Sa subtilité parut suspecte à saint Bernard [372] et l’exposa à la censure d’un concile provincial. Abélard en appela au pape et il prit le chemin de Rome, et s’arrêta à l’abbaye de Cluny [373] où Pierre le Vénérable [374] lui donna l’habit de cet Ordre. [375] Ce docteur, soumettant toutes ces lumières à la pure vérité, songea moins à paraître savant qu’à vivre en saint. Ses grandes austérités abrégèrent le cours de sa vie, elle ne dura que soixante et trois ans, et fut terminée en 1145. Pierre le Vénérable apprit cette triste nouvelle à Héloïse, elle la reçut avec une tranquillité chrétienne et demanda, pour toute consolation, le corps de ce grand homme. L’abbé le lui envoya et le fit enterrer dans l’église du Paraclet. [92]
- Moréri 1707, tome 4, pages 669‑670 – Dresser des statues pour rendre éternelle la mémoire des hommes : il semble que cela n’était dû qu’aux grandes actions ; cette rare récompense du mérite est devenue peu à peu une invention ordinaire de la flatterie. Les Grecs établirent les premiers l’usage des statues ; il passa dans l’Italie : les statues de Romulus [376] et de ses successeurs, mises dans le Capitole, [377] furent presque les seules que l’on vit à Rome pendant qu’elle était gouvernée par les rois : celles de Brutus [378] et d’Horatius Coclès, [379] et plusieurs < autres > parurent bientôt après ; il en parut un si grand nombre que le Sénat ordonna qu’on ôterait des places publiques celles qui auraient été érigées sans son ordre ou sans l’aveu du peuple. Cette ordonnance ne fut observée que jusqu’au temps des empereurs. On vit alors plus de statues qu’auparavant. Les femmes obtinrent le droit de mettre les leurs dans les provinces, et même dans Rome. Les temples et les palais, les portiques, les amphithéâtres, les thermes et les places publiques étaient remplis de statues que le mérite ou la flatterie avait élevées. De là vint cette agréable raillerie d’un Ancien : « Il y avait dans Rome un peuple de marbre et de bronze qui égalait le nombre des citoyens. » La vanité, peu satisfaite du marbre et du bronze, employa l’argent sous le règne d’Auguste. Ses successeurs voulurent que les statues qui leur seraient consacrées dans le Capitole fussent d’or : Caligula, Claudius [380] et Commode [381] n’en voulurent point d’autres. Cette magnificence éclata encore sur la fin du quatrième siècle : Arcadius [382] fit faire la statue de l’empereur Théodose, [383] elle pesait sept mille quatre cents livres d’argent. [93][384]
- Moréri 1707, tome 2, page 492 – Demetrius Phalereus, [385] philosophe péripatéticien [386] qui vivait du temps d’Alexandre le Grand, a lui seul eu autant de statues que l’ambition de plusieurs en pouvait désirer. La ville d’Athènes lui en érigea trois cent soixante, dont plusieurs étaient élevées sur des chariots attelés à deux chevaux ; de toutes ces statues, il n’y en eut point qu’il ne méritât ; l’envie lui suscita bientôt après des persécuteurs, on conspira contre lui, il prit la fuite, on le condamna à mort ; ses ennemis, fâchés de ne le pouvoir prendre, renversèrent ses statues ; Demetrius l’ayant su, s’en moqua et dit : « J’ai sujet de me consoler du tort que mes ennemis font à mes statues, puisqu’ils n’ont point de pouvoir sur la vertu qui les a fait élever. » [94]
- Moréri 1707, tome 2, page 612 – Éleogabala [387] eut la plaisante et ridicule idée d’établir un Sénat de femmes pour juger les causes des personnes de ce sexe. Sa mère en était la présidente ; il eut ce dessein tellement en tête qu’il fit mourir plusieurs sénateurs qui ne l’avaient pas approuvé. [95] Les femmes ont peut-être souhaité de ne pouvoir être citées qu’à un tel tribunal, mais il leur serait moins favorable que celui des hommes : là, on n’aurait aucun égard à leur jeunesse, à leurs charmes, au lieu qu’une belle solliciteuse trouve le moyen de se rendre son juge favorable.
- Moréri 1674, pages 248‑249 – Jérôme Cardan, [388] médecin et astrologue de Milan, [389] vivait dans le seizième siècle. Il a beaucoup écrit. Sa vie est à la tête de ses ouvrages : quoiqu’il en soit l’auteur, il y rapporte, avec une sincérité admirable, il ne feint point de se dire illégitime. On sait que Jules Scaliger [390] fut son ennemi irréconciliable. Cardan avait pronostiqué l’an et le jour de sa mort ; le temps qu’il avait marqué étant arrivé, il jugea à propos de ne plus manger, afin de n’avoir pas le démenti de ses prédictions. Ainsi, l’amour de sa réputation l’emporta sur le plaisir de vivre : il mourut âgé de 75 ans ; sans doute aurait-il vécu davantage s’il avait eu moins d’entêtement de sa fausse science. [96][391][392]
- Moréri 1707, tome 2, pages 541‑542 – On voit des procureurs faire fortune, mais on n’en a jamais vu une pareille à celle de Jean de Dormans, [393] qui vivait en 1347. L’aîné de ses enfants fut évêque de Beaumont < sic pour : Beauvais >, [394][395][396] peu après cardinal, ensuite chancelier de France, [397] enfin légat du pape Grégoire x < sic pour : xi >, pour travailler à la paix entre le roi Charles v [398] et le roi d’Angleterre ; [399] c’est lui qui est le fondateur du Collège de Saint-Jean de Beauvais. [400] Le second des enfants de Jean de Dormans fut d’abord avocat général au Parlement de Paris, et puis chancelier ; [401] celui-ci eut plusieurs enfants, dont l’un eut aussi l’honneur de remplir cette première place de la justice. [402] En sorte que de la famille d’un procureur sont sortis trois chanceliers, un cardinal, un archevêque, car le troisième fils de Jean de Dormans eut premièrement l’évêché de Meaux [403] et bientôt après l’archevêché de Sens. [404][405] Jamais tant de dignités ne se sont rassemblées dans une famille plus obscure ni plus indigne. [97]
- Moréri 1707, tome 3, page 413 – Le pape Jules ii, dit auparavant Julien de la Rouvère, [406] avait l’esprit fort porté à la guerre. Il prit le nom de Jules en mémoire de Jules César, [407] et par l’imitation de celui d’Alexandre vi < sic pour : v >. [408] On ajoute que contre la coutume de ses prédécesseurs, il portait une longue barbe pour se rendre plus terrible à ceux qui le regardaient. Le pape capitaine commandait lui-même ses armées. Peu s’en fallut qu’un coup de canon ne l’emportât, il fit pendre le boulet dans l’église de Lorette. [409] La perte de la bataille de Ravenne, en 1512, [410] l’affligea beaucoup, son légat y fut fait prisonnier. [98] Il me semble que l’épée et l’Église sont deux professions qui ne sympathisent guère : quand les hommes veulent ainsi se transplanter, et de pape devenir capitaines, il faut donc choisir des prélats parmi les officiers.
- Moréri 1674, page 716 – Quand Innocent iii [411] fut élevé au pontificat, il n’était que diacre. Avant son couronnement on le sacra prêtre, puis évêque. On eut peine à le faire consentir à son élection, il ne l’accepta qu’après avoir eu des marques visibles de la volonté de Dieu. Ce pape refusa de se servir de vaisselle d’argent, il en fit distribuer le prix aux pauvres qu’il servait lui-même à table, et il se contenta d’en avoir de bois et de terre : grands exemples qui tentent peu de prélats ! [99]
- Moréri 1707, tome 3, page 480 – Leone < sic pour : Leene >, [412] femme courtisane d’Athènes, vivait en la soixante-sixième olympiade. Elle sut la conspiration d’Harmodius et d’Aristogiton, [413] de la famille d’Alenteon < sic pour : Alcméon >, [414] opposée à celle de Pisistrate. [415] Cependant, elle aima mieux se couper la langue avec les dents que de découvrir les coupables. Les Athéniens élevèrent en son honneur une lionne sans langue. [100][416]
- Moréri 1674, page 839 – Tertullien [417] et saint Jérôme [418] se servent fort souvent de l’exemple de Lucresse < sic pour : Lucrèce > pour persuader la pureté aux femmes chrétiennes. Saint Augustin [419] et quelques autres ont improuvé sa fureur, et c’est en ce sens que René Laurens [420] a publié cette belle épigramme :
Si fuit ille tibi Lucretia gradus < sic pour : gratus > adulter,
Immerito < sic pour : immerita > ex merita præmia morte petis.
Sin potius casto vis est allata pudori
Quis furor est, hostis crimine velle mori ?
Frustra igitur laudem captas, Lucretia : namque
Vel urina revis < sic pour : furiosa ruis >, vel scelerata cadis. [101][421] - Moréri 1674, page 785 – Ce fut Léonidas, premier de ce nom, [422] roi des Lacédémoniens, qui défendit le détroit des Thermopytes < sic pour : Thermopyles > [423] contre une armée effroyable de Perses, conduite par Xerxès. [424] Il s’opposa à leur passage avec trois cents hommes seulement. Tous, à la vérité, aussi bien que Léonidas, y perdirent la vie, mais est-ce mourir que d’acquérir une gloire immortelle ? On dit que quand Léonidas partit de Sparte, sa femme lui demanda s’il n’avait rien à lui recommander : « Rien, répondit Léonidas, sinon que tu te remaries après ma mort à quelque grand homme, de qui tu aies des enfants qui me ressemblent. » Ce fut ce même roi qui fit cette réponse, aussi ingénieuse qu’intrépide, que tout le monde admire : quelqu’un disait pour l’étonner que le soleil serait obscurci des flèches des Perses, « Tant mieux, dit-il, nous combattrons à l’ombre ! » Voici un autre trait qui marque encore une grande âme : Xerxès lui ayant mandé qu’en s’accommodant avec lui, il lui donnerait l’empire de la Grèce, « J’aime mieux, dit-il, mourir pour mon pays que d’y commander injustement. » Quand on lui demandait pourquoi les braves gens préféraient la mort à la vie, la raison qu’il en donnait était « qu’ils tiennent celle-ci de la Fortune, [425] et l’autre, de la Vertu ». [102]
- Moréri 1674, page 793 – Il y avait du temps de Cicéron [426] un orateur aussi célèbre que lui, il s’appelait Caius Licinius Calicus < sic pour : C. Licinius Calvus >, [427] fils d’un des meilleurs poètes de son temps. Ses invectives étaient si fortes et si éloquentes qu’un certain Vatinius, [428] craignant d’être condamné, l’interrompit avant qu’il eût achevé son plaidoyer, et s’adressant aux juges, il leur dit : Rogo vos, judices, nam si iste disertus est, ideo me damnari oportet. [103][429][430] Ce Licinius mourut fort jeune. Où n’iraient point des hommes nés avec de si belles dispositions si la nature leur donnait une vie plus longue ?
Fin
Retour au sommaire des Ana
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Jacob Spon et Charles Patin, premiers éditeurs des Lettres choisies de feu M. Guy Patin
Codes couleur
Citer cette annexe
Imprimer cette annexe
Imprimer cette annexe avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8224
(Consulté le 06/05/2024)
En 1677, Jacob Spon, [1] né en 1647, deuxième fils de Charles, [2] était médecin à Lyon. Charles Patin, [3] né en 1633, deuxième fils de Guy, était exilé à Padoue, où il enseignait la médecine. [4] Une solide et ancienne amitié les liait, cimentée par leur passion commune pour les antiquités. [1]
La thèse de doctorat en histoire qu’Yves Moreau a présentée le 8 juillet 2013 à l’Université Lyon 3, intitulée Édition critique de la correspondance de Jacob Spon (1647-1685), contient 425 lettres, jusque-là inédites, que Spon a écrites ou reçues entre 1667 et 1685. Quatre-vingt-deux viennent de Charles Patin, et sont conservées dans le ms BnF naf 24171, Lettres de divers érudits adressées à Charles et Jacob Spon (1650 à 1681). J’ai extrait de cette correspondance ce que les deux amis se sont écrit en 1677-1679 sur leur édition des Lettres choisies de feu Monsieur Guy Patin, qui parut pour la première fois à Francfort (sic pour Genève) en 1683. [2][5]
Extraits de neuf lettres que Charles Patin a écrites de Padoue à Jacob Spon
- 3 avril 1677 (Moreau no 118, pages 305‑306 ; ms Bnf naf 24171, lettre 039, 2e‑3e pages) :
« La lettre de M. votre père, qui me fait, dites-vous, réponse, est apparemment demeurée sur votre table, ce sera pour une autre fois. J’ai bien reçu celle de M. Falconet, [6] à laquelle, au premier jour, je ferai réponse, le temps ne le permettant pas aujourd’hui. Cependant, pour votre information et mon utilité, je vous dis que le conseil de M. votre père, le vôtre et celui de M. Falconet, d’imprimer quelques lettres de mon père, est fort honnête à la mémoire de mon père, et qu’il ne saurait apporter que du bien et de la réputation à ceux qui en entreprennent la fatigue, et même à moi. Cependant, il y faut beaucoup de circonspection : c’est ce qui fait que je vous prie très humblement, et nos autres amis, de ne rien faire imprimer que de bien pesé et limé. Où l’imprimera-t-on ? Apparemment à Lyon ? À la bonne heure. Au nom de qui ? La chose m’est indifférente, pourvu que ce soit d’un honnête homme, et d’autant plus si il était ami de mon père. À qui le dédicacera-t-on ? Encore faut-il trouver quelque tête illustre et qui ait quelque part à l’affaire. M. Colbert [7] me paraît fort à propos : [3] je vous en laisse pourtant la conduite et résolution. Ce qui importe le plus est que je souhaite de voir le manuscrit devant que de l’imprimer : tant pour en retoucher ce qui ne convient pas aux mœurs d’aujourd’hui, que pour nous accommoder au temps, en ajoutant, etc. Sauf le jugement de ceux qui prendront la peine de cette direction, j’espère y faire bien du bien ; et comme je suis très désintéressé dans cette affaire, hors la réputation de mon père, j’espère que nos amis et patrons agréeront et prendront part à la chaleur avec laquelle je m’y porterai, et au sentiment que j’ai de ne rien agréer si je n’ai vu auparavant le manuscrit. J’ai de bonnes choses à ajouter, dont même, je remettrai quelques originaux à nos amis, [4] comme M. votre père, vous ou M. Falconet, me contentant de les voir courir par le monde. Sortir ce que j’ai dans le cœur, qui n’est qu’à la gloire du défunt, ne doit donner aucun ombrage à qui que ce soit de raisonnable. Je m’expliquerai aux occasions plus amplement < en > écrivant à M. votre père, quand j’aurai reçu sa lettre, ou à M. Falconet, dès que j’en aurai le loisir. Cependant, obligez-moi de leur faire ce prélude de mes sentiments et de < les > hâter un peu dans le dessein où ils sont d’honorer sa mémoire. »
- 2 mai 1677 (Moreau, no 121, pages 311‑312 ; ms Bnf naf 24171, lettre 040, 2e page) :
« Ceux qui prennent quelque part à la mémoire de défunt mon père doivent être fort obligés à vos soins, moi plus que pas un. Vous ne vous souciez pas de privilège, ni moi non plus, mais pour une autre raison que vous. Si nous en ôtons, dites-vous, le mot pour rire, le reste pourra paraître fade. Je vous réponds que je suis fort revenu de la pensée où je vois bien du monde qui se mettent < sic > en danger de pleurer pour avoir voulu faire rire autrui. En quelque lieu qu’on imprimât ses lettres comme elles sont, même sans nom, sans ville, etc., on saura que c’est ou de vous ou de moi. Je dis plus : comme l’état où je me trouve ferait tomber sur moi le soupçon, je déclare que pour le prévenir, je me trouverais obligé de les désavouer en public et hautement. N’y songeons pas si vous plaît, et n’hasardons pas ce qui nous reste pour le plaisir de souffrir une injure dite gaiement ou une censure de satire, [5] qui, quoiqu’elle fût agréée de la plupart tout bas, serait condamnée de tout le monde hautement. Ainsi, au lieu de faire honneur à la mémoire de mon père, j’en appréhenderais le déshonneur. Pour moi en particulier, cela ne ferait qu’un très mauvais effet : il y a assez de gens au monde qui trouveraient volontiers occasion de mordre sur moi, et je veux être si homme de bien qu’ils s’en mordront les doigts. Je me souviens trop qu’en 1642 on coupa la tête à Lyon à M. de Thou, [8] en vengeance de ce qu’on trouve dans les écrits de son grand-père < sic pour : père > : [9] Antonius Plessianus vulgus dictus monachus, etc. [6][10] Si le cardinal de Richelieu est mort, [11] pensez-vous que le soient aussi tous les vindicatifs et les méchants ? Je ne lèverai [7] pourtant que peu de chose et y laisserai bien des mots pour rire, puisque le monde en est si friand. Je suis de votre avis, il ne les faut pas tant limer ; pourtant, en beaucoup d’endroits, elles ont besoin ou d’ornement ou de règle. Je ferai tout cela facilement et promptement. En huit jours, je redresserai les 70 que vous m’avez envoyées et que j’ai toutes lues. Comme vous savez, les pensées de l’auteur m’étaient assez connues pour y pouvoir ajouter quelque chose çà et là, selon le besoin de ficeler ; comme en d’autres endroits, je serai obligé d’en raturer. Envoyez-m’en à l’occasion le plus que vous pouvez. De ma part, j’en ajouterai quelques-unes qui y tiendront bien leur place. Mon nom absolument n’y doit pas être. Il ne tiendra qu’à vous d’y mettre le vôtre : comme nous en aurons levé toute l’acrimonie, il y pourrait être à mon sens ; cela ne vous commettra pas pour autant ; et qui recueillerait facta et dicta de quelqu’un n’autorise rien pour y mettre son nom ; partant, comme vous voudrez. [8] Vous m’avez parlé d’une lettre de M. votre père, je ne l’ai pas reçue ; vous verrez mes sentiments dans cette lettre ci-jointe pour M. Falconet ; et autant que vous le trouverez à propos, vous me ferez plaisir de vous y conformer.
Quand j’aurai reçu toutes les vôtres, je les mettrai par ordre de leur date, car la confusion des temps leur diminue beaucoup de grâces. De plus, quand il s’en rencontre de pleines d’autres choses qui ne doivent pas être publiées, où pourtant il y a quelque bon mot, on peut le transporter à une autre, adroitement ; et en coudre, si il vient à propos, deux ou trois ensemble. La pratique fera voir que cela est plus aisé que je ne l’écris. » [9]
- 17 juin 1677, Moreau no 125, pages 322‑323 ; ms Bnf naf 24171, lettre 041, 1re et 2e pages) :
« Je suis tout de bon à la revue des lettres de G.P. Il y a certainement trop de libertés, mais pour ne pas ôter, comme vous dites, tout le sel et le mot pour rire, j’y en ai laissé, plus pour vous que pour moi. J’en ai admis beaucoup de passages, et espère n’en avoir pas ôté la grâce. J’ai rayé beaucoup de badineries qui, tout au plus, n’étaient bonnes qu’entre deux bons amis. J’y ai ajouté quelques périodes, plutôt pour honorer quelques particuliers que pour < ne > choquer personne ; aussi, j’espère que personne ne s’en plaindra. Je serai<s> d’avis que dans les transitions et changements de matière de chaque lettre, vous fissiez des a linea : [10] j’en ai marqué les endroits par cette note : /. Je n’ai pas tout corrigé grammaticalement, tant parce que je n’en ai pas le loisir que parce que je n’en suis pas capable. Pourtant, j’espère qu’on agréera mes animadversions. Je n’ai rien ajouté qui ne me paraisse avoir pu être dit par l’auteur, dont j’ai fait comme le génie. [11] Il serait trop long de vous dire les raisons des changements que j’y fais, mais je vous peux assurer que je n’en fais pas un sans raison. Sçavoir, sçavant, requiert un ç à mon avis, vous l’omettez toujours : être exprès ? être par inadvertance ? [12]
Ne vous étonnez pas de trouver des demi-feuilles en ces lettres : j’en ai retranché six demi-feuilles blanches, et qui ne servent à rien qu’à augmenter le port de la poste, vous assurant que je n’en ai retranché aucune. À l’égard du billet de votre main qui portait des extraits de diverses lettres, j’en ai inséré les articles que j’ai trouvés à propos dans les lettres correspondant à la date : ainsi je n’ai rien supprimé, mais seulement rangé. Pour deux lettres originales, elles ne se peuvent souffrir : la perte de son fils [12] lui avait ôté ce jour-là l’esprit qu’il avait d’ordinaire [et qu]’on doit avoir quand on écrit, même à son ami particulier, [il faud]ra prendre garde de plus près quand on écrit pour le public. […] est trop libre, etc. J’en ai tiré de chacune ce que j’ai […] aux autres. Si cela vous contente, comme apparemment […]llerai ces deux lettres originales, sinon je vous les […] voulant pas même garder. Mandez-moi votre [avis]. [13]
Réservez-vous pour la dédicace, je vous la remets entièrement. Outre la lettre de la dédicace, il me semble qu’il faut un avis de l’imprimeur au lecteur touchant mon père, quelque chose de sa vie, du dessein de ce livre, et y joindre l’espérance de lettres plus amples, comme en effet nous en aurons. Je serais même d’avis qu’on invitât ceux qui ont de ses lettres de nous en envoyer, savoir en Angleterre à votre M. Wheler, [13] qui le souffrirait apparemment, à votre recommandation, [14] à M. Utenbogard, [14] à M. Scheffer à Francfort, [15] à M. Fesch à Bâle, [16] à vous à Lyon, à M. Hommetz [17] à Paris et moi à Padoue. [15] Faites-y réflexion. »
- 18 août 1677 (Moreau, no 130, pages 332 et 334 ; ms Bnf naf 24171, lettre 042, 1re et 2e pages) :
« Par la vôtre du 27 juillet, vous me mandez avoir reçu les lettres de G.P., et que vous en suivez les corrections, mais vous ne me mandez pas si elles sont à votre goût : ainsi, je demeure embarrassé faute de deux mots < de votre part >. Pourtant, pour vous servir plus tôt, je n’attendrai pas votre réponse pour revoir celles qui sont au paquet que vous m’avez envoyé : je les expédierai de la même méthode que les précédentes ; soyez certain que dans huit jours ce sera fait, quoique, pour vous en dire la vérité, il y ait bien de la besogne. Un mot m’a quelquefois fait méditer plus de demi-heure, non pas à l’égard de la grammaire, mais de la politique et de la conséquence. Comme vous dites, il y a assez de lettres pour faire un volume ; celles qui viendront après en feront un second : ce qu’il faut indiquer dans la préface que vous prendrez la peine de faire ; si vous ne nous la voulez pas donner, ni aucun autre ami de Lyon, il faudra bien que je le fasse ; mais il vaudrait mieux qu’elle fût faite là, que je la revisse ensuite ; ainsi de la dédicace, dont j’attends votre avis et les matériaux. D’ici à huit jours j’aurai revu ces lettres, et m’informerai de quelque occasion sûre pour vous les renvoyer : les postes sont trop chères, et c’est autant d’argent perdu. […] [16] À ces lettres de G.P., je vous conseillerai d’y faire mettre le portrait : [18] j’ai ici un assez bon graveur, mandez-moi la mesure précise, et je le ferai incontinent graver ; et pour cela, ou le déboursé, ou des copies, ou des médailles, j’aimerais mieux le dernier. [17] Voici deux vers pour le dessous : Hic est Patinus Clarus Asclepi nepos, Per quem non licet perire mortalibus. [18][19][20] Si vous y en voulez de meilleurs, faites-les. […] Je vous procurerai d’autres lettres de G.P. pour un 2e tome ou pour toute autre impression. Si je peux, même, j’en ferai venir d’Allemagne, il y en a là un bon nombre. »
- 9 octobre 1677 (Moreau, no 131, page 335 ; ms Bnf naf 24171, lettre 043, 1re page) :
« Pour les lettres de G.P., elles sont lues et critiquées, bien ou mal, je m’en rapporte à vous, je vous les enverrai à la première commodité, et je m’en enquête soigneusement : [19] la poste est trop chère et chagrinante. Il y faudrait une préface, je vous conseillerais de la faire et si vous le voulez, j’y ajouterai je ne sais quoi. Son portrait y aurait pu servir. Quelques médailles me le payeraient, qui me réjouissent plus que de l’argent. [17] Mandez-moi la grandeur du volume, que je suppose être in‑12, et la grandeur précise du portrait ; j’aurai soin de vous envoyer la planche à temps ; le libraire n’en donnera rien si il ne veut : peut-on parler plus honnêtement ?
[…] Le graveur de G.P. [18] fera beaucoup mieux que celui des Relations d’Allemagne. [20] […] J’ai refait ici une bibliothèque : [21] après avoir perdu à Paris celle que j’avais faite et l’espérance de celle de mon père, [22] tout ruiné que je suis, j’en ai fait une nouvelle qui épouvante bien du monde. [21] Peu de professeurs de ce pays en ont une aussi belle, et peut-être personne : on sait tout ici sans beaucoup apprendre ; pour moi, je suis grossier, et il me faut des livres et bien du travail pour me rendre digne de mon emploi. »
- 14 octobre 1677 (Moreau, no 133, page 339 ; ms Bnf naf 24171, lettre 043, page de droite) :
« Hier, votre paquet de lettres de G.P. est parti. Un R.P. capucin [23] le portera à Turin, [24] d’où il promet de vous le faire tenir. Je tiens cet expédient sûr. Pourtant, dit-il, il ne sera à Lyon que vers le 14e de novembre ; à cela près, et qu’il arrive sans avarie ; même, dit-il, gratuitement. [22]
Je serai<s> d’avis qu’on en portât un bon nombre à Paris, comme de 400, auparavant que d’en débiter encore. Je vous ai mandé par ci-devant mes sentiments touchant la préface : vous êtes prié de la faire, je la reverrai volontiers, et m’accommoderai à l’usage et au temps. Surtout, que les lettres soient imprimées dans l’ordre de leur date. Vous trouverez si < sic pour : s’il > vous plaît moyen de faire en sorte que M. Henry, avocat, [25] votre ancien ami, en ait un exemplaire des premiers et de ma part. Il m’a écrit de vous en bons termes. Fama volat, [26] j’y contribuerai volontiers. [23] […]
Je m’avise qu’il faudrait faire la préface de ci-dessus de bonne heure, parce que l’ayant vue vous la rajusteriez, et il serait mieux de la revoir une autre fois. » [24]
- 19 décembre 1677 (Moreau, no 136, pages 343 et 346 ; ms Bnf naf 24171, lettre 044, 1re et 4e pages) :
« J’espère toujours que vous recevrez mes lettres de G.P. Je me souviens que ces PP. capucins à qui je les confiai voulaient voir la solennité de saint Charles à Milan, [27] qui est le 4 novembre, et c’est ce qui les aura retardés. Delà ils allaient à Turin, d’où ils devaient ménager occasion sûre pour vous les faire tenir à Lyon : à quoi ils auront satisfait, ou j’espère qu’ils satisferont, dum vivo, spero. [25] Si les capucins me trompent après tant d’autres qui m’ont trompé, je fais vœu de ne plus me fier à personne. […]
On me promet beaucoup de lettres latines de G.P. Nous ferons le succès des françaises. »
- 25 février 1678 (Moreau, no 147, page 369 ; ms Bnf naf 24171, lettre 046, 1re page) :
« Cette préface de la vie et mœurs de G.P. requiert grand temps, et je ne l’ai pas à présent. De plus, on verrait que je l’aurais fait < sic >, donc on conclurait que j’aurais fait imprimer les lettres, ce qui me pourrait ruiner dans la conjoncture de mes affaires. J’aimerais mieux la lire de la veine d’un autre ; volontiers pourtant je la reverrais. Il est né le 31 août 1601, et mort le 30 mars 1672. Vous êtes fort propre à cette fatigue, et je la verrais volontiers, et rendrais. » [24]
- 23 juin 1679 (Moreau, no 235, page 532 ; ms Bnf naf 24171, lettre 055, 4e page) :
« J’ai fait copier beaucoup de lettres latines de défunt mon père, que je vous enverrai quand vous voudrez. Il y en a bien plus que de françaises. » [26]
Extrait d’une lettre de Jacob Spon
À Claude Nicaise, [27][28] sans lieu ni date écrits (1679) (Moreau, no 230, page 522 ; ms BnF fr 9360, Correspondance de l’abbé Nicaise, f o 323) :
« On m’écrit que l’on veut imprimer à Rome un volume in‑fo des lettres de Baronius, [29] ou qui lui ont été écrites. [28] De la manière dont m’a écrit M. Chouët, [29][30] je vois qu’il ne se soucie pas d’imprimer les lettres de M. Patin. Si c’était un méchant livre, il l’aurait déjà fait, car les libraires se trompent souvent aux choix de leurs auteurs. Pour moi, je tiens que c’est un livre à en faire beaucoup d’éditions. J’y ferai, s’il plaît à Dieu, travailler ici dans un mois. »
Commentaires
Ces précieux courriers établissent que Charles Patin et Jacob Spon, avec l’approbation et l’aide de Charles Spon et d’André Falconet, les deux amis lyonnais de Guy Patin, ont énergiquement travaillé à éditer un choix de ses lettres entre 1677 et 1679. Dès lors, ce dessein était à deux doigts d’être réalisé : on avait corrigé les dernières feuilles du manuscrit, et on songeait déjà au portrait de l’auteur qui devait orner l’ouvrage et au deuxième tome qui l’enrichirait bientôt ; mais il restait à écrire la préface du livre, à trouver un imprimeur assez audacieux pour le publier, et à libérer Charles de la condamnation qui entravait sa liberté d’agir au grand jour en France.
Yves Moreau a fourni la preuve formelle que le projet a bien été mené jusqu’à son terme dans la lettre no 371 de sa thèse (page 759), écrite par Jacob au libraire genevois Jean-Louis Du Four, [30][31] datée de Lyon le 7 mars 1683 :
« Il faudrait dans votre titre Lettres choisies de feu Monsieur Guy Patin, docteur en médecine de la Faculté de Paris et professeur au Collège royal. Si le nom de Genève n’y était pas, elles passeraient en France et en Italie avec moins de difficulté, et même elles se vendront mieux, vos impressions étant fort décriées. M. de Fléchères [32] me dit encore hier qu’il n’avait rien reçu de vous ; et en ayant demandé à la douane des nouvelles, on ne m’en fut < sic pour : voulut ? > point donner. Si vous avez envoyé cet exemplaire pour lui par le chasse-marée, [33] il devrait être arrivé. [31] J’ai jusque là le N, mais il me manque le M. Si vous pouviez m’envoyer cette suite par un courrier comme le précédent, je vous prie de lui recommander. [32] S’il y a quelque ami qui s’en veuille charger d’un ou deux exemplaires pour moi, vous pourrez lui remettre. D’abord qu’il sera fait et la planche tirée, vous pouvez en faire un paquet d’une vingtaine que vous enverrez par commodité à Padoue à M. Charles Patin, professeur en médecine, de ma part. »
Le décalage de quatre ans entre l’achèvement de l’édition (1679) et la parution de l’ouvrage (1683) est sans doute lié à l’amnistie de Charles Patin, qui ne fut prononcée qu’en juin 1681, [33] puis à la difficulté de convaincre un imprimeur. En poussant un peu loin le bouchon, j’en conviens, on peut voir dans cette parution retardée une vengeance longuement ruminée de Charles contre une cour et une Faculté de médecine qui lui avaient valu une immense infortune ; mais ce fut un éphémère délice qu’il paya fort cher.
Dans son acharnement à reprendre rang sur le tableau des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris, [34] Charles alla jusqu’au parjure, en écrivant le 1er juin 1686 au doyen Claude Puilon : [34][35]
« On m’objecte principalement d’avoir édité ou aidé à faire paraître un petit livre contenant les lettres françaises de mon père, Guy Patin. Comme elles sont entrelardées de médisances, je dois être châtié sans mériter la moindre pitié de la très salubre Faculté si j’en ai été l’instigateur, l’auteur ou le divulgateur. […]J’atteste solennellement n’avoir été ni l’auteur ni le divulgateur des injures dont on m’accuse injustement. Cela devrait suffire si on accordait quelque foi à ma parole, mais j’affirme en outre n’avoir jamais possédé ce livre, ni l’avoir attentivement lu ; il a seulement fini par me tomber entre les mains pendant deux heures, un jour qu’on me l’avait prêté. Tous ceux qui connaissent ma vie savent bien que je n’ai hérité ni lettres, ni opuscules, ni manuscrits de mon père, ni même la moindre chose qui lui appartînt. »
Le labourage des archives sait décidément déterrer de cruelles découvertes.
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Les deux Vies latines de Jean Héroard,
premier médecin de Louis xiii
Codes couleur
Citer cette annexe
Imprimer cette annexe
Imprimer cette annexe avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8225
(Consulté le 06/05/2024)
Paris contre Montpellier, 1641-1654
L’ultime procès de Théophraste Renaudot contre la Faculté de médecine de Paris, perdu le 1er mars 1644, [1] résume la violente querelle qui opposa la Faculté de médecine de Paris à Renaudot, [2] déclenchée par les activités médicales du Bureau d’adresse qu’il avait établi sur l’île de la Cité en 1628, sous la toute-puissante protection de Richelieu. [3] Guy Patin, l’un des champions du clan parisien, avait publiquement diffamé Renaudot à deux reprises : dans la préface anonyme de son édition des Opera [Œuvres] de Daniel Sennert (Paris, 1641), en le traitant de nebulo et blatero ; [1][4] puis à visage découvert, dans sa thèse L’homme n’est que maladie (17 décembre 1643), [5] en l’enguirlandant d’un infamant acrostiche. [2][6] La très salubre Faculté et son boutefeu Patin sortirent vainqueurs du procès qui s’ensuivit, mais l’Université de Montpellier, où Renaudot avait obtenu son diplôme et puisé sa pratique médicale, en fut aussi meurtrie que vindicative.
Ces péripéties ne se limitaient pas à un combat singulier entre Renaudot et Patin, mais à un affrontement entre les deux plus puissantes écoles médicales françaises. Le principal argument en était doctrinal. [7] En simplifiant, il opposait : au nord, le dogmatisme de Paris, fondé sur la méthode d’Hippocrate et de Galien, [8][9] assise sur la théorie des quatre humeurs corporelles, [10][11][12][13] opposée aux innovations, et préconisant la saignée à tout va [14] et la purgation à l’aide de remèdes végétaux simples, [15] dont le moins antique était le séné, [16] seule concession faite, à contrecœur, à la médecine des Arabes ; [17] et au sud, l’empirisme [18] éclairé de Montpellier, ouvert aux idées de Paracelse, [19] qui avait renversé la théorie humorale et introduit les remèdes chimiques, [20] tels l’antimoine, et qui essayait de sortir la thérapeutique de la vénérée routine qui se résumait à rétablir le bon équilibre (tempérament) du corps par la saignée et la purge. À cette dispute médicale des anciens et des modernes s’ajoutait un différend religieux et politique : Montpellier ouvrait ses bancs aux réformés et aux juifs marranes, [21] tandis que Paris ne graduait presque uniquement que des catholiques ; [22] pour contrer les influents médecins du roi et des premiers princes du sang, dont un bon nombre était issu de Montpellier et d’autres facultés provinciales, Paris les qualifiait d’étrangers et leur interdisait de pratiquer dans la capitale, hors de la cour. [23]
Le discours inaugural de Siméon Courtaud, [24] doyen de Montpellier, [25] prononcé le 21 octobre 1644, et publié l’année suivante, attaquait la Faculté de Paris avec virulence en niant sa prééminence historique et savante. Ce fut le début d’un ouragan de pamphlets souvent non signés qui dura dix ans : Jean ii Riolan et Patin ripostèrent en 1651 avec les anonymes Curieuses recherches ; [3][26] le paroxysme fut atteint en 1655, avec au moins 13 libelles écrits en latin, dont les principales plumes parisiennes identifiables furent Charles Guillemeau, [27] Jacques Thévart [28] et François Blondel. [4][29]
Jean Héroard, [30] premier médecin de Louis xiii [31] et oncle maternel de Siméon Courtaud, est un modèle des médecins originaires de Montpellier que les Parisiens tenaient pour étrangers et accablaient de leurs sarcasmes. Deux libelles latins publiés à Paris en 1654 ont raconté sa vie de façon contradictoire. Ce sont, dans l’ordre où Patin les a commentés dans sa correspondance, qui correspond probablement à celui de leur parution (mais aucun des deux n’est daté par un privilège ou un « Achevé d’imprimer ») :
- la Cani miuro sive Curto fustis, hoc est Caroli Guillemei, doctoris Paris. ordin. Regis Med., Responsio pro seipso… [Bastonnade pour le chien dont on a coupé la queue, autrement dit Courtaud, qui est la Réponse de Charles Guillemeau, docteur de Paris, médecin ordinaire du roi, pour sa propre défense…] (petit in‑fo de 38 pages), probablement paru en juin ;
- l’anonyme Genius Παντουλιδαμασ ad diam Scholam apud Parisios Empirico-Methodicam… [Le Génie Pantoulidamas (maître absolu de tout) contre la dive École empirico-méthodique de Paris…] (in‑4o de 133 pages), que Patin a attribuée Antoine Madelain, probablement paru en décembre. [5][32].
Dans des styles fort différents, le latin de ces deux biographies est absolument exécrable. J’ai bien vite compris pourquoi nul ne s’était jusqu’ici échiné à les traduire, en dépit des précieux renseignements qu’ils recèlent. Les versions que j’en donne ici sont souvent plutôt des interprétations plausibles que des traductions mot à mot. J’y ai fait fi des incorrections grammaticales, des barbarismes, des discordances des temps de conjugaison et des incohérences de la ponctuation, et allégé de mon mieux les lourdes redondances qui enrobent tant les louanges que les moqueries. Le confort de lecture a primé, et l’impossible fidélité au texte m’a parfois contraint à privilégier le contexte. J’ai aussi inséré des alinéas pour aérer les récits. Étant donné les éclairages différents que les deux narrations projettent sur les faits, j’ai prêté une particulière attention à leur chronologie. Avant d’en venir à ces textes, il convient d’en comprendre la genèse.
Prologue : l’offense faite à Charles Guillemeau
La Seconde Apologie de l’Université en médecine de Montpellier, répondant aux Curieuses recherches des universités de Paris et de Montpellier, faites par un vieil docteur médecin de Paris. Envoyée à M. Riolan, professeur anatomique, par un jeune docteur en médecine de Montpellier… (Paris, 1653) [6][33] avait fort maltraité Charles Guillemeau, tout particulièrement dans ce passage de la section xxxix, Les Rois ne préfèrent point Montpellier à Paris, pages 56‑58 :
« Vous, Jean Roilan, avez connu Monsieur Vautier, et comme il était premier médecin ; [7][34] vous avez connu ceux qui possédaient cette charge avant lui. Monsieur Vautier était médecin de Montpellier ; les autres l’étaient de votre Faculté. Et cependant, avec un affront et ignominie que votre Faculté ne réparera jamais, ils ont été honteusement déquillés pour y mettre Monsieur Vautier en la place, pour cette seule considération qu’il était médecin de Montpellier. [8] Du depuis, on a eu le même égard en la sage et digne élection qu’on a faite de Monsieur Vallot, [35] homme plein d’honneur, de savoir d’expérience et de prudence, en la place de Monsieur Vautier. [9] Il me suffit de vous donner ces deux exemples tout récents pour faire voir la différence qu’il y a entre les docteurs de ces deux universités, et l’estime diverse qu’on en fait.Que s’il est question d’artifices pour parvenir à une telle charge, vous savez comme Monsieur Bouvard [36] y entra. En voici tout le tissu. M. Charles Guillemeau, qui avait l’accès près du roi, l’introduisit pour lui servir de planche à ladite charge, ce rusé et faux rousseau [37] abusant de la candeur et ingénuité de Monsieur Bouvard. Monsieur Héroard, grand médecin, grand politique (vénérable pour sa prud’homie, [38] pour son âge et pour le service par lui rendu à quatre de nos rois successivement), [10] possédait la charge de premier médecin avec l’amour et la bonne grâce de son prince. Il avait contracté une amitié fort étroite avec Maître Jacques Guillemeau le père, chirurgien du roi, [11][39] lequel lui donna son fils Charles Guillemeau, aussi chirurgien. Il l’aime comme fils de son ami, et comme le sien propre, le fait connaître et le met en la bonne estime du roi, qui le reçoit sur le témoignage de Monsieur Héroard. Ce Guillemeau se comporta en apparence d’honnête homme ; enfin, saisi de vanité et de bonne opinion de soi, il desseigne [12] de pousser avant sa bonne fortune. Comme que ce fut, ayant quitté le rasoir et la lancette, [40] il se fait docteur de votre Faculté et muguette la charge de premier médecin ; [13] mais Monsieur Héroard, son créateur et bienfaiteur, l’en empêche. Ce garnement se résout de fermer les yeux pour ne le point considérer, [14] et commence à semer de faux bruits sur l’honneur du dit sieur Héroard, disant qu’il était vieux, que son jugement n’était point de même que par le passé, qu’il ne connaissait pas bien le naturel du roi (lequel cependant il avait heureusement conduit dès sa naissance).
Pour donc parvenir plus aisément et plus tôt à une telle charge, il dresse de loin sa batterie, de peur d’être connu tel qu’il était, se reconnaissant trop jeune d’âge, de prudence et d’expérience. Il retire Monsieur Bouvard du service du public, pour le faire connaître à la cour, et lui faire naître quelque désir de cette première charge, avec ce dessein de l’en débusquer incontinent qu’il y serait établi. Et ainsi, mon galant, ce monstre ingrat, ce perfide rousseau, je dis Charles Guillemeau, lève le talon contre son second père, duquel il devait écouter les paroles comme des oracles, et les suivre comme des règles de bien-vivre. Le doyen a touché en passant, dans son Apologie, la noire ingratitude de ce dénaturé parricide ; mais en termes pleins d’honnêteté, ayant caché le nom de Guillemeau sous le nom de Rousseau, lorsqu’il dit comme<nt> ce vénérable vieillard, et le sage Caton [41] de la cour, étant vu un matin, attendant qu’il fût jour, en l’une des fenêtres qui regardent la basse-cour du Louvre, [42] voyant venir ledit Guillemeau, dit à quelqu’un qui était près de lui : “ Voilà le seul ingrat et perfide que j’aie trouvé. ” [15] Mais cet orgueilleux se trouve bien reculé, [16] pource que jamais personne ne se prit contre ledit sieur Héroard qui ne s’en soit mal trouvé ; mais, entre plusieurs, [17] cet ingrat qui étant le dernier, < est > comme la lie de tous, et le plus détestable. Les amis du sieur Héroard lui conseillaient de lui faire manger la poussière, pour servir d’exemple ; mais la mémoire du père et la qualité de chrétien firent qu’il remit tout cela à Dieu, se contentant du pouvoir qu’il avait de le rendre misérable. Ce que j’ai voulu représenter ici, afin que ses confrères fissent considération du personnage selon ses bonnes et remarquables actions, et eussent souvenance du dire du dit sieur Héroard, “ Que l’ingratitude est un symptôme de la ladrerie ”. [43] Après le décès d’icelui sieur Héroard (qui mourut paisible dans son lit en sa charge, visité en sa maladie par Sa Majesté, et regretté, après sa mort, de Sa dite Majesté, en ces paroles, “ J’avais encore bien besoin de lui ”), Monsieur Bouvard occupe la place ; mais de telle sorte que le scélérat Rousseau trouve plus de résistance qu’il ne s’attendait point de ce bon et franc naturel. Voilà donc comme il fut pourvu de ladite charge par les menées du dit Guillemeau, lequel voulant voir jusques où la fortune le pousserait per fas et nefas, [18] fut repoussé aussi vivement comme il la recherchait ardemment. Et ainsi, ces deux grands hommes, Monsieur Héroard et Monsieur Bouvard, corvum suum rufum deluserunt hiantem. » [19][44]
Charles Guillemeau (qui se défendait d’être roux) a prouvé que sa Vie de Héroard venait de cette attaque : il l’a transcrite, sous le titre d’Extrait du livre intitulé Seconde Apologie…, en exergue de son Cani miuro…
Cani miuro (Charles Guillemeau)
[Page 3 | LAT | IMG] « Écoute donc maintenant ce qui t’afflige, t’enrage, te fait écumer et, ce qu’il y a de pire pour toi et pour ton oncle, [20] vois comme tu seras flatté de m’avoir arraché le récit parfaitement véridique de ce qui s’est passé, [Page 4 | LAT | IMG] sans que j’y aie volontairement et sciemment ajouté d’impudentes médisances !Jean Héroard eut pour père un illustre [21] barbier [45][46] de Montpellier. Il encouragea notre futur premier médecin du roi Louis (car ainsi la Fortune [47] a-t-elle voulu plaisanter) à s’enduire d’une très légère teinture de rudiments lettrés, pour le pousser hors de sa boutique à remèdes ; puis il se consacra à le faire poursuivre en prenant ce qu’on appelle de petites leçons de médecine. Comme Héroard était né sans attrait pour les Muses ni le moindre talent pour les arts d’Apollon, [48] il décide qu’il a mal fait de s’y être essayé : il s’envole du nid et s’enrôle comme simple soldat, dans le parti qui mettait en avant le nom de Religion [49] pour trahir la Couronne sous le commandement de Coligny, [50] auquel il s’était rallié, tout comme son père et sa proche parenté. Ils s’engagent dans la funeste bataille de Moncontour, [22][51] où, dès le tonnerre des premiers coups de canon, notre soldat a d’abord le souffle coupé ; il tourne les talons, non pas pour se jeter de nouveau dans la mêlée, mais pour ne jamais plus reprendre le combat ; et tout en regardant souvent derrière lui, sa fuite finit par le ramener à Montpellier. Là, il se renferme dans la vielle École où, entre-temps, est venu le jeune Jacques Guillemeau, [23] avide de voir et apprendre quantité de nouveautés. Fils et petit-fils de chirurgien royal, il deviendra bientôt chirurgien ordinaire du roi Charles ix. [52] En fréquentant ladite Université, ou par quelque autre hasard, il fait la connaissance de Héroard, et ce bien plus pour l’avantage de ce dernier que pour celui du public.
Guillemeau retourne à Paris pour assurer les quartiers de sa charge. Puis à son tour, Héroard y monte : mécontent de ses déboires militaires, tout comme de ses médiocres études et de son application à la médecine, il espère se ménager n’importe où un avenir moins misérable que là où il était, ayant ouï dire que les hommes se couvraient d’or dans la capitale. Quelques jours après y être arrivé, il rend visite à Guillemeau. Fidèle à sa coutumière amabilité, son bon génie, n’a pas oublié cet homme : il ne l’éconduit pas, mais l’embrasse ; il lui demande pourquoi il est venu, et lui promet son argent et son soutien ; et à quel point lui a-t-il plus tard prouvé qu’il ne faisait pas cela par pure courtoisie ! Héroard lui dit : “ Puissiez-vous me procurer quelque moyen d’existence, car j’en suis venu au point de vouloir sortir de mes misères ! ” Mon père servait auprès d’Ambroise Paré, [53] premier chirurgien du roi Charles, que le souverain avait personnellement chargé de trouver quelque jeune homme capable d’étudier soigneusement l’anatomie du cheval et ses maladies, pour en faire son hippiatre. [24][54] Héroard décide alors de saisir sa chance et d’assouvir son désir le plus cher, qui est [Page 5 | LAT | IMG] d’entrer dans la Maison royale, quelle qu’y soit sa place. Guillemeau en parle immédiatement au premier chirurgien. Héroard se rend, comme convenu, au domicile de Paré, Guillemeau l’y recommande avec ardeur et le confie à son maître, qui l’emmène voir le roi à Vincennes, [55] où il avait coutume de se distraire en jouant à la paume. [56] “ Sire, dit Paré, j’ai amené, comme vous l’avez ordonné, celui qui deviendra votre médecin du cheval. ” Le roi, qui ne voulait pas désapprouver quelqu’un que son chirurgien avait personnellement recommandé, décide d’intégrer Héroard dans sa Maison en qualité d’hippiatre, et lui accorde une pension annuelle de quatre cents livres. Il sert un certain temps dans cette charge et avec ce titre, sous le bon génie de Guillemeau, son protecteur et celui à qui il était redevable de ce bienfait. Chasse, chiens et soins des chevaux étaient le divertissement et le plaisir du roi Charles. À sa mort, Henri [57] lui succède ; [25] mais comme les esprits et les intérêts des rois et des frères diffèrent souvent, Sa Majesté ne prête plus d’intérêt à ces sujets ; et voilà notre hippiatre plongé dans l’inaction, la disgrâce et l’incertitude de son avenir.
Il vient souvent voir Guillemeau, et l’implore et supplie de venir à son aide : “ Ayez soin de moi, Guillemeau, protégez celui en qui vous avez tant de fois mis votre confiance. Efforcez-vous de veiller sur lui ! ” Anne de Joyeuse [58] était comme l’Héphestion du roi, [26][59] et Guillemeau s’était acquis tant de faveur auprès de lui, par la fidélité et le succès de ses services et de ses soins, qu’il jouissait de toute sa confiance. Bien assuré de cette grâce et pensant amicalement à Héroard, son protégé, Guillemeau saisit une bonne occasion pour adresser franchement et non sans à-propos ces paroles à Joyeuse : “ À votre Maison, si vaste et si choisie, Monseigneur, manque ce qui n’a jamais manqué aux grands princes de Rome, [27] à savoir d’y attacher un médecin particulier. Il vous faut en avoir un, et je crois avoir trouvé celui dont vous ne mépriserez ni l’art ni le zèle à servir. Et moi, qui suis votre conseiller, je me porte garant de cet homme, dont voici le nom. ” Quand Joyeuse l’entend, il éclate de rire : “ Pour ma part, mon cher Guillemeau, je vous ai tenu pour homme et ami, mais vous, vous me prenez pour un cheval, qui aura attaché à tout jamais sa personne à un médecin des chevaux ! ” Ferme dans son bienveillant dessein, mon père répond : “ Mais je vous assure qu’il est bel et bien médecin des hommes. Il a exercé en son pays de Montpellier, et aussi à Paris, où il a servi avec assiduité auprès du célèbre Duret. [28][60] Il a supporté de devenir médecin des chevaux, charge qu’il a remplie avec grandeur et bonheur, car elle lui a permis d’obtenir un rang parmi les domestiques du roi. ” Afin que le duc ne refuse pas, il insiste en disant qu’il ne lui proposerait jamais quelqu’un sans être sûr qu’il est parfaitement capable de le servir. Vaincu par tant de persévérance, [Page 6 | LAT | IMG] Joyeuse admet dans sa Maison le protégé de Guillemeau. Assez longtemps après, Guillemeau, comme si Héroard était véritablement son frère, et pensant qu’ils devaient tous deux jouir des mêmes appointements et de la même considération, lui dit : “ Pour vous débarrasser de ce titre de médecin équin et mettre un terme à cette réputation, il nous faut servir notre héros en tant que domestiques de l’Hippone, et y mettre tant de zèle qu’il veuille vous nommer médecin de son écurie, avec une rente identique à celle que vous perceviez comme hippiatre du roi Charles. Au prix de ce seul changement de titre, il ne verra pas de difficulté à vous enregistrer dans cette charge. ” [29][61]
Les efforts de Guillemeau permettent de conclure l’affaire, et il ne faut pas longtemps pour qu’ensuite, grâce à l’appui et à l’influence de Guillemeau, le maître à penser de Joyeuse, qui ne lui refusait rien, Héroard soit aussi nommé médecin du roi, figurant dans l’album de ceux qu’on appelle les serviteurs de saint Théraponte. [30] Jusqu’ici, il est clair, et il restera clair jusqu’à la fin, que la bonté de Guillemeau envers Héroard ne s’est jamais étiolée, et que si l’existence de cet homme a eu quelque valeur, il ne l’a dû ni à lui-même ni à quelque mortel que ce soit, autre que le seul et unique Guillemeau. C’est à lui que Joyeuse s’est plaint de son incompétence, et lui qui l’a souvent entendu plaisanter, avec la franchise et l’esprit qui le caractérisaient : “ Vous m’avez pourvu d’un médecin, mais il est médecin des chevaux ; du reste, c’est à qui se porte garant de rendre des comptes, vous me rembourserez ce que vous m’en devez, et même davantage. ” Et au roi, dont il était l’ami de tous les moments : “ Ma métamorphose vous émerveillera, Sire, quand vous saurez que me voici changé en cheval, et ce n’est pas pour la raison que la fable donne à la transformation de Saturne, [31][62] mais parce que mon médecin est un médecin de chevaux, comme si j’en étais un. ” Il est pourtant rare que la puissance dure longtemps, et plus rare encore qu’elle soit perpétuelle : si grande soit-elle, jamais elle n’est suffisamment solide. Une fois sa faveur refroidie, Joyeuse se voit écarté des illusions de gloire et de pouvoir dans la lutte contre les chefs militaires qui prétendaient mettre leurs forces au service de la liberté religieuse. Héroard, soit pour fuir la guerre, car il ne s’était jamais remis de son épouvante de Moncontour, soit pour avoir eu vent de la brouille survenue entre le roi et Joyeuse, car c’est un homme fort soupçonneux et à l’affût de toutes les rumeurs, avec une ignominie et une ingratitude sans pareilles, délaisse alors ce maître qui avait tant mérité sa reconnaissance et qui l’avait fait passer du vil état d’hippiatre à la dignité de médecin. La souillure de son forfait rejaillit sur Guillemeau, à qui il devait tout. Joyeuse fit mine de l’en blâmer : “ Mon ami, vous avez non seulement confié ma personne à un médecin de cheval, mais à un ingrat. Que disparaisse donc [Page 7 | LAT | IMG] celui qui s’est montré aussi indigne de vos insistantes recommandations que de votre constance à prendre sa défense ! Je me suis naguère aisément passé d’un médecin, et m’en passerai désormais ” Survient alors la mortelle défaite de Joyeuse, [32] mais toujours grâce aux intercessions et au soutien de Guillemeau, Héroard reste en cour. Depuis lors, son assiduité à bien mériter et à bien faire l’y a maintenu pendant quarante années, et s’il avait vécu, celui qui l’avait fait hippiatre puis médecin du roi l’aurait vu devenir archiatre. [33]
Un assassinat aussi abominable qu’impie ayant emporté Henri, le plus aimable des princes, [34][63] Héroard se voit écarté, méprisé, rejeté par la cour, où il n’est tenu pour rien d’autre que le titulaire de la charge d’hippiatre. Néanmoins, il s’incruste dans l’entourage du très grand roi qui est monté sur le trône ; ou, bien plutôt, il s’y accroche en dépit du dédain qu’il y inspire : il n’a personne vers qui se tourner, puisque nul ne le conseille et nul ne lui demande conseil ; dans ses rencontres et ses entretiens avec les autres médecins, il se rend compte de son inaptitude et de son ignorance absolue, tel un banqueroutier redoutant son créancier. [35][64] Le roi se rend à Lyon pour un mariage que tous les honnêtes gens ont souhaité avec ardeur. [36] Héroard, qui n’a en tête que la provision de ses intérêts et de ses bonnes fortunes, seule matière en laquelle son pronostic ait jamais été juste, se dit que, puisqu’il est au moins médecin, il pourrait trouver moyen de devenir médecin du dauphin à naître (étant donné qu’en tout homme l’ambition outrepasse la capacité naturelle). [65] Il sait pourtant bien ne rien posséder du renom et de l’autorité, et encore moins de toutes les vertus qui sont requises pour nourrir une si grande espérance. Qu’y a-t-il que l’argent ne puisse procurer ? Il se fait bien voir, il rassemble huit cents écus, qu’il remet de la main à la main à l’archiatre, Jean de La Rivière ; [37][66] en outre, il tourne ses prières vers Roger de Bellegarde, le très influent hypaspistês, c’est-à-dire le grand écuyer, [38][67] afin que, comme maître de l’Écurie royale, il veille à l’en nommer médecin, ce qui le prédestinerait à devenir celui de Monseigneur le Dauphin. En homme d’aimable commerce et ne pouvant à peu près rien refuser, Bellegarde en discute avec le roi et l’entend dire qu’il n’y a pas besoin d’un médecin pour un enfant qui n’est pas encore né et que s’il lui venait un fils, il n’irait pas le confier à un médecin de cheval : la réputation de Héroard dans cette charge est telle, que c’est le seul titre que le roi lui ait jamais connu. “ Il y a, dit-il, bien assez de médecins dans mon royaume, ne serait-ce qu’à Paris, pour que j’aie l’embarras du choix ; mais vous, grand maître de mon Écurie, vous nous imposez un médecin des chevaux. Valant mieux que vous pour régler cette affaire, je vais moi-même y mettre la main. ” Un dauphin étant né, selon les vœux de tout le peuple, [Page 8 | LAT | IMG] Héroard insiste auprès de Bellegarde. Il harcèle son protecteur, qui ne renonçait pas d’ordinaire à ce qu’il avait entrepris, mais qui, s’il avait mieux connu l’animal, aurait difficilement toléré sa présence dans sa propre écurie. Il persiste à le recommander, avec plus d’énergie et d’assurance que jamais. Après avoir été secrètement informé par Héroard, La Rivière va voir le roi, qui dit à son archiatre : “ Savez-vous quel médecin Bellegarde destine à mon fils ? C’est celui qui s’est rendu célèbre en soignant les chevaux ! ” La Rivière, dont l’or a corrompu les lèvres, lui répond : “ Il est impossible, Sire, de choisir meilleur médecin pour les petits enfants que celui qui ne touche à rien, qui ne prescrit rien. Pour tout médecin et toute médecine, il ne leur faut que la large et saine mamelle de la nourrice ; [68] et s’il arrive au dauphin d’avoir besoin d’un médecin, je ne serai jamais loin. ” Ces prières convainquent si bien le roi qu’il souffre facilement de ne pas dire non, lui le plus fin des connaisseurs et des observateurs, lui que le relent, même lointain, de médecin du cheval offensait encore ; mais hélas il était beaucoup trop bon homme ! Il se fiait pourtant en cela à la diligence et au talent de son médecin, et non pas à ceux de Héroard. Toutefois, comme les choses et les hommes ont coutume de croître ensemble, sans d’ordinaire se dissocier autrement que par la ruine, même quand il s’agit de poutres malsaines, la cour et le très clément roi ont toléré, pendant les neuf premières années suivant sa nomination, un médecin qui n’en avait que le titre, auquel personne n’a jamais eu recours, hormis celui qui aurait ignoré comment s’y prendre pour se désenfler les pieds. [39][69]
Ce Soleil des Français, lumière du siècle et honneur des rois, vient à s’éteindre. [40] Cette nuit, dont l’éternité nous horrifie, abat et suffoque les esprits de tous, depuis la lie du peuple jusqu’au dauphin, alors devenu roi, et qui était né pour l’être. En principe, Héroard a cessé d’être son médecin : tous jugent certes qu’il faut le chasser de sa charge, mais qu’il y satisfera tant que les affaires n’auront pas retrouvé leur calme. La reine [70] et les princes du sang sont de même avis là-dessus. Comme on recherche un médecin d’authenticité et de dignité incontestables, les suffrages se portent sur un homme qui a moins brillé par sa notoriété publique que par ses salutaires actions et ses éminents mérites : vous auriez dit que Simon Piètre, [71] fils de Simon [72] et frère de Nicolas, [73] lui-même médecin parfaitement accompli, était le défenseur et le purificateur de la médecine, dans la mesure où elle défend et purifie les hommes ; vous lui auriez donné la première place devant Caton pour l’intégrité, devant Hippocrate pour le jugement et devant Galien pour la science ; la médecine lui devait plus son salut qu’aux dispendieuses duperies des pharmaciens, [74] [Page 9 | LAT | IMG] aux fumées des souffleurs aux impostures des charlatans, [75] aux fourberies des saltimbanques, aux poisons des stibiatres, [41][76] et il lui a rendu son antique et noble liberté. Le sachant tout à fait étranger à la cupidité et à l’ambition, la cour l’espère plus qu’elle ne le souhaite vraiment. On va néanmoins jusqu’à lui porter un brevet d’archiatre, mais il préfère conserver sa parfaite dignité que s’exposer à l’outrage d’être éconduit, et se contente du fruit de son éminente autorité (seule vertu à laquelle il attachât du prix). [42] On discute avec Héroard afin qu’il cède la place à meilleurs que lui ; mais il lutte, il résiste, il s’accroche comme un poulpe à son rocher, à la manière dont le lierre s’obstine sans fin à tuer l’arbre qu’il enserre de ses rameaux. Ce n’est pas une mince affaire de dénoncer et de chasser un homme qui a si bien connu le tempérament du roi et qui l’a accoutumé à lui en l’accompagnant depuis sa naissance : qu’il arrive quoi que ce soit à Sa Majesté, et il ne manquera pas de gens pour plaider en faveur de cet homme, et condamner la décision de le répudier sur ce qu’ils diront en être la funeste conséquence. Les ministres du Conseil [77] le pressent afin qu’il demande à être soulagé d’un si grand office et d’un si lourd fardeau, en lui promettant qu’il ne quittera pas la cour nu comme au sortir d’un naufrage. On lui présente des accommodements. Lui, très soucieux de ses intérêts, exige une charge de maître des comptes ; on ne lui concède qu’une charge d’auditeur, mais il trouve honnête de n’en vouloir démordre, une, deux et trois fois de suite. Tandis qu’il demeure indécis et que toute la cour ne se demande plus s’il est incapable, mais le croit assurément tel, Concini [43][78] présente une supplique en sa faveur et le cours de la transaction s’inverse, comme font toutes affaires humaines. Héroard a pu s’en réjouir, mais il n’aurait pas dû, car il a lié son destin à celui de la France : vaille que vaille, ce flot l’a projeté dans un port, pour autant que la cour en soit un, et non pas un lieu d’agitation et de tempêtes ; y occuper un premier rang, quand même nous ne nous mettrions pas de la partie, c’est s’abandonner au jugement de tous. Qu’il y serve donc, qu’il en jouisse pleinement, bien que j’aie entendu dire de lui que premier médecin est ce qu’il n’est pas, mais que médecin des chevaux est ce qu’il a été. » [44]
Genius Παντουλιδαμασ (Antoine Madelain ?)
[Page 48 | LAT | IMG] « Venons-en maintenant à Héroard, pour ne rien laisser à désirer aux vœux et favorables auspices de l’Université de médecine de Montpellier.Le très illustre Jean Héroard, légitime seigneur de la terre et des âmes de Vaugrigneuse, [45][79] mérite très amplement une place au premier rang des nobles et remarquables personnages de son temps, car il a fait luire jusqu’à Paris, très fameuse et incontestée capitale de la France, la gent et la célébrité montpelliéraines. Il naquit non loin du temple d’Apollon Esculape, [80] un 22 juillet, jour où notre Marie l’Égyptienne, [81][82] elle qui adora le Christ en lui essuyant les pieds de sa chevelure aimante, s’envola, munie du saint baptême de pénitence et toute nimbée de lumière, pour le séjour des saints et le merveilleux monde ; et le même jour, s’appuyant sur les vertus de cette sainte, tel un nouveau Soleil levant, Héroard a illuminé l’année 1551. [46] Et pour Montpellier, et pour Esculape, et pour la France, et pour tous les autres, cette naissance ne fut jamais infidèle à l’augure et au renom [Page 49 | LAT | IMG] que cet homme connaît à présent et connaîtra dans la postérité.
Épais suc lactescent de la très opulente glèbe et du sol paternel, et tout proche du Feu, n’étant encore qu’un petit garçon, dans la piètre et incertaine fortune de ce Guillaume, [83] en raison peut-être des défauts de son esprit ingrat, [47] il eut une enfance vagissante. Les débuts de son âge encore tendre et de son adolescence ne furent en rien privés du désir d’apprendre tout ce qui se présentait à lui, envie qui l’agitait sans relâche de toutes ses vertueuses forces : il a rampé, mais confirmé ce qu’on avait bien auguré de lui. Ensuite, séduit par les bienfaits et les agréments de son apprentissage, avec de rares interruptions dues aux mouvements du temps qui s’écoule inlassablement, il se voua à s’illustrer en l’art salutaire de la médecine et s’y appliqua avec zèle. Ayant délaissé tout le reste, puisqu’il vénérait cette demeure sacrée d’Apollon, et armé de tout son courage, il embrassa la déesse Panacée. [84] Il aurait alors poursuivi l’apprentissage de cet art secourable, qui est le plus noble de tous, jusqu’à obtenir les immortels lauriers du doctorat ; mais ses études ayant à peine commencé, [48] la force du destin, l’ampleur de son courage, la noblesse de sa race et de sa famille au service du roi, et son obligation envers son père en ont soudainement détourné Héroard, car la France entière s’enflait des guerres intestines qui l’avaient écrasée, et déjà presque ruinée et dévastée. Encouragé et mû par ce bienveillant génie, à la merci d’horribles dangers, Héroard glorifie Mars, [85] à moins qu’il ne s’agisse de Bellone, [86] il part à l’assaut, il bannit les belles-lettres, et abandonne la très salubre médecine et le plus sage des arts. [49] Le voilà qui repousse les études, empaume le glaive, auquel ses aïeux l’avaient brillamment préparé, laissant quelque peu de côté Hippocrate et Galien, ainsi qu’Avicenne, [87] brandit l’épée, au moment où sa bile s’était échauffée fort à propos. [Page 50 | LAT | IMG] Il s’aguerrit avec constance et résolution : sans dételer ni jamais s’abandonner à l’oisiveté, il prend plaisir à l’escrime, il en fait sa principale activité, consentant toujours au combat, exercice distrayant auquel il s’adonnait avec une adresse inouïe. Il pratique en fine lame, et il gagne. Ayant laissé de côté les friandises de la médecine pour les faits d’armes et pour le service désintéressé, à la gloire des grands, notre vaillant soldat se prépare à la guerre. C’est à ce moment que Condé, [88] dont il se démarquait vivement, et pour ses manières et pour ses visées, et Coligny, dont il épousait les vœux et le parti, menaçaient de ruiner entièrement Paris après en avoir rompu les remparts. [50] Rallié à une petite troupe, en compagnie de quelques amis, il sert dans l’infanterie légère en des contrées éloignées, pour l’un ou l’autre de ces deux chefs. D’abord, il combat glorieusement dans des escarmouches, puis il menace des armées rangées dans de très âpres engagements, il intercepte, il assaille, il vainc ; il est présent et très actif à la bataille qui eut lieu en Saintonge, à Bassac ou Jarnac. [89] Condé y fut tué, bien qu’il ne commandât pas tumultuairement, mais sagement : en luttant comme en y mourant, il n’a rien ôté au renom de ses aînés. [51] Par la bienveillance de Dieu, Héroard sort vivant de ce massacre et, avec Coligny, qui est sauf lui aussi, il prend la fuite, mais à contrecœur et en victime de l’adversité. Il marche à ses côtés pour attaquer et prendre Poitiers ; [90] pourchassée par le duc de Guise, [91] leur armée éprouve les hasards de toute guerre à Moncontour : la bataille y fut très rude ; dans cet engagement acharné d’armées très bien munies, Coligny n’a pas remporté une maigre victoire, car c’est lui qui pressait ses troupes, qui les menait, qui redonnait courage aux fuyards, qui venait en aide aux apeurés, qui protégeait les blessés contre les farouches ennemis. [52]
Après Moncontour et la mort de Condé, [Page 51 | LAT | IMG] dont il soutenait le parti, Héroard regagna Montpellier, où il songea à reprendre les études de médecine qu’il avait brièvement interrompues. Il y brille parmi les autres étudiants, qui s’affrontent souvent à lui dans de plaisantes et amicales disputes académiques, à tel point qu’il est admis à postuler le doctorat, après avoir enduré un si vaste océan de difficultés et être sorti vivant de son expérience guerrière. Quelques jours après, à l’unanimité des suffrages, les professeurs qui dirigeaient alors l’Université jugent notre docteur digne d’appartenir à la descendance d’Hippocrate et d’Esculape, mais non pas à celle de Botal, [92][93] ce charlatan qui est auteur de la pratique médicale empirico-méthodique de la Faculté de Paris. [94] On tient son savoir pour conforme et il est reçu. [53] Il a été formé par cette armée d’illustres personnages, dont beaucoup occupaient des places éminentes, mais aussi de parents et d’amis, dont l’autorité auprès du roi valait bien celle de quantité d’autres. Confiant dans leurs espérances et dans leur soutien, il fut aussi très stimulé par leurs aimables conseils. Parmi eux, Laurent de Fizes, secrétaire des très saints conseils, le plus cher ami de son père, François Sabbatier, prévôt du très saint trésor, son oncle maternel, ainsi que Desictæus, de la même autorité et du même ordre, ainsi que Guillaume Héroard, son parent, et un autre des commentateurs royaux, zélé assesseur des très saints conseils, n’ont pas tenu les moindres rangs. [54] Il se rend à la cour, il suit le roi, sans fréquenter trop assidûment les grands personnages, il intervient avec audace dans des consultations avisées. Son esprit adroit, joint à l’acuité de son intelligence, le mêle à la compagnie de politiques influents et lui acquiert du renom. Son dévouement [Page 52 | LAT | IMG] lui vaut d’être si bien reconnu que Charles ix, roi de France, songe souvent à le voir et à l’écouter, et qu’il est très fréquemment sollicité par ses apparentés et par ceux qu’une fréquentation très amicale et assidue a liés à lui. Ceux-là demandent au souverain de lui attribuer une charge et un office, et le roi accorde l’une et l’autre à Héroard, ne souffrant pas de se séparer de lui, en raison de ses multiples conseils et de la singulière affection qu’il porte à ses intérêts. [55] Héroard obéit à la loi et au roi, qu’il persuade et convainc d’ajouter à l’art médical, qui combat maintes maladies des humains, l’hippiatrie, qui est une pratique extrêmement difficile et qui s’est avérée hautement recommandable au cours des siècles passés. Séduit par le zèle de Héroard pour cette matière et par sa capacité à y consacrer tous ses soins, le souverain suit l’exemple du roi Alphonse d’Aragon, [56][95] qui avait jadis engagé deux docteurs en médecine très expérimentés en l’art de soigner chiens et chevaux malades, en les gratifiant d’un salaire élevé ; il attribue la charge de vétérinaire à Héroard, le nomme officiellement et lui alloue une rente sur les deniers royaux. [57]
Cela met alors Héroard en lumière aux yeux de tous, mais ne fait en rien taire aujourd’hui les médisances de Kakia [96] et de Capon, [97] ce que je ne mentionne pas ici sans malice, tous deux étant acolytes et suppôts de la Compagnie des médecins de Paris. [58] Après la mort du roi Charles, qui était, dirais-je, son héros, c’est pourtant vers notre illustre et vraiment sans malice Héroard que se tourne Henri iii, son frère et successeur, revenu de Pologne [98] pour prendre les rênes de la France. Il porte son regard sur lui, le choisit, l’ajoute au nombre des gens de sa Maison [Page 53 | LAT | IMG] et de sa cour, dont il le nomme médecin. [59]
En la 1584e année de la Rédemption de notre Salut, Héroard ne se soustrait pas et obéit à l’ordre que lui donne le roi d’accompagner l’illustrissime duc de Joyeuse dans son ambassade en Italie. [60] Beaucoup dénoncent déjà le faciès de renard, les yeux noirs enfoncés sous les sourcils, et si vous regardez plus haut, l’esprit farouche, vil et craintif de ce duc, qui comble tout haut Héroard de louanges, et lui fait valoir la priorité qu’il doit donner à combattre ses maladies et à préserver sa santé. Héroard endure la profonde haine des docteurs de la Faculté de Paris, et la désapprobation de ses collègues de Montpellier, qui l’accusent de fourberies visant sournoisement à servir plus sûrement ses propres intérêts et ceux de sa famille, en se vendant à l’ignoble petit peuple des courtisans ; mais le duc paie d’une immortelle reconnaissance cette immense faveur qu’il a reçue du roi. [61] Héroard jouit alors d’une grande autorité auprès du généralissime-duc, il l’assiste au plus près, comme si, tel un second Hippocrate de Cos, il s’était mis de bon cœur au service de Xerxès, roi de Perse. [62][99] Quant aux gratifications promises, Héroard, avec sa coutumière grandeur d’âme, ne se soucie guère de son sort, hormis ses honoraires réguliers. Joyeuse le poursuit en effet d’une si singulière bienveillance qu’il ne passe pas de jour sans Héroard : nulle décision sans l’avis d’Héroard ; nul sentiment sans Héroard ; nulle amicale discussion avec les courtisans sans Héroard ; Héroard en temps de paix comme de guerre ; Héroard est l’Orient et l’Occident du duc de Joyeuse ; pour lui enfin, Héroard toujours et partout, et jamais assez. [Page 54 | LAT | IMG] Mais en 1587, Joyeuse outrepasse toutes les bornes de la raison : il rallie à lui d’autres chefs d’armées, pour s’appuyer sur eux comme sur de très solides soutiens ; Héroard met son maître en garde contre la fidélité variable et l’amitié changeante de ses alliés ; Joyeuse lui ôte la dignité de conseiller ; emporté par l’ardeur changeante des tourbillons de la guerre civile, Héroard craint l’effondrement qui menace, il réduit son zèle à servir la cause publique, en consacrant ses veilles au royaume et à la bonne exécution de sa charge, mais il reste au service de Sa Majesté. Le duc prend la tête d’une armée royale, l’ardeur et le courage de tous les soldats promettent et font espérer les plus heureux succès, ce qui mérite bien d’être noté dans les annales. Cette troupe parfaitement équipée a dessein de terrasser, disperser et détruire celle des très perfides ennemis de la Couronne. Ainsi fortifiée par le duc de Joyeuse, elle décide et entreprend plutôt une guerre d’escarmouches contre le roi Henri de Navarre [100] et le Prince de Condé. [101] Héroard, dont les talents médicaux et guerriers sont sans égal, accompagne le duc avec un zèle et un courage égaux aux siens : il lutte à ses côtés, il combat, il attaque, il accourt, il encourage, il monte à l’assaut, il ravage, il saccage et il tue. Enfin, une bataille rangée s’engage à Coutras pour rompre l’élan de l’ennemi ; mais dans les actions guerrières, l’issue diffère toujours des prévisions : Navarre lance sa puissante armée en bon ordre à l’assaut dans l’arène, elle charge en rangs serrés et l’épée au poing ; elle massacre et, comme escortée par la foudre, elle renverse et fauche lamentablement les troupes royales. Ce carnage, illustre par le nombre de ceux qui y périrent et par l’affront qu’il infligea à la dignité des grands [Page 55 | LAT | IMG] du royaume, [63] est diligemment vengé par Guise, avec les reîtres qu’il tue à Auneau, aux confins du Pays chartrain ; [64][102] mais Coutras est un désastre pour le roi, pour le royaume et pour notre très vaillant Héroard, lui qui, lors de cette bataille, chaque fois qu’on resserrait les rangs face à la charge de l’ennemi, avait lutté au côté du duc de Joyeuse, en heureux augure du bon droit qu’il fallait remettre entre les mains du roi et de la France, car ce duc, qui dirigeait l’armée du souverain et du royaume, et qui était l’espoir de Héroard et l’objet de ses soins assidus, tomba entre les mains des soudards ennemis, et ces vautours se querellèrent pour savoir à qui reviendrait la gloire de tirer la balle qui tua un si illustre prisonnier.
Ainsi périrent aussi les belles espérances de Héroard : ne pouvant plus rien attendre de ce duc à qui il avait lié son destin, il confie son désespoir au roi, qui le coopte et reçoit sur la liste de ses médecins. Il reprend les travaux qu’il avait brièvement interrompus, se remet à écrire son Hippostologie, la développe et, dans la vive inquiétude de pouvoir la faire imprimer, prend soin de la creuser en profondeur, puis il la dédie et consacre au roi. [65] Dans cet intervalle, il s’est mêlé aux factions de malhonnêtes gens qui s’allient les unes aux autres, et à l’agitation des guerres civiles, pour arrêter et réprimer promptement les élans de ce funeste conflit intestin ; mais jamais il n’a abdiqué en se mettant à l’écart de ces clans. Le roi sort de Paris ; cette ville, qui est la plus célèbre capitale de toute l’Europe, n’effraie pas Héroard, mais il s’en éloigne pourtant. Il est entièrement dévoué au roi : quoi qu’il lui demande, tant en matière de médecine que de guerre, il est à son entière dévotion et obéit sur-le-champ à ses ordres. Au château de Saint-Cloud, [103] un sicaire, un quelconque [Page 56 | LAT | IMG] dominicain, [104][105] poignarde perfidement Henri iii et le tue (parricide monstrueux à maudire pour l’éternité). [66] Héroard, jusque-là rompu aux incessants revers de la fortune, sachant que nul mortel n’échappe à l’infinie et capricieuse diversité du destin, voue sa réputation, sa fidélité et ses services au roi Henri iv, tout en étant bien certain de tirer opprobre et moqueries pour avoir ainsi mis fin aux aléas de toute sa vie passée. Le souverain a de l’estime pour les médecins vétérinaires et approuve leur pratique.
Héroard brille au sein de l’honorable, antique et solennel Collège des secrétaires du roi (dit des boursiers), [67] car il n’a pas ménagé sa sueur en ces offices pendant quelques années, et s’est élevé à ce très haut rang par la noblesse de sa famille et de son art. Il y a conservé l’éclat de son prestigieux renom et de son excellente réputation jusqu’au dernier jour de sa vieillesse. C’est dans ces vœux que Henri iv a couvé des yeux celui qu’il savait très sûrement capable de briller dans le traitement des maladies comme dans les conseils, et enfin en toutes circonstances. Quand vient le tant espéré et heureux accouchement de l’illustrissime reine, le roi réfléchit à qui confier la charge de premier médecin du futur dauphin et de la descendance princière. Parmi la foule de ceux qui l’ambitionnent avidement, il désigne notre illustre Héroard ; il demeure ferme et constant dans sa décision, contre le gré de tous les autres, mais avec l’approbation publique de La Rivière et Du Laurens, [106] médecins de Leurs Majestés. [68] Cette résolution royale ne surprend guère Héroard : [Page 57 | LAT | IMG] de longue date, Henri iv s’était fait la meilleure opinion de cet homme qui n’avait aucunement la prétention d’appartenir à l’élite médicale. Le 15 septembre 1601, par l’entremise de la noble et très estimable Madame de Guercheville, [69][107] le roi lui écrit une lettre et M. La Rivière, son premier médecin, lui en adresse une autre le 17e du même mois. Après les avoir lues et méditées, Héroard se rend deux jours plus tard à Fontainebleau, [108] où le roi se repose. Le lendemain, quatre heures après midi, tandis que Héroard cherche à savoir si le dessein du roi n’a pas changé, Sa Majesté, que la chasse vient de grandement distraire, l’appelle à lui ; dans le bruit et la bruine des jets d’eau, il le fixe du regard avec insistance, puis l’avise en disant d’un ton impérieux, comme à son habitude : “ Héroard, je vous ai choisi pour médecin du dauphin qui va naître. Prenez-en diligemment soin ! ” Puis vient le moment tant attendu de l’accouchement, événement dont l’importance et la gloire sont si grandes que l’heure en reste mémorable : le 27 septembre de la même année, que Jupiter [109] a parée pour la faveur du prestige de la Couronne et des Français, un dauphin apparaît, tel un Soleil levant dans toute sa splendeur ; il est une très féconde source de bienfaits et l’apogée de la majesté royale. [70]
Aussitôt, afin que de noires et nocturnes vapeurs n’obscurcissent pas cet éclat, Héroard ajoute quelques grains de mithridate [110] à une cuiller de vin blanc, qu’il donne à sucer à l’enfant pour le ranimer. Ensuite, pour épanouir et garantir la vigueur de ses sens, il le réchauffe en lui frictionnant entièrement le corps et la tête avec du vin rouge, mêlé à une quantité adéquate d’huile rosat. [111] Le lendemain, [Page 58 | LAT | IMG] 28e jour de septembre, Guillemeau le père, chirurgien du roi, en s’y reprenant à plusieurs fois, lui incise et tranche le frein de la langue qui le gênait pour téter ; [71] son opération a accaparé toute l’attention de Héroard, à qui avait été confiée la charge sacrée de cette gloire de la France, conformément à la volonté et à l’affection de notre très invincible roi, ainsi que des premiers médecins, MM. La Rivière et Du Laurens, qui étaient tous transportés de la joie la plus extrême. Afin de nourrir et élever ce dauphin nouveau-né, on décide et ordonne qu’il jouisse de l’air plus sain de Saint-Germain-en-Laye, [112] pour son meilleur avantage, et ceux de son très vénérable père, de ses médecins et de toute la France : ainsi en advient-il, le moment venu. [72] Aussi veilla-t-on sur la très précieuse vie de ce prince, dont la complexion se montrait saine, mais fragile. Si son médecin ne l’avait pas épaulée, car elle avait menacé de chanceler dès le berceau, et si Héroard n’avait bénéficié de mains aidantes, le deuil et les larmes auraient inondé la France entière, que les autres pays du monde regardaient avec extrême attention. On mène donc le dauphin à Saint-Germain, en compagnie de Héroard ; les très éminents MM. La Rivière et Du Laurens sont transportés d’une joie peu commune toutes les fois que s’affermissent leurs certitudes sur les grands talents de cet homme, de ce héros et de ce médecin ; et le roi ne manque pas de s’en réjouir lui-même publiquement. La constitution très fragile du dauphin de France, premier prince du sang, et l’intempérie de toutes les parties de son corps [Page 59 | LAT | IMG] étaient préoccupantes. Héroard rapporte avec art et sans façon que, le 12 janvier 1604 vers six heures de l’après-midi, l’enfant se met à bégayer ; [73][113] de même aussi pour la hernie intestinale apparue tandis qu’il jouait au ballon, le 19 septembre 1602, [74][114] que, suivant son devoir, Héroard a traitée en administrant des remèdes anodins, en vue de lui rétablir et protéger la santé ; il le guérit entièrement et sur-le-champ de cette maladie rebelle, au très grand plaisir du roi, de la reine et des médecins alors présents à la cour. Voilà comment, grâce aux secours d’un meilleur naturel, du roi et de la sérénissime reine, de la France et de tous les soins de Héroard, le dauphin est passé d’un état médiocre et des soupirs d’une complexion languissante, à une santé plus ferme et mieux assurée. Par le livre qu’il a publié sur l’institution morale des princes et qu’il lui a dédié, [75] Héroard, en très brillant homme et très sage médecin, a aussi fait passer le dauphin des jupes et des bagatelles des femmes, j’entends celles de la cour, qui n’ont ni grand talent pour les lettres ni la moindre aptitude pour les armes, à l’autorité du sage et prudent administrateur (bien que les finesses des femmes héroïques ne manquent ni de sagesse ni de prudence), sans oublier ni la gloire ni le jugement des princes. Il saura et devra entendre ce livre avec un œil reconnaissant et le sourire aux lèvres.
Sur ces entrefaites, un funeste et terrible trépas emporte notre très généreux et invincible Henri iv ; [40] et le 25 mai 1610, jour où le dauphin, qui est l’espoir le plus cher de la France, devient roi, il désigne Héroard pour occuper de plus hautes fonctions. [Page 60 | LAT | IMG] Sur les recommandations de l’illustrissime et très-chrétienne reine, il reçoit enfin la profondément vénérable et extrêmement honorable charge de premier médecin du roi. Il l’a assurée depuis cette date jusqu’au 10 février 1628, quand Louis xiii, le plus juste des rois, assiégeait La Rochelle, [115] encerclée et attaquée par ses armées, pour griefs de haute trahison, car elle était devenue un retranchement très sûr pour les rebelles, mais nuisible pour la France. [76] Pendant vingt-sept ans, Héroard a diligemment assuré sa charge au plus haut niveau d’honneur, de renom, de réputation et d’estime. Il l’aurait fait plus longtemps encore si, dans la soixante-seizième année de son âge, de sa naissance et de son éclat, cette période critique, où le Soleil éthéré parcourait le dix-huitième grade décisif du Verseau, quand le malveillant Saturne frappe de ses coups cette splendeur éthérée d’Ætreus, [77] ne l’avait soustrait à l’affection du roi, du royaume et de ses amis, et au gosier féroce et vipérin de Guillemeau. [78] Son lumineux rayonnement, l’exemplaire probité de ses mœurs, sa grandeur d’âme, la générosité de son opulence, sa bonté et la recommandation de sa bonté, son zèle et son amour de la recommandation, sa douceur en affection, sa propension innée à accorder des faveurs, sa coutumière réticence à les accepter, et la retenue de tous ses mouvements d’humeur ont immortalisé sa mémoire, malgré la jalousie des botalistes et de tous les autres : que d’affliction, que de larmes ! [79]
Εμοι δ᾽ αχος οξυ γενεσκετο, κηροθι μαλλον
Ανθρωποισιν απασι και εσσομενοισιν αιδην
Αλλα μεν. » [80][116]
Épilogue
Sans prétendre avoir mené une enquête complète, j’ai prêté une particulière attention aux travaux de trois autres biographes qui se sont depuis penchés sur Jean Héroard.
- L’article de Jean Astruc, dans ses Mémoires pour servir à l’histoire de la Faculté de médecine de Montpellier (Paris, 1767, pages 364‑ 367), a longtemps servi de référence.
« Il est fâcheux d’être obligé, comme je le suis, de prendre les particularités de la vie de Jean Héroard dans les ouvrages d’un de ses plus grands ennemis, car on ne saurait donner d’autre titre à Charles Guillemeau, dont j’entends parler et qu’il importe de faire connaître pour juger du poids de son témoignage. Il était fils de Jacques Guillemeau, habile chirurgien de Paris, et chirurgien du roi. Il avait acheté, étant encore jeune, la charge de premier chirurgien du roi ; mais flatté de quelques marques de confiance que le roi Louis xiii lui donna, il crut pouvoir aspirer à un poste plus brillant. Guy Patin, qui l’avait bien connu, dit que c’était un rusé courtisan, qui avait grande envie de faire fortune. [81] Il quitta donc sa charge de premier chirurgien, se mit sur les bancs de la Faculté de médecine de Paris, et y reçut le bonnet de docteur en 1625 < sic pour : décembre 1626 >. Revêtu de ce grade, il reparut à la cour et, pourvu d’une charge de médecin par quartier, aspira à la place de Héroard, premier médecin ; et pour l’obliger, à force de dégoût, de s’en démettre, il contrôla et blâma sa conduite dans toutes les occasions.
Près de 20 ans après la mort de Héroard, Sim<é>on Courtaud, son neveu, parle de la conduite de Guillemeau et de son ingratitude envers son oncle dans sa fameuse ouverture de l’École de Montpellier en 1644. [3] Ce fut assez pour mettre Guillemeau en fureur. Il fit contre l’oncle et contre le neveu deux satires violentes, où il entasse les injures les plus grossières, comme il serait aisé de le prouver par les titres mêmes qu’il leur a donnés, si j’étais capable de vouloir salir mon ouvrage jusqu’à les rapporter. [82] Mais comme je connais le fonds que l’on doit faire sur ce que dit Guillemeau, je saurai, en parlant de Héroard, me défier, comme je le dois, de la fureur qu’il n’a pas été maître de contenir.
Jean Héroard était de Montpellier. Il fut immatriculé dans le Registre de la Faculté le 27 août 1571, et prit ses degrés en 1575 ; [48] il alla à Paris peu de temps après, et par l’amitié de Jacques Guillemeau, père de Charles, qu’il avait connu à Montpellier, où il était allé pour se perfectionner en chirurgie, il fut reçu chez M. de Joyeuse ; et c’est par le crédit de ce seigneur qu’il obtint l’agrément d’une place de médecin par quartier, qu’il garda pendant le règne de Charles ix et de Henri iii. C’est en cette qualité qu’il fut présent à l’ouverture du corps de ce dernier prince. [83][117]
Sous Henri iv, il eut le bonheur de s’introduire auprès du duc de Bellegarde, [38] favori du roi ; et c’est par sa protection qu’il obtint, à la grossesse de la reine Marie de Médicis, le brevet de premier médecin du dauphin qui naîtrait. Guillemeau prétend qu’il fallut pour cela acheter l’approbation du sieur Ribit de La Rivière, premier médecin, et qu’il lui en coûta huit cents écus. [37]
Cette place mena bientôt Héroard à la première place < sic > parce que le dauphin devint bientôt roi, par la mort malheureuse de Henri iv. Il s’y soutint jusqu’à sa mort avec honneur et avec la confiance du roi, nonobstant les basses manœuvres et les sourdes détractions de Guillemeau, qui ne cessait de blâmer sa conduite dans toutes les incommodités du roi, lesquelles étaient fréquentes. Tantôt, c’était une saignée faite trop tard ; tantôt, une purgation ordonnée trop tard < sic pour : tôt (?) >. On condamnait surtout le régime [118] qu’il laissait garder au roi, et qui était effectivement très mauvais et contribuait à le rendre souvent malade. Mais le roi était né avec une mauvaise constitution. Il était très peu docile, et par conséquent très difficile à conduire sur le régime ; n’aimant que ce qui était contraire. Héroard faisait tout ce qu’il pouvait pour retenir le roi, et pour tâcher de réparer les torts qu’il se faisait par son intempérance ; mais il avançait peu. On peut voir sur tous ces détails le traité composé par Robert Lyonnet, [119] médecin du Puy, intitulé Dissertatio de morbis hæreditariis, imprimé à Paris en 1646 < sic pour : 1647 >, in‑4o. Voici comme il parle de Louis xiii : simplices omnes cibos aversabatur, varietate explebatur, nec nisi tostis et frixis, salsamentis, embammatis, artocreate, placentis, rebusque multo saccharo conditis, et aliis gustum acuentibus delectabatur ; jusculorum, carnium elixarum, ipsius etiam panis, nisi assati usum abhorrebat, [quibus etiam ministrorum favebat assentatio : nam a subornato quodam ex ephebis, sibi singulis matutinis, ex urbe lucanicas clanculum ad ientaculum deferri solitas, ipse sæpius affirmavit, dum pueriles delicias recenseret,] atque horum sive usu, sive caloris et siccitatis incremento sitis intendebatur, invalescebat incendium, dum etiam inane vini aromatitis hauriret pateram, et vinum inter pastus minus dilutum. [84][120]
Malgré toutes les menées de Guillemeau, Héroard conserva toujours la confiance du roi. Il mourut au siège de La Rochelle en 1627 < sic pour : 1628 >, où le roi se trouvait en personne. Charles Bouvard, docteur de la Faculté de Paris, lui succéda. On prétend bien que Guillemeau ne négligea rien pour tâcher d’être nommé à cette place, mais ses brigues furent inutiles. Elles déplurent cependant au cardinal de Richelieu, qui l’éloigna de la cour où il ne put revenir qu’avec beaucoup de peine et par la protection du prince de Condé. » [81][121]
- Eudore Soulié et Édouard de Barthélemy ont fourni quelques détails supplémentaires dans l’Introduction de leur édition partielle du Journal de Jean Héroard (Paris, 1868). [85]
- Une curieuse supposition apparaît page lxii :
« Dans son Histoire des secrétaires d’État, publiée en 1668, Fauvelet du Toc [122] prétend que lorsque Charles de Beauclerc [123] fut nommé secrétaire d’État en 1624, il le fut “ avec un applaudissement si universel que le cardinal de Richelieu, qui commençait à s’introduire au ministère, en eut de la jalousie ; il appréhenda qu’il ne fît quelque obstacle à son élévation, et ne put s’empêcher de dire qu’il ne craignait que deux hommes auprès du roi, M. de Beauclerc et Héroard, premier médecin de Sa Majesté. ” [86] Si ce mot est historique, il faudrait peut-être ajouter foi à un document d’après lequel “ le sieur Héroard ” est compris parmi les personnages “ emprisonnés sous le ministère du cardinal ” (Archives curieuses de l’histoire de France, 2e série, tome v). [87] Cette détention pourrait être la vraie cause d’une des longues interruptions qui existent dans les dernières années du journal et que des notes ajoutées après coup attribuent à la négligence de la veuve et des parents de Héroard, qui auraient “ misérablement perdu, pillé, dissipé et vilainement employé ” de nombreux cahiers du manuscrit. »
- La querelle avec Charles Guillemeau est détaillée pages lxiv‑lvi :
« Jean Héroard était mort depuis seize années lorsque son nom se trouva mêlé, d’abord incidemment, puis avec un éclat bien fâcheux pour sa mémoire, dans la controverse qui agita les facultés de Paris et de Montpellier pendant la seconde moitié du dix-septième siècle. Un des neveux maternels et héritiers de Héroard, Sim<é>on Courtaud, après avoir été, par la protection de son oncle, pourvu pendant quelque temps d’une charge de médecin par quartier, s’était retiré à Montpellier où il était devenu doyen de la Faculté. En 1644, Courtaud, dans un discours latin prononcé à l’ouverture de l’École de Montpellier, mentionne Héroard parmi les docteurs sortis de cette École qui avaient eu l’honneur d’occuper la première place auprès des rois de France. [88] Cette apologie, imprimée à Montpellier, vient aux oreilles des médecins de Paris et provoque de la part d’un d’entre eux, Jean Riolan, une longue réponse publiée en 1651 sous le titre de Curieuses recherches sur les écoles de médecine de Paris et de Montpellier, [3] dans laquelle Riolan insinue en passant que Jean Héroard n’a pas été choisi parce qu’il avait étudié à Montpellier, mais parce qu’il se trouvait déjà auprès de Louis xiii au moment de sa nomination comme premier médecin du roi. Sim<é>on Courtaud réplique en 1653 par un gros in‑4o intitulé Seconde Apologie de l’Université en médecine de Montpellier, etc., envoyée à M. Riolan, professeur anatomique ; [6] et là il reprend l’éloge de son oncle Héroard, à propos de la préférence donnée par les rois à la Faculté de Montpellier sur celle de Paris ; puis il attaque Charles Guillemeau comme ayant abusé de la confiance de son collègue et ami Héroard “ pour mugueter la charge de premier médecin ”. C’est alors que l’année suivante, Charles Guillemeau entre dans la lice avec le libelle latin dont nous avons extrait et traduit librement quelques passages. Il y attaque avec une violence inouïe Héroard et son neveu, qu’il n’appelle pas autrement que le chien Courtaud, et il termine sa brochure par ce parallèle entre Riolan et Héroard : “ Jean Riolan est né à Paris d’un père éminent dans les lettres et dans la médecine, et n’a fait qu’augmenter la gloire du nom de son père ; Jean Héroard a eu pour père un méchant barbier de Montpellier, et le plus ignare de tous parmi les barbiers. Jean Riolan, après avoir puisé les principes sacrés de l’art de la médecine à la Faculté de Paris, a reçu d’emblée son bonnet de docteur ; Jean Héroard n’a jamais été reçu médecin, mais seulement bachelier dans votre École, et encore, par la complaisance du grand Conseil et du doyen de Montpellier. Jean Riolan a érigé des monuments immortels, divins, dans les lettres et dans l’art de la médecine ; Jean Héroard n’a jamais écrit que son Hippostologie, ouvrage bien digne d’un vétérinaire et qui fait que toute la France s’écrie qu’il n’a jamais été un médecin royal, mais un médecin de cheval ! ” Enfin, nous en passons et des meilleurs, “ est-il possible, dit-il à Courtaud, de comparer, sans la plus mortelle injure, Jean Héroard avec ce grand médecin, Jean Riolan ? Non ! il faut le comparer, ton Héroard, à ces charlatans africains dont les éloges, et telle était la Ludovicotrophie de ton oncle, tuaient les gens de bien, pétrifiaient les arbres, faisaient périr les enfants ! à ces Triballiens et Illyriens, peuples de la même espèce, qui ensorcelaient par leurs regards et mettaient à mort tous ceux sur qui ils tenaient trop longtemps les yeux attachés ! Ah ! roi infiniment trop bon ! Ah ! il t’a regardé trop longtemps de son mauvais œil, cet Héroard ! Il faut le comparer encore avec ces sorcières de Scythie, appelées Bythies, avec cette race de Thibiens Pontiques dont Philarque écrit à Pline [124] qu’ils avaient dans un œil deux pupilles et dans l’autre la figure d’un cheval : ce qu’un ami de la médecine peut bien dire d’un médecin de cheval, d’un archi-âne tel que Héroard !... Reléguons-le, cet Héroard maudit, qui a abrégé la vie de son roi et n’a point péri lui-même, parmi ces peuples d’Éthiopie dont l’odeur et les exhalaisons communiquaient la peste par le seul contact de leur corps ! ” [89]
On croirait vraiment, à entendre Guillemeau, que Louis xiii n’a pas survécu quinze ans à son premier médecin ; mais est-il bien nécessaire d’insister plus longtemps sur ces invectives qui se reproduisirent, avec plus de violence encore, dans deux brochures latines publiées l’année suivante, [82] et qui auraient été sans doute suivies de bien d’autres, sans la mort de Guillemeau, arrivée en 1656 ? Cédons pourtant à une dernière tentation, en ce qui concerne Guillemeau, pour rappeler, nous l’apprenons de lui-même, que ce médecin était un protégé du grand louvetier Saint-Simon, [125] père de celui qui s’est montré lui-même si passionné et si injuste dans ses célèbres Mémoires. [90] Les injures, les calomnies, si peu fondées qu’elles soient, laissent toujours après elles, surtout lorsqu’elles se produisent après la mort et que les individus attaqués ne peuvent plus se défendre, des traces profondes, des préventions invincibles. C’est ainsi que Guy Patin, dont l’esprit satirique était d’ailleurs tout disposé à prendre parti pour la Faculté de Paris, dont il était doyen < sic pour : avait été >, écrivait encore en 1663 à son ami André Falconet, médecin de Lyon : “ M. Bouvard m’a dit autrefois qu’il avait entretenu le feu roi du mérite et de la capacité de quelques médecins par les mains de qui Sa Majesté avait passé ; et après qu’il lui en eut dit ce qu’il en savait, que le roi s’écria, Hélas ! que je suis malheureux d’avoir passé par les mains de tant de charlatans ! Ces messieurs étaient Héroard, Guillemeau et Vautier. Le premier était bon courtisan, mais mauvais et ignorant médecin. M. Sanche, le père, [126] m’a dit l’année passée que cet homme ne fut jamais médecin de Montpellier. ” » [81]
- Une curieuse supposition apparaît page lxii :
- Madeleine Foisil a apporté de précieux éléments nouveaux dans l’Introduction de son édition du Journal de Jean Héroard (Paris, 1989). [91] J’y ai relevé ces détails complémentaires.
- Naissance de Jean Héroard
Son grand-père, Eustache Héroard, [127] originaire de Normandie, vint à Montpellier au début du xvie s., où il devint chirurgien, avec cette note 3, page 39 :
« Les notices faites sur Jean Héroard affirment toutes qu’il est né en Normandie près de Saint-Lô, à Hauteville-le-Guichard. [128] Deux érudits normands sont à l’origine de cette tradition. […] Une enquête récente faite par Yves Nédélec, directeur des Archives de la Manche, précise que les registres paroissiaux de Hauteville-le-Guichard ne vont pas au delà de 1643 et qu’on ne trouve aucune trace de Jean Héroard dans cette région, bien que l’on y rencontre encore aujourd’hui le patronyme. L’étude d’autres documents originaux confirme les recherches inédites d’Yves Nédélec. Jean Héroard n’est pas normand, mais montpelliérain. »
- Jeunesse de Jean (pages 44‑45)
- Aux armées
« À dix-huit ans, il suit les armées qui se mobilisent pour la troisième guerre de Religion et participe à la bataille de Moncontour, le 30 < sic pour : 3 > octobre 1569. [22] C’est le médecin Guillemeau, ennemi juré de Héroard, qui nous donne cette précision, en ajoutant aussitôt avec malveillance qu’il s’enfuit au premier coup de canon. »
- Études médicales
« Le 17 août 1571 est une date essentielle. Il a vingt ans et s’inscrit à l’Université de médecine de Montpellier où ont étudié son grand-père et son oncle, et où ce dernier a été professeur ; le registre matricule, précieusement conservé, nous a gardé la mention manuscrite de son nom. [92] À ce moment même, Guillaume < sic pour Gilbert > Héroard, son oncle, subissait l’ostracisme en raison de la querelle religieuse : prétendant à la place de docteur régent de L’Université, vacante par la mort d’Honoré Castellan, [129] il en fut écarté au bénéfice du catholique Jean Hucher. [130] Des conditions exactes dans lesquelles Héroard fit ses études, nous ne savons rien, faute de document.
En 1574, il quitte Montpellier pour ne plus y revenir. C’est une autre date essentielle de sa vie. En entrant au service des grands et des rois, il prend le chemin qui le conduira, vingt-sept ans plus tard, auprès du dauphin. »
- Aux armées
- Gilbert Héroard, oncle de Jean (pages 40‑42)
Gilbert aurait abandonné la médecine et serait parti s’établir à Paris pour entamer une carrière de partisan. Ses deux fils, Pierre, sieur du Mesnil, [131] et Jean, sieur de Raincy, [132] l’auraient suivi dans la carrière des finances et auraient fait banqueroute en 1643. [93]
- Religion de Jean
- Page 42 :
« Ainsi, l’appartenance de la famille Héroard au milieu protestant, l’ardente personnalité huguenote de Michel Héroard, dont les textes et les mémoires officiels nous rendent compte, demandent-elles à être soulignées. Toute la sensibilité de Jean Héroard, jusqu’à un âge avancé, a été imprégnée de protestantisme. Même si autour de cinquante ans, dans les années qui précèdent son entrée au service du dauphin, il se convertit au catholicisme, [133] il ne faut point oublier les racines huguenotes d’un homme qui sera l’un des éveilleurs de la conscience et de la personnalité du futur roi. »
- Page 51, Le huguenot catholique, le catholique huguenot :
« C’est en ces termes, en effet, que l’on peut définir l’appartenance religieuse de Héroard, dont l’évolution reste floue. Protestant dans la première moitié de sa vie, catholique à la fin, à quelle date se fit sa conversion ? En 1601, il épouse Anne de Vaugrigneuse [134] devant la sainte Église catholique et romaine. En 1628, tandis que les Héroard de Paris sont inhumés à Charenton, [135] cimetière protestant, il est inhumé en terre d’Église, à Vaugrigneuse, dont il est le seigneur et le protecteur. Est-il un catholique récent ou doit-on faire remonter beaucoup plus haut son abandon de la religion protestante ? A-t-il pu être au service du dévot Anne de Joyeuse, avoir une charge à la cour de Charles ix et plus encore à celle de Henri iii, garder leur confiance, tout en appartenant à la Religion réformée ? Tandis qu’au lendemain des Barricades (12 mai 1588), [136] Henri iii disgracie toute une partie de son entourage qui ne lui inspire pas confiance (le catholique Villeroy, [137] le catholique La Vrillière, [138] le catholique Miron, [139] etc.), [94] il garde Héroard. Mais celui-ci est un fidèle de Henri iv après l’assassinat de Henri iii. Pourrait-il l’être sans continuer de faire partie de la Religion réformée ? Autant de questions auxquelles le silence des textes ne permet pas de répondre…
Pierre de L’Estoile [140] affirmait qu’en 1601, il était toujours protestant : un an plus tard, il était catholique. En 1618, un certain Frizon lui dédia un pamphlet contre Pierre Du Moulin, [141] le fameux pasteur réformé de Charenton, où il évoque, sans en préciser la date, la conversion du médecin : “ À Monsieur, Monsieur Héroard, premier médecin de Sa Majesté très-chrétienne. Monsieur, Dieu vous ayant fait la grâce par sa miséricorde infinie de reconnaître, il y a longtemps, la nullité de la Religion prétendue réformée, vous avez été béni du Ciel. ” » [95]
- Page 42 :
- Soucis de Jean à la cour (Pages 45-46)
« Carrière d’une apparente uniformité, mais dans laquelle certains détails permettent de distinguer des fragilités, des à-coups. On les voit apparaître à partir de juillet 1608. Il semble que l’on ait remis en cause la charge de Héroard auprès de l’enfant et qu’il ait dû son maintien à Marie de Médicis. Il écrit ainsi le 15 juillet 1608 : “ À dix heures et un quart, à la messe ; puis va donner le bonjour à la reine où je la remerciai de ce que le jour précédent, elle m’avait fait l’honneur de faire résoudre au roi que je demeurerais premier médecin de Mgr le Dauphin. ” Malgré cela, en octobre 1608, on peut constater qu’encore une fois, le médecin doit faire face à des intrigues, alors qu’il s’est absenté durant neuf jours pour aller à Vaugrigneuse. Pendant son absence, l’enfant tombe malade de la rougeole, [142] et est atteint par toute une série de maladies ; le premier médecin aurait dû être appelé en hâte. Or, le 30 octobre, Héroard se confie à son Journal et laisse transparaître amertume et mécontentement : “ L’on ne me donna jamais avis qu’il eût aucune fièvre, mais un simple rhume. [143] Je le trouve avec la fièvre, pouls plein, égal, hâté, chaud, la face toute couverte de rougeurs. ” […]
Richelieu […] alla-t-il jusqu’à faire emprisonner Héroard ? Les premiers éditeurs du Journal, Soulié et Barthélemy, le pensent en s’appuyant sur un document dont l’interprétation est discutable ; mais une lettre de Peiresc [144] à Valavez [145] confirme l’insécurité dans laquelle il se trouvait : “ M. de Guise [146] (…) disait l’autre jour que M. Hérouard avait eu son congé, il nous tarde d’en savoir la vérité. ” » [96]
- Les Guillemeau (note 1, page 45)
« Deux médecins < sic pour : praticiens > Guillemeau ont été dans l’entourage de Jean Héroard et ont joué envers lui un rôle exactement contraire. Jacques Guillemeau, 1550-1613, élève de Riolan [147] puis disciple d’Ambroise Paré, chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Paris, [148] médecin des rois Charles ix, Henri iii, Henri iv. C’est lui qui avait favorisé la venue de Héroard à la cour. Le 1er avril 1609, il lui dédicaça son ouvrage, De la nourriture et gouvernement des enfants, Paris chez Nicolas Buon. [97][149]
Charles Guillemeau, fils de Jacques, médecin de la Faculté de Paris en 1626, en fut le doyen en 1634-1635 < sic pour : 1636 >. Il manifesta une violente hostilité à l’encontre de Héroard, et sa malveillance contribua à la mauvaise réputation de celui-ci. Il écrivit contre lui un pamphlet, Cani miuro. »
- Naissance de Jean Héroard
Ombres et lueurs
Les trois biographies françaises de Jean Héroard que j’ai consultées ne se sont intéressées qu’à la première de ses deux Vies latines, le Cani miuro de Charles Guillemeau ; mais elles ont entièrement ignoré la seconde, celle du Genius Pantoulidamas, où l’École de Montpellier répond vigoureusement aux attaques parisiennes. Polémiques, contradictoires et rédigées dans une langue barbelée, leur ton diffère du tout au tout, passant du tombereau d’injures, dans la première, à la corbeille de louanges dans la seconde. Toutefois, les événements relatés et leurs dates s’y complètent sans beaucoup s’y contredire, après qu’on a fait la part des propos outranciers, aussi suspects d’un côté que de l’autre. Ce sont des textes précieux car écrits par des témoins et acteurs directs des faits, 16 ans après la mort de Héroard, éminent médecin de la cour qui a joué un rôle capital dans la vie intime de Louis xiii.
Il subsiste des zones obscures, mais beaucoup de lacunes sont comblées, notamment sur la carrière militaire de Héroard, qui passa du parti huguenot, aux côtés de Coligny à Jarnac (mars 1569) puis Moncontour (octobre suivant), au parti catholique, aux côtés de Joyeuse à Coutras (juin 1587). Dans l’intervalle, l’existence de Héroard avait pris deux virages importants.
- Immatriculé en 1571, comme l’affirment Astruc et Foisil, il fut gradué médecin par l’Université de Montpellier ; mais sa première inscription date plus probablement de 1568, car le Genius Pantoulidamas, tout de même plus crédible sur ce point, dit qu’il interrompit ses études médicales à peine commencées pour s’enrôler en 1569 dans les armées protestantes. [48]
Il est possible qu’il n’ait jamais été reçu docteur : Guillemeau dit qu’il ne dépassa pas le baccalauréat ; [89] Patin, sur la foi de Pierre i Sanche, professeur de Montpellier, écrit qu’il « ne fut jamais médecin ». [81] Le Genius Pantoulidamas (sans date précise) [53] et Astruc (en date de 1575) font état d’un doctorat (mais Astruc ne parle que de « ses degrés ») que Héroard aurait obtenu, tout en semblant bien avoir définitivement quitté Montpellier en 1574 (selon Guillemeau, non contredit par le Genius Pantoulidamas et suivi par Foisil) et en s’étant sûrement mis au service du roi Charles ix à Paris, « quelques mois » avant la mort du souverain, en mai 1574 (selon Héroard lui-même, dans la dédicace de son Hippostologie). [57] Serait-il inconcevable qu’un médecin royal ne fût pas docteur gradué ? Je n’en suis pas persuadé et je me demande si les Montpelliérains (en 1654) et Astruc (en 1767) auraient osé en convenir quand ils chantaient la gloire de leur École médicale.
- Héroard s’est sûrement converti du calvinisme au catholicisme, mais quand exactement ? L’Estoile semble le dire encore protestant en 1601. Néanmoins, la plaisanterie dont il assaisonne sa relation [95] n’interdit pas de penser que ce fut longtemps avant : il était en effet commun de reprocher, toute leur vie durant, leur ancienne confession à ceux qui l’avaient abjurée ; Patin, dans ses lettres et dans ses ana, ne s’est jamais privé de le faire. Une date plus plausible me paraît être le passage au service du roi (1574), pour aider le jeune médecin « étranger », qu’il était alors, à entamer plus à l’aise sa lente mais remarquable ascension jusqu’à la charge suprême d’archiatre. [55]
Quoi qu’il en soit de ces deux questions, il est désormais difficile d’ignorer l’intégralité des deux Vies latines de Héroard dont j’ai présenté les traductions jusqu’ici inédites, en les commentant pour en résoudre les apparentes contradictions. Conscient de leur intérêt historique, je les ai voulues les plus fidèles possible, en dépit des difficultés que j’ai rencontrées à les convertir en français lisible et des quelques incertitudes qui y subsistent.
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Autobiographie de Charles Patin
(Lyceum Patavinum, 1682)
Codes couleur
Citer cette annexe
Imprimer cette annexe
Imprimer cette annexe avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8226
(Consulté le 06/05/2024)
[Page 77 | LAT | IMG] Fuir la lumière des hommes, et se soustraire au jugement du vulgaire, voilà certes la meilleure manière de vivre tranquille, comme l’enseigne cet antique proverbe rebattu, Vis caché, que le poète [2] a élégamment traduit :Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit, et infra
Fortunam debet quisque manere suam. [1]N’y a-t-il pas lieu de méditer sur ce précepte que les Anciens ont justement énoncé autrement ? Surtout quand nous avons sous la main l’opuscule que Plutarque a tout entier consacré à ce sujet, où il nie qu’il faille suivre ce conseil des sages antiques ? [2][3] Et plus encore, quand nous avons du même auteur un autre traité, Comment on peut se louer soi-même sans s’exposer à l’envie, où il enseigne fort élégamment qu’il est permis au sage de se louer lui-même ? [3] Quoi qu’il en dise, cela est assurément tout à fait étranger à ma disposition d’esprit, car je ne connais absolument rien de plus imprudent que d’écrire sur soi-même ni, certes, rien qui me soit plus désagréable ; mais plusieurs raisons sont ici parvenues à m’empêcher de respecter ma volonté et ma résolution : l’une est de produire un ouvrage que j’ai estimé ne pas devoir laisser incomplet ; une autre tient aux prières de mes amis qui, depuis longtemps, ne se contentent pas de me demander cela, mais [Page 78 | LAT | IMG] l’exigent comme un dû, car ils n’ignorent pas quel a été mon sort, qui m’a roulé deçà delà comme un jouet de la Fortune, [4] et poussé, bien contre mon gré, à voir tant d’hommes et de contrées, et à m’exhiber sur le théâtre du monde. Pour donc ne pas paraître repousser leur affectueux conseil ni mépriser leur souhait, j’ai à cœur de dire aussi maintenant quelque chose de moi. [4] Au jugement de Tacite, dans la Vie d’Agricola, c’est la confiance en leurs bonnes mœurs ou quelque forme d’arrogance qui détermine les auteurs à écrire leur propre vie. [5][5] Ni l’une ni l’autre ne m’a poussé à le faire, mais bien l’exigence du livre que je publie ; et sans aucun désir de gloire, j’y exposerai mon existence telle qu’elle s’est véritablement déroulée, en la donnant aux autres à voir comme au travers d’une claire-voie.
[Enfance, 1633-1647]
J’ai eu pour père Guy Patin, médecin et professeur royal, [6] à la suite de Jean Riolan. [7] Ce fut un homme éminent et doté d’un immense savoir, à qui on donnait les surnoms de bibliothèque vivante et de musée ambulant. [6][8] Je semblerais retrancher à sa gloire méritée si j’ajoutais quoi que ce soit à la piété que j’ai montrée à l’égard de sa mémoire. Le souvenir de cet homme est encore maintenant en honneur dans les esprits des lettrés : il l’y a animé par la maîtrise de son art et par l’étendue de sa doctrine, unies à la singulière intégrité de ses mœurs, et en France et dans les pays voisins. J’en appelle au témoignage des Allemands, les plus sincères des hommes, qui avaient coutume de rechercher à l’envi ses opinions et ses avis, [9] et non seulement de l’appeler leur ami commun, mais aussi leur parent. Il avait épousé Jeanne Janson, [10] à l’amour de qui je dois le lait que j’ai bu pendant 20 mois et [Page 79 | LAT | IMG] la vigilante édification de ma petite enfance. [11] Aux femmes qui l’engageaient à me trouver une nourrice, moyennant salaire, comme on aime fréquemment à le faire, elle objectait inlassablement que les mères plus désireuses de faire des enfants que les allaiter ou les élever étaient coupables d’intolérable lâcheté, et qu’elles corrompaient souvent ainsi leur descendance chérie en la nourrissant de l’indigne lait tiré d’un autre sein. [12] En outre, je dois à cette excellente et très pieuse mère ma parenté avec les plus nobles familles, qui n’auront jusqu’ici pas eu à douter que je les reconnais et salue comme liées à mon sang. [7][13]Un fait survenu au tout début de mon existence mérite d’être rapporté, car ceux qui professent l’art divinatoire prétendent en général qu’il s’agit d’un heureux signe et d’un bon augure : [14] quand je suis venu au monde, la membrane me couvrait la tête à la manière d’une coiffe, comme si la Nature m’avait jeté cette enveloppe sur les paupières pour retarder le moment où je verrais les misères de la vie humaine, ou plutôt pour m’armer contre les épreuves qui m’attendaient. Pour dire ce que j’en pense, je crois qu’il s’agit d’un dédoublement de la dernière des membranes qui enveloppent le fœtus, qu’on appelle l’amnios, [15] simple fantaisie de la Nature, sans autre signification prophétique. [8]
Étant ainsi né le 23 février 1633 à Paris, capitale de la France, je me suis attaché à étudier avant même de savoir ce qu’étaient les études. En femme d’esprit vigoureux, ma mère m’avait enseigné la lecture à trois ans, et l’écriture à quatre ans. Mon père, dans la mesure où il en avait le temps, la seule chose dont il fût très avare, m’a appris à comprendre le latin familier et à le parler, si bien qu’avant d’avoir six ans, comme par aisance naturelle, [Page 80 | LAT | IMG] j’étais capable de converser en latin avec les gens instruits, et en français avec le commun de mon entourage.
Mon père étant débordé par l’exercice de son métier, M. Gontier [16] l’a soulagé de son amicale et diligente sollicitude. Il est encore aujourd’hui le principal médecin de Roanne, [17] sa ville natale, qui est une cité assez connue sur les rives de la Loire. [18] Je reconnais avec gratitude devoir à cet homme non seulement les rudiments de ce qu’on appelle [9] les humanités, mais aussi tout ce qu’il était possible de m’inculquer en cet âge tendre, et particulièrement les éléments d’histoire grecque et latine.
La bibliothèque de mon père, [19] jadis extrêmement riche, par l’abondance de ses ouvrages, mais aussi par leur rareté et leur choix, que n’a surpassée aucune de celles qu’on a jamais vues chez un particulier, m’a certes procuré des livres à foison, mais elle semblait insuffisante à satisfaire l’ardent désir de lire qui me consumait. Sur sa double foi en mon habileté et en mes dispositions naturelles, mon père m’a décrété non pas héritier, mais patron de tous les livres que je saurais comprendre sans le secours d’une traduction. Ces mots de mon précepteur augmentant ainsi ma bonne fortune, que je ne puis comparer à celle d’aucun roi, je mis alors tous mes soins à apprendre le grec, et il m’a vu si bien y parvenir et dépasser de si haut le vœu qu’il formulaitt, que Plutarque, [20] Dion, [21] Diodore de Sicile, [22] Denys d’Halicarnasse, [23] Xénophon, [24] ainsi qu’Homère, [25] le père des poètes, et certains autres écrivains d’éminent renom me sont devenus familiers. Ce faisant, je n’ai négligé ni les Italiens ni les Espagnols, brûlant du désir très assidu d’accéder à leurs élégances et à leurs Grâces, [26] soit pour me cultiver l’esprit, soit pour me reposer d’études plus austères. [10]
À onze ans, pour ne pas perdre de temps à aller et venir, je fus mis en pension au Collège de Presles-Beauvais [27] [Page 81 | LAT | IMG] recommandé aux bons soins et à l’amitié de Cl. Albertus, homme d’une singulière érudition qui, dans sa charge ordinaire d’enseigner la rhétorique, exposait le matin les faits remarquables de la guerre de Troie, et l’après-midi, les lois des Douze Tables. [11][28] Ses démonstrations n’étaient à mon avis pas moins agréables à écouter que dignes de l’être. J’avoue que ces leçons me captivaient l’esprit, mais mes condisciples les jugeaient soit inutiles, soit trop ardues. Comme les régents avaient remarqué que j’étais plus attentif à ce qu’ils enseignaient, ils me destinèrent à d’autres apprentissages, capables de contenir opportunément les élans d’un esprit adolescent. C’est ainsi que je fus initié aux rites de la philosophie. Je consacrai deux ans aux disputations et aux argumentations, en ajoutant même mes soirées aux journées qui me paraissaient trop courtes.
Mes études progressaient ainsi heureusement, quand survint un accident qui me troubla fortement l’esprit : avant de faire imprimer mes conclusions gréco-latines (qui, à la mode parisienne, étaient fort longues car elles contenaient la philosophie tout entière), je les soumis à la censure de mon professeur, Roger O’Moloy, [29] philosophe irlandais non dénué de quelque célébrité, mais il refusa de les examiner, disant qu’il ne pouvait les approuver en aucune façon et que je m’étais attaqué à un monstre hors de ma portée. À mon souvenir, jamais flot de larmes ne pourra surpasser celui que je versai alors, pensant que c’en était fait de moi (je me repens encore aujourd’hui de ma pusillanimité). Le savoir-faire de mon père put seul trouver un accommodement : il invita à dîner mon directeur d’études, le R.P. Cyrillus Rhodocanacis, originaire de l’île de Chio [30] (qui a depuis été, dit-on, nommé patriarche en Orient), et ils convinrent que, si la force d’âme ne me faisait pas défaut, je devais m’acquitter de mon devoir, même sans protection [Page 82 | LAT | IMG] et en dépit de toute la difficulté qui s’y rencontrerait, pour la bonne raison que ce professeur n’entendait rien à la langue grecque. Je me serais certainement engagé dans un si rude combat, tant le désespoir m’avait rendu téméraire, si une plus sage réflexion n’avait déterminé mon régent à préserver sa bonne réputation. Si bien que le 4 juillet 1647, ayant atteint l’âge exigé de 14 ans, en présence du nonce apostolique, de 34 évêques, d’éminents personnages de la cour, du Parlement et de la Ville, après une dispute de cinq heures dans les deux langues, je fus heureusement honoré du titre de lauréat en philosophie, que les Parisiens intitulent plus modestement magisterium artium. [12]
[Études en droit puis en médecine, 1647-1655]
Après avoir sacrifié quelques semaines aux délices de la chasse, auxquels il n’est pourtant pas rare que les meilleurs esprits se distraient, je m’en évadai pour retourner aux études, à quoi me portait une ardeur innée, pour ne pas dire une véritable furie. De retour à Paris, je fus accaparé par la réflexion sur le métier que je choisirais. J’avais en vue la médecine, sœur de la très chérie philosophie, art de la vie et gardienne du salut. Mon père m’avait inspiré pour elle un amour peu commun. Un certain mien oncle maternel s’y opposait pourtant ; il était lui-même juriste et comme il se voyait sans enfants, il avait promis de me déclarer héritier de ses biens et de m’adopter pour fils, tout en pourvoyant à la dépense pour que je devinsse un avocat de quelque mérite ; c’était assurément ce qu’on appelle aureos montes polliceri. [13][31] Il nous sembla, à mon père et à moi, que nous étions dans l’impossibilité de refuser l’offre de cet oncle qui jouissait d’une grande autorité sur notre maison. Je m’attaquai donc au droit, autant de gré que de force, de sorte que celui qui y avait dirigé ma formation, le célèbre [Page 83 | LAT | IMG] lecteur de droit Mongin, [32] décida après 16 mois que le moment était venu pour moi d’accéder au doctorat dans les deux droits. Ce qui fut dit fut fait, par les préalables poitevins, nom qu’ils donnent aux licences ; [33] et je prêtai serment devant le Parlement de Paris, présenté par le très éloquent M. Bataille, [34] dont j’étais naturellement l’obligé, pour attribuer à chacun la juste part qui lui revient. En tout, j’ai consacré six ans à ces études, à savoir au droit romain, qui comprend les Institutes, le Digeste, le Codex [35] et les autres lois, à quoi j’ai ajouté notre droit français. [14][36] Tandis que je m’y exerçais, je passais pourtant la plus grande partie de mes soirées, comme en cachette, à m’initier aux plus plaisantes études de la médecine.Je ne veux pas taire ici la sagesse de mon père qui, ayant sondé la vérité des choses, m’a avisé d’être plus attentif à mes intérêts et de tirer mauvais présage du silence de mon oncle. Soyez avocat, disait-il, soyez juge, jamais vous ne pourrez accéder aux plus hautes magistratures, car elles sont réservées aux puissants les plus opulents. Vous pâtiriez de vous nourrir du lait que vous promet un oncle avare et chiche. Désirez-vous être continuellement asservi à la réputation ou à l’ignorance d’un autre, voire même à sa fourberie ? Si vous abandonniez au contraire les disputes du barreau et vous tourniez vers la médecine, pour pénétrer les merveilles de la nature, auxquelles vous avez déjà prêté quelque attention, en hésitant à vous y consacrer, vous pourriez un jour être utile à vous-même, aux vôtres, à la patrie et peut-être aussi au monde entier. Vous apprendriez et enseigneriez l’art qui ne prescrit pas seulement ses lois aux magistrats, mais aussi aux rois et aux empereurs. Enfin, vous verriez tous les plus sages boire vos paroles et se soumettre à votre arbitrage. Souvenez-vous, mon cher stoïque [37] (ainsi avait-il coutume de m’appeler, [Page 84 | LAT | IMG] en raison de ma prétendue impassibilité) de notre Marescot, [38] qui proclamait devoir trois choses à notre art sacré, dont il n’eût pas joui s’il s’était résolu au sacerdoce qu’ambitionnaient pour lui ses parents : une santé d’athlète en sa 82e année d’âge, cent mille écus d’or, et l’intime amitié d’innombrables personnages illustres. [15] Il y ajoutait la facilité que j’y trouverais en m’entretenant ou en étudiant avec lui à la maison. Ayant sur-le-champ promis de tout faire à son idée, je rangeai les ouvrages disparates de mon petit cabinet de façon que nul, hormis mon père, ne sût que j’avais substitué Hippocrate [39] à Justinien, et les médecins aux juristes. Riolan, [40] Pardoux, [41] Valleriola, [42] Fernel, [43] Paré, [44] Hofmann, [45] Renou, [46] Houllier, [47] Duret [48] et d’autres, qui m’étaient en quelque façon déjà familiers, m’ont enseigné l’apprentissage du métier que j’avais adopté, où mon père éclairait ma route. Au moment où j’ai été propulsé au grand large, et sur le conseil de mon père et de mon propre chef, j’ai choisi Galien [49] pour capitaine de mon petit navire et pour guide de mes études, car j’avais compris qu’il est le véritable génie de la Nature. J’y ai joint Dioscoride, [50] Celse, [51] Avicenne [52] et d’autres princes de la médecine, dont la diversité me délassait l’esprit quand j’étais fatigué. [16]
[Médecin à Paris, 1655-1667]
Me voilà enfin docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, après avoir été paré de la dignité de bachelier, à la suite d’un examen de 4 jours, d’une singulière minutie, [53] suivi des coutumières deux années et demie d’études, au prix d’innombrables examens de théorie et de pratique, tant publics que privés, et d’une somme de deux mille livres tournois. [17][54][55]Vers ce temps-là, mon père saisit l’occasion d’un des entretiens secrets qu’il avait avec moi dans son cabinet, tard dans la soirée, tandis que la famille dormait, pour m’embrasser avec fougue, [Page 85 | LAT | IMG] me témoigner sa joie, allant jusqu’aux larmes, me remercier d’avoir si diligemment conduit mes études et me promettre tous les biens qu’il posséderait à sa mort. J’ai toujours méprisé la fortune, disait-il, à lui seul, l’amour que je vous porte surpasse déjà mes désirs : outre mes maisons de Paris [56] et des champs, [57] et ma bibliothèque, jouissez comme vôtre de mon argent. [18] Je répondis à cela que je ne lui avais encore rien prouvé, tout en le remerciant beaucoup la générosité de son affection paternelle, que je ne m’étais pas acquitté de ce que je lui devais, mais que je ne manquerais jamais de constance à me souvenir de mes obligations à son égard. Il voulut alors que je me loge dans une maison séparée de la sienne et la meubla très généreusement, incluant une bibliothèque, remarquable pour son excellent choix d’ouvrages, touchant principalement à la médecine et à littérature la plus élégante ; j’y ajoutai toute sorte d’ossements et des instruments chirurgicaux, un bahut rempli de médicaments venus d’Europe et des pays lointains, des cartes de géographie, des tables chronologiques, des portraits de gens célèbres et des médailles, à tel point que n’y manquait presque rien de ce qu’on peut imaginer pour instruire, distraire ou enflammer l’esprit. [58]
Il s’émerveillait, et moi plus encore que lui, de la multitude de gens qui recouraient à mes services, où j’avais très rapidement progressé du menu peuple à la haute société. La multitude des pratiques plus urbaines me poussa à dire adieu aux couvents de moniales qui m’employaient comme médecin. N’en ayant retenu que l’hôpital dit des Incurables, [59] qu’on célèbre parmi les mieux fournis du monde pour la très grande rareté des maladies qu’on y soigne, et qui me dotait d’obligations et d’un renom fort estimables. [60]
[Page 86 | LAT | IMG] Je soignais seul les maladies les plus bénignes et les plus banales ; mais pour les cas graves, je ne prescrivais rien sans avoir pris l’avis de mon père. Je garde plus de mille billets emplis de ses conseils, qui levaient mes doutes et que j’appliquais avec plus d’assurance qu’oracles émanant du trépied de Delphes. [61] J’ai plaisir à en rapporter ici un cas qui, à mon avis du moins, peut être utile ailleurs. J’avais prodigué mes soins à un jardinier de la cinquantaine que sa bile [62] baignée de suc mélancolique [63] avait rendu intelligent, studieux et même poète. Saisi par une fièvre tierce, [64] il en guérit heureusement après quatre ou cinq paroxysmes, à l’issue desquels il restait affligé d’une insomnie rebelle. Comme nous étions en octobre, je redoutais qu’au cours du prochain hiver, la tierce fût suivie d’une quarte. [65] Selon mon habitude, j’écrivis tout cela à mon père. J’ajoutai que j’avais en vain recouru aux somnifères, que le patient était extrêmement impatient, qu’il conservait tant soit peu de force, ne ressentait plus ni fièvre ni douleur, n’admettait de remède que pour mieux dormir, avantage dont sa coutumière anathymiasis [66] le privait ; mais qu’il y avait péril en la demeure et que je pensais donc devoir recourir à des substances plus énergiques en prescrivant, s’il y consentait, un petit grain d’opium, [67] sans penser à ce qui se vend sous le nom de diacode [68] ou de laudanum. [69] À quoi, il me répondit : Ô mon cher fils, comme vous défendez bien l’opium ! Comme vous me semblez vous en faire l’avocat ! Comme vous n’avez rien omis de ce qui s’opposerait à son emploi ! Donnez-en donc si ça vous chante, mais souvenez-vous qu’on décrit éloquemment l’opium en le comparant à un serpent : il cherche d’abord à flatter, mais ensuite, il mord et tue. Je mis ce billet sous les yeux du patient, et il lui inspira la frayeur de toute tentative périlleuse ; je lui conseillai de remettre la décision à plus tard, en lui disant n’avoir pas été formé dans une école où on achète quelques heures de repos [Page 87 | LAT | IMG] au hasard de la vie. Il approuva et tint mon sage conseil pour précieux. De fait, il dormit plusieurs heures la nuit suivante, soit par l’effroi du remède empoisonné, soit pour avoir digéré ce qui lui restait de matière morbifique. [19]
J’ai plaisir à transcrire ici certains préceptes particuliers que mon excellent père m’a inculqués vers cette époque, afin qu’ils témoignent de son immense amour pour moi et renforcent la réputation de sagesse et d’éminente intelligence de l’art qui ont fait sa valeur. [70] Je vous ai recommandé, disait-il, le divin Hippocrate et Galien afin que vous ne doutiez en rien qu’il faille les préférer aux autres auteurs qui ont écrit sur notre art. Je n’ai pas à cœur de vous répéter ce que le premier, dans son Serment, [71] et le second, dans son Exhortation aux bonnes pratiques des arts, [72] et bien ailleurs, ont enseigné aux jeunes médecins sur ce qui touche à la philosophie des mœurs. Je veux vous aviser de quelques autres conseils. Sachez que vous n’aurez pas affaire à moins de fous que de sages : cette condition est commune à tous les mortels et particulièrement aux médecins. Vous peinerez à rencontrer un malade qui soit totalement sain d’esprit : l’un ne veut pas être guéri, l’autre vous veut du mal ; presque tous mettent en doute la supériorité du médecin, sans pourtant vous égaler en savoir. Ils sont fréquemment trompés, mais désirent plus fréquemment encore être trompés. Beaucoup s’inventent des merveilles dans la constitution de leur corps, dans leurs idiosyncrasies, [73] dans le genre de leur maladie, et aussi dans le choix de leurs remèdes. Vous les contredirez si vous exercez votre métier avec probité, science et jugement. Pour parvenir plus heureusement à cela, après avoir méprisé tant de vaines questions, qui visent toutes à la pure recherche d’intérêts, ne vous consacrez qu’à celles qui pourront mettre au jour les maladies par n’importe quel moyen : quand vous aurez ainsi acquis le pouvoir de présager, qu’on appelle le pronostic, vous ne serez pas très éloigné du talent de guérir. Je loue la botanique, qui est la plus instructive partie de l’histoire naturelle, mais je ne voudrais pas que vous la cultiviez outre mesure : [Page 88 | LAT | IMG] faites-en ut e Nilo, canis. [20][74] Gardez-vous de toute curiosité et ne vous intéressez qu’à ce qui vous est utile. Je ne conteste pas que l’anatomie soit l’œil de la médecine et qu’elle n’y ait pas moins de valeur que n’a eu le fil d’Ariane [75] pour Thésée, [21][76] mais je ne voudrais pas que vous vous impliquiez trop dans des controverses dont je me contente d’entendre parler : n’existe-t-il pas des ovaires chez les femmes ? [77] les surrénales [78] ne recueillent-elles pas l’atrabile [79] pour la mélanger à la masse du sang ? le cervelet [80] ne dirige-t-il pas les mouvements incessants, et le cerveau, les mouvements volontaires ? les glandes conglobées et conglomérées n’ont-elles pas des fonctions différentes ? [22][81] Cela certes est beau, mais demande qu’un homme s’y consacre tout entier, en l’éloignant peu à peu de la véritable étude de la pratique. Qu’on loue la chimie autant qu’elle le mérite, [82] mais prenez garde à ne pas la préférer à la sage méthode : ayez en tête le grand nombre de gens qu’elle a tués, et le peu qu’elle a sauvés ! Je n’ajouterai qu’une chose : ne vous opposez pas seulement aux empiriques [83] et aux petites bonnes femmes, mais aussi aux sages personnages qui désirent juger et même décider en un métier qu’ils ne comprennent pas. C’est ainsi que vous serez continuellement utile et jamais ne nuirez. [23]
Je m’absorbai alors dans mes occupations médicales, quand la dive Fortune me sourit de nouveau : comme le docteur Lopès [84] avait été appelé à se rendre à Bordeaux de manière impromptue, il abandonna sa charge de professeur de pathologie, [85] qui est la plus importante de l’École. [24] La très salubre Faculté fut aussitôt convoquée pour attribuer cette chaire à l’un de ses docteurs. Selon la coutume, elle désigna cinq électeurs parmi les présents, qui s’entendirent pour proposer trois noms. [86] Les trois billets furent mélangés dans l’urne et la main du doyen en tira un qui fut celui de Charles Patin. [25][87] La condition avait été préalablement posée que celui qui serait proclamé aurait dispense du discours inaugural habituel, de manière à enseigner sans délai, étant donné le peu de temps dont on disposait. C’est ainsi qu’à un âge auquel personne n’avait encore professé à [Page 89 | LAT | IMG] Paris, je devins titulaire de cette chaire. Je dirigeai la première anatomie [88] publique de cette année-là dans l’amphithéâtre des Écoles sur le cadavre d’une femme qui avait eu la bonne fortune de m’échoir ; le dissecteur fut Paul Emmerez, [89] chirurgien fort expérimenté. Il ne m’appartient pas de représenter avec quel succès j’ai rempli les devoirs de ma charge : cinquante étudiants en médecine, [26] qui, je pense, sont maintenant tous docteurs, témoigneront de ce que j’ai accompli ; tout autant que les apprentis chirurgiens qui désiraient apprendre de moi les préceptes de l’art. En vertu d’un décret que la très salubre Faculté avait voté, je leur ai enseigné, pendant les quelques années qui ont suivi, la manière de connaître l’histoire des tumeurs, de traiter les plaies, les ulcères, les luxations et les fractures, et d’exécuter les grandes opérations de chirurgie sur des cadavres. Comme aussi je commentais les dissections en français, un grand concours de courtisans et de dames me fit l’honneur de venir y assister chez moi. La rumeur enflait disant que j’expliquais chacune des fonctions du corps et de chacune de ses parties en prenant soin de ne rien dire qui pût offenser de chastes oreilles. [27]
Je pense ne pas m’écarter du sujet en insérant ici une observation médicale qui confirme la vigilance, la sagacité et la sagesse de la nature. J’étais depuis dix ans le médecin d’un très honnête marchand nommé Jean Le Blond, [28][90] octogénaire en proie aux symptômes de la pierre, [91] mais autrement en bonne santé. Bien qu’affligé de douleurs continues, jamais leur incommodité ne le conduisit à garder le lit ou à délaisser sa boutique. Cela l’obligeait cent fois par jour à quérir son pot de chambre pour y déverser à toute occasion un peu d’urine, s’il n’y substituait pas une éponge placée aux endroits adéquats. [92] [Page 90 | LAT | IMG] Quand il fut à bout de forces, je le persuadai de s’aliter et l’engageai cordialement à bientôt dire adieu aux douleurs, à la maladie, à la vieillesse et à la vie. Cet homme, qui n’était pas dénué de tout amour de la sagesse, bien qu’il fût étranger aux muses, entendit allègrement ce que je lui disais, m’affirmant trouver merveilleux de ne confier qu’au sort le soin de l’emporter, à la différence de tant d’autres qui meurent ensevelis sous les médicaments, et se réjouissant d’être tombé sur un médecin qui lui permettait de mourir paisiblement. [93] Ainsi trouva-t-il une mort dénuée de toute douleur, après avoir établi un testament dont il me faisait l’exécuteur, en m’y désignant comme son plus grand ami. Suivant la coutume de nos concitoyens, on procéda à l’ouverture de son cadavre, [94] où l’on découvrit que tous les organes avaient une constitution intacte et saine, à l’exception de la vessie et d’un uretère : son volume égalait et même dépassait celui des intestins car, depuis le rein gauche jusqu’à la vessie, il était distendu par une énorme quantité de sérum, [95] dont les enfants des médecins apprennent qu’il ne mérite pas le nom d’urine. La vessie était entièrement remplie par un calcul arrondi et oblong, lisse et poli, pesant 14 onces. [29] Qu’elle ait pu atteindre une telle dimension sans risque de rompre s’expliquait par le fait que, dans sa partie antérieure, la nature, en habile architecte, avait ouvert un canal qui surpassait toute l’habileté des chirurgiens : n’importe qui constatait aisément que l’urine avait pris l’habitude de s’y écouler goutte à goutte parce que la vessie était incapable d’en recevoir plus de quelques-unes, et que, sur ordre de la nature, l’uretère s’acquittait de la fonction normalement impartie à la vessie, en devenant le réceptacle du sérum ou de l’urine et en se dilatant jusqu’à atteindre un volume quatre fois supérieur à la normale ; de là provenaient les douleurs, qui étaient permanentes sans toutefois être très violentes.
[Exil et errances en Europe, 1667-1676]
L’extrême faveur des grands adoucissait les vicissitudes de ma pratique, car ils me jugeaient digne de leur servir à la fois de médecin et d’intime ami. [Page 91 | LAT | IMG] Survint pourtant alors le malheur, ou plus exactement le mensonge, et je dirai même la calomnie, qui m’a terrassé et jeté dans une iliade de maux. Laisse-moi, bienveillant lecteur, imiter Timanthe [96] qui, peignant les témoins consternés de la scène et mettant tout son art à figurer la tristesse, a voilé la face du père, [97] qui se tenait sur le chemin d’Iphigénie [98] quand elle s’en allait périr sur l’autel, tant il désespérait d’en rendre assez le chagrin. [30][99] Jetons ici un voile sur notre consternation, qu’il traduise notre chagrin devant les sorts malheureux ou notre charité envers la fourberie des jaloux.Je jugeai plus sage de quitter ma patrie que de risquer ma liberté. J’ai alors puissamment ressenti la valeur de cette stoïque indifférence qu’on m’avait si souvent reprochée ; elle a préservé mon esprit de la destruction ou de la ruine sans permettre que je verse la moindre larme. J’avais dessein de gagner les Provinces-Unies, [100] refuge ordinaire des gens de lettres, à quoi une multitude d’amis hollandais semblait m’inviter. Sur cet avis, je me rendis à Rouen, [101] Dieppe [102] et enfin, au Havre-de-Grâce. [103] Voulant embarquer sur un navire en partance pour Rotterdam, [104] on m’apprit que des corsaires d’Ostende [105][106] dévastaient les parages avec grande violence sans épargner personne, cherchant par tous moyens à tirer butin de toute proie et à jeter dans la mer les Français contre lesquels ils étaient particulièrement mal disposés. Cela terrifia si fort le valet de peintre avec qui je voyageais, qu’il refusa d’embarquer ; ce qui fit que, balançant entre sa pusillanimité et ma détermination, je décidai, puisque ce voyage n’était pas de telle importance, de retourner à Paris.
Delà, je résolus d’aller à Heidelberg, [107] où le sérénissime électeur [108] m’avait quelquefois très généreusement invité dans ses lettres. [Page 92 | LAT | IMG] Son vœu fut exaucé ; le prince m’accueillit avec la plus grande amabilité et mit tout en œuvre pour me consoler, ce qui ne surprendra pas celui qui connaît la gentillesse des Allemands. Alors, comme je coulais des jours tranquilles, et apprenais leur langue et leurs mœurs, je décidai enfin et de me moquer des vaines délibérations des hommes, et de me consacrer tout entier à la philosophie et à la médecine. Ceux qui en sont réduits à cet état ont certes souvent coutume d’embrasser la vie monastique, mais pourquoi le faire quand j’étais marié et entouré d’avis qui s’y opposaient ? En somme, je confesse de bon cœur n’y avoir pas même songé.La démangeaison du voyage s’empara de moi, en vue de connaître plus intimement les cours des princes et les secrets bien cachés des médecins, et je ne disconviens pas qu’à cause de cela je recherchais assidûment leur affection. Cela a si heureusement réussi que je me suis attiré non seulement la bienveillance, mais encore l’intime amitié de plusieurs d’entre eux. Je dois une part de ma consolation et de l’accomplissement de mes vœux à la générosité de quelques personnages, et souhaite qu’ils souffrent ici d’être nommés, en souvenir de ma profonde reconnaissance et de la joie qu’ils m’ont procurée. Pour ses immenses largesses et les immenses honneurs qu’il m’a conférés, l’auguste empereur Léopold [109] a légitimement coutume de s’y revendiquer la première place. Les électeurs de Bavière, [110] de Saxe, [111] de Brandebourg [112] et le Palatin ont bien voulu parfois se départir de leur majesté pour me faire très familièrement participer à leurs conversations, en discutant régulièrement avec moi de philosophie pendant leurs repas et leurs chasses. Les trois frères Eberhard, [113] Friedrich [114] et Ulrich, [115] ducs de Wurtemberg, les meilleurs des hommes, m’ont conféré tant d’honneurs que leur souvenir ranime tout le respect [Page 93 | LAT | IMG] que je leur dois. [31] Les princes de Bade, et principalement Frédéric, chef de la lignée de Durlach, et son fils Frédéric Magnus, [116] n’ont jamais cessé de m’honorer de leurs immenses faveurs et de leur intime affection. Seul celui qui saura à quel point Ferdinand Maximilien de Bade [117] m’a entouré de son amitié comprendra quelle perte j’ai éprouvée à sa mort. Partant pour Vienne, je lui avais dit adieu tandis qu’il se préparait à partir chasser. Le lendemain, les violentes secousses du carrosse firent éclater son fusil, dont les balles le blessèrent au bras, sans toucher du tout le fils du sérénissime électeur palatin [118] et les autres princes qui se tenaient à ses côtés. Ce malheureux prince demanda instamment qu’on lui coupât le bras, mais il n’y avait aucun chirurgien dans les parages pour le faire à temps ; une gangrène se développa et l’emporta rapidement dans l’au-delà. [32] Je me souviendrai aussi de l’archevêque de Salzbourg qui, quand il reçut aimablement mes déférentes salutations, déclara publiquement que j’étais Charles Patin, etc., et qu’il me connaissait fort bien ; puis il ordonna incontinent que mon portrait fût sorti de sa bibliothèque pour me le faire voir. [33][119] Du sérénissime roi de Grande-Bretagne, je proclamerai que tous les trésors qu’il tient profondément cachés donnent la preuve flagrante de son pouvoir. [120] Il se rappelait avec plaisir que, quand il vivait à Paris, [121] il avait appris de moi, encore tout jeune homme, certaines choses sur les éclipses [122] et les comètes, [123] et que je lui avais fourni les réponses à diverses questions qu’il se posait à leur sujet. Je reconnais devoir beaucoup à la reine Christine, [124] aux cardinaux Francesco Barberini [125] et Camillo Massimi, [126] au grand-duc de Toscane [127] et à son oncle le cardinal Léopold de Médicis, [128] ainsi qu’au prince Francesco, [129] dont j’apprends [Page 94 | LAT | IMG] qu’il accédera bientôt à la pourpre cardinalice, en juste récompense de ses mérites. [34] Le sérénissime duc Alphonse de Modène, [130] etc., m’a aimablement autorisé à examiner les pièces opulentes et savantes, sceaux, orfèvrerie et médailles, qui lui restaient des princes arétins, [131] de les copier dans mes cahiers et de les communiquer à la république des lettres. Tant qu’il m’est possible, j’ai soin d’honorer les princes de Savoie [132] et le duc de Parme, etc., [133] en reconnaissance des bienfaits que j’ai reçus d’eux. [35]
J’en viens maintenant aux médecins, dont j’avais à cœur de découvrir les mœurs, la doctrine et la pratique. Je désirais particulièrement savoir à quelles méthodes ils recouraient pour conserver et restaurer la santé des malheureux mortels, car je les savais s’écarter tant de celles de Paris que je désirais ardemment savoir comment ils pouvaient s’acquitter correctement de leur devoir. Je n’y ai rencontré aucune difficulté ni aspérité, car j’ai partout été accueilli avec cette très douce amitié et cette très grande politesse que l’on se doit de respecter très exactement entre gens instruits. J’ai exercé la médecine aux côtés de Fausius, [134] archiatre d’Heidelberg, sans rien y voir qui contredise la nôtre. Je vénère l’érudition et le renom du très célèbre < Johann > Caspar Bauhin, [135] qui s’est lié d’une très étroite amitié tant avec mon père qu’avec moi. Quand j’étais à Bâle, [136] il m’a permis de puiser à profusion dans les réserves de son savoir, tout comme a fait le très éminent Bernhard Verzascha, [137] qui brille par son heureuse méthode pour remédier. Je ne dois pas omettre Jakob Harder, [138] bien qu’il fût tout jeune alors : il enseigne aujourd’hui dans cette même ville et s’est acquis un renom peu commun par son art et ses écrits médicaux. J’estime tout particulièrement Johann Georg Volckamer, [139] citoyen et très noble médecin de Nuremberg, parce que [Page 95 | LAT | IMG] j’aurais été mieux avisé de ne jamais quitter sa compagnie, et qu’il a été un des fidèles correspondants de mon père, au rang desquels je compte aussi Hermann Conring, [140] qu’on surnomme familièrement le Phénix de l’Allemagne. La brillante réputation des Bartholin est connue de quiconque aime la médecine, et qu’il me soit permis de tirer une véritable gloire de ce que le père [141] et le fils [142] m’ont souvent serré dans leurs bras. [36] Lucas Schröck [143] d’Augsbourg est digne de toute considération, il couve avec talent le souvenir de son compatriote Georg Welsch, [144] que j’ai compté parmi mes plus grands amis. Je me félicite fort d’avoir aussi compté parmi eux Melchior Sebizius [145] et Johannes Kupperus, [146] médecins de Strasbourg, qui eurent jadis grande réputation : le premier, presque centenaire, m’a jugé digne de converser avec lui en latin, en grec, en français, en italien et en allemand ; le second était archiatre de presque tous les princes du voisinage. [37] Johann Albrecht Sebizius [147] reflète brillamment l’éclat du renom paternel, et j’ai vu ses collègues Marc Mappus [148] et Georg Franck [149] exercer la médecine suivant les règles bien pesées de l’art. < Johann Daniel > Horst [150] et Sebastian Scheffer, [151] à Francfort, et Johann Peter < sic pour : Matthias > Faber, [152] à Heilbronn, [153] se sont acquis le prestige d’Esculape [154] par leur habileté dans l’art de remédier, et me sont tous chers à de nombreux titres. [38][155] J’ai appris la mort de Werner Rolfinck, [156] très célèbre professeur de l’Université d’Iéna : il connaissait la médecine sur le bout des ongles, dévoilant très libéralement ses règles les plus secrètes, que j’aurais pourtant voulues moins imprégnées de pratique chimique ; puisse son souvenir ne jamais me sortir de la mémoire. L’archiatre [Page 96 | LAT | IMG] Paulus de Sorbait [157] brille d’un immense éclat non seulement à Vienne, mais dans le monde entier : lui doit-on une parfaite méthode pour remédier, ainsi que des écrits parfaitement élaborés ? Je réponds oui à ces deux questions. Hoffmann [158] à Altdorf, Ammann à Leipzig, [159] Sigalinus à Côme, [160] Seb. Jovius à Lugano, [161] Pierre D’Apples à Lausanne [162] méritent l’affection de tous les médecins pour leurs éminents talents à soigner. [39]
La mort a déjà emporté Nicolaas Tulpius, [163] Johannes Antonides Vander Linden, [164] Theodor Kerckring, [165] Reinier de Graaf [166] et Silvius de Le Boë [167] qui furent jadis mes amis et que leurs écrits et le nombre de médecins qu’ils ont formés ont rendus très célèbres. À leur suite, je me souviens des grands Belges : Swammerdam, [168] qu’on a souvent surnommé l’Hippocrate de son siècle, et Drelincourt [169] ont atteint un haut niveau d’estime en Flandre pour leur talent à remédier. [40] J’évoque avec très douce pensée le souvenir du très savant Thomas Puellez [170] (dont le nom sonne comme celui de pucelle, donzella, c’est-à-dire de vierge), archiatre de la très-chrétienne reine Marie-Thérèse : [171] le roi très-catholique d’Espagne [172] l’avait tiré de sa chaire de Salamanque [173] pour accompagner cette princesse de Madrid à Paris ; il m’a dit avoir beaucoup progressé dans la connaissance de l’art au contact de médecins venus de tous les pays, mais ne respecter que ceux de Paris, auxquels il se fiait entièrement en toutes choses, tant pour leur très pure méthode thérapeutique que pour la sainteté de leurs mœurs.
Thomas Willis, [174] célèbre pour sa profonde érudition et ses démonstrations originales sur le cerveau, est mort à Londres. Pour mon malheur, quand j’y étais, je manquai l’occasion [Page 97 | LAT | IMG] de rencontrer Walter Charlton, [175] personnage de très grand renom, car le temps brumeux m’avait poussé à regagner des régions plus clémentes. [41]
Je ne puis manquer de louer aussi les très célèbres médecins lyonnais que sont < André > Falconet [176] et Charles Spon, [177] qui, de tous, a été l’ami le plus affectueux et le plus cher de mon père. Chacun des deux a eu un très savant fils médecin. [178] Celui du second, Jacob Spon, [179] m’est particulièrement précieux pour le plaisir que me valent ses très exquises recherches et pour l’amitié qui nous a soudés en Allemagne et en Italie. [42]
J’ai aussi parfaitement connu : le chevalier Terzago, [180] dont le renom rayonne sur Milan ; Francesco Redi, [181] le très raffiné médecin du grand-duc de Toscane ; Marcello Malpighi de Bologne, que ses écrits ont rendu célèbre dans le monde entier, [182] et son ami le très habile anatomiste Silvestro Bonfigliuoli ; [183] Florio Bernardi, [184] jadis correspondant de mon père, médecin dont l’art est si aiguisé qu’il préside à la santé de nombreux grands personnages de Venise. En outre, j’ai intimement connu Marcus Brunius, Ant. Scarellius et Jac. Grandius, [185] médecins vénitiens de grande réputation. J’ai aussi eu parfois le privilège de faire des consultations médicales en compagnie d’excellents médecins de Vicence, [186] légitimement reconnus pour leurs mérites : Aloysius de Antoniis, Giorgio Fontana, Girolamo Copelazzi, Giacomo Gonzati, qui ont partagé la réputation de leur méthode thérapeutique avec feu Bernardino Malacreda (que j’ai de même fort bien connu). [43][187]
Bien qu’ils ne fussent pas médecins, la fréquentation de savants m’a en outre profondément réjoui l’esprit, car j’ai tissé avec eux des liens très étroits. Parce qu’ils sont morts plus tôt que les autres, je nomme en premier Johann Heinrich [Page 98 | LAT | IMG] Boeckler, professeur d’histoire à Strasbourg, [188] Johann Peter Lambeck de Hambourg, [189] Johann Peter Lotich de Francfort, [190] < Johannes Andreas > Bosius, professeur d’histoire à Iéna, [191] et Johann Chrsitian Keck, de Durlach ; [192][193] leur vertu et leur gloire rendront leur souvenir immortel. Je brûle encore du désir de nommer Sébastien Fesch, [194] professeur en l’un et l’autre droit à Bâle, mon très grand ami, pour sa connaissance des antiquités et des belles-lettres, ainsi que les très brillants Johann Rudolf Wettstein, très honorés professeurs de théologie, [195] pour le père, et d’éloquence, pour le fils, qui m’ont tous deux gratifié de leur affection. Je ne quitterai pas Bâle, qui fut pour moi un très réconfortant refuge, sans nommer les autres professeurs qui continuent d’y embellir la république des lettres : Jacobus Rüdinus en rhétorique, [196] < Johann Jakob > Hofmann en langue grecque, [197] Johann Jakob Buxtorf en Écriture sainte. [44][198] Zurich [199] est voisine de Bâle et a aussi nourri de très éminents savants qui ont parfois montré de la bienveillance à mon égard : Switzer, Otte, [200] Hottinger [201] y brillent par leur omnisciente érudition. Jul. Richeltus, [202] professeur de mathématiques à l’Université de Strasbourg, est à tenir en très haute considération pour ses élégants écrits, et principalement pour les observations qu’il a menées avec art. J’ai eu pour intimes et utiles amis Johann Christoph Vagenseilius, professeur de droit et de langues orientales à Altdorf, [203] et Ioannes < sic pour : Jacobus > Gronovius, [204] personnage digne de son père, [205] à qui il a succédé dans la chaire d’histoire de Leyde. [206] Johann Jakob Kerscher [207] et Johann Ludwig Prasch, [208] [Page 99 | LAT | IMG] magistrats de Ratisbonne, [209] contribuent fort à la réputation de l’Allemagne par l’étendue de leur omniscience. Tobias Hollanderus, [210] proconsul de la République de Schaffhouse, [211] mérite un plus ample éloge que ce que je puis en écrire ici, tant pour sa fine connaissance des antiquités que pour les services particuliers qu’il m’a si aimablement rendus. Nul ne peut se dire instruit s’il n’a pas connu Antonio Magliabeschi, [212] conseiller bibliothécaire du sérénissime grand-duc de Toscane, tant il met de bienveillance à écouter tout le monde, comme il m’est arrivé de le constater de mes propres yeux toutes les fois que je suis allé le voir à Florence. [45]
À Rome, où j’ai séjourné pendant quelques mois, j’ai eu de très plaisants entretiens avec deux authentiques Romains dont nous admirons les bonnes mœurs et l’érudition : l’abbé Braccesi, [213] franciscain, était secrétaire du pape Urbain viii ; [214] < Giovanni > Pietro Bellori [215] a été le conservateur des antiquités de plusieurs pontifes, avec une remarquable compétence, dont témoignent les explications qu’il a publiées sur les colonnes de Trajan [216] et de Marc-Aurèle. [46][217] J’ai admiré Ezechiel Spanheim, [218] à Paris, puis à Heidelberg et enfin à Cologne, car ce n’est pas un mince éloge que je dois à cet homme de la plus rare érudition. Je me suis intimement lié à lui, ainsi qu’à son frère Johann Friedrich, professeur de théologie à Heidelberg puis à Leyde. [47][219] Passerai-je sous silence Petrus Paulus Bosca, [220] archiprêtre de Monza, [221] qui fut jadis conservateur de la Bibliothèque Ambrosienne ? [222] Sûrement pas ! Je ne l’oublie pas, tant pour son opuscule De Serpente æneo que pour son insigne savoir et pour sa bienveillance à mon égard. [48]
[Page 100 | LAT | IMG] De même que je n’ai cité aucun Parisien car le nombre des précepteurs que j’y vénère est immense, de même je juge inutile de nommer ici ceux de Padoue car, outre les professeurs de cette Université dont je parle dans ce livre, j’en ai connu beaucoup qui se sont rendus illustres par la diversité de leur érudition. Néanmoins, sans du tout me livrer à la basse flatterie, je me dois de mentionner deux médecins qui professent tous deux à Padoue : Io. Fortius [223] et Hier. Vergerius [224] furent des juges très affûtés en l’art de soigner ; le souvenir de leur générosité à mon égard m’ordonne d’honorer profondément leurs mânes, car j’ai appris d’eux quantité de règles sur la sagesse politique, la prévoyance des médecins et le profit des malades. [49]
Si j’ai pu dépeindre comme ayant été mes amis tous et chacun de ceux que j’ai ainsi nommés, suivant le propos de Socrate, [225] dis-moi qui tu fréquentes et je devinerai tes mœurs, il n’est pas permis de me juger plus favorablement que je ne le désire, car j’en ai rencontré tant et me suis si souvent entretenu avec eux que je n’ai presque jamais quitté leur compagnie sans avoir accru en quelque façon mon savoir ou ma sagesse. Et cela fut partout pour moi un immense soulagement étant donné que, suivant le propos de Chrysostome, [226] ceux qui sont riches en amis ne sauraient éprouver la tristesse. [50]
[Padoue, 1676-1682]
La guerre déclarée entre les Français et les Allemands [227] m’incita à sérieusement envisager d’autres projets : à peine se passait-il un jour sans que, depuis mon cabinet de Bâle, je visse des contrées incendiées chez l’un ou l’autre des belligérants. La bonté de sa terre, la célébrité de son antiquité, la gloire de ses lettres et la sagesse de son peuple me persuadaient de préférer l’Italie aux autres pays, car elle est le jardin du monde, la fourmilière des bonnes choses. Ma détermination [Page 101 | LAT | IMG] fut accrue par les lettres de son Excellence le chevalier Grimaldi, personnage qui excelle dans les arts de la paix comme de la guerre, et aussi des grands de Venise, que seule une heureuse fortune avait acquis à ma cause, où j’étais sollicité pour briguer une chaire de médecine à l’Université de Padoue. [228] D’autres courriers, au contraire, modéraient mon ardeur en me rappelant la différence des coutumes qu’on y suit. La réflexion qui m’avait d’abord inspiré l’emporta cependant, et je me résolus courageusement à surmonter toutes les adversités imaginables. Je franchis les Alpes pour me rendre à Padoue en compagnie de ma très chère épouse, Madeleine, [229] qui est la fille de Pierre Hommetz, [230] éminent médecin de Paris. [51] Je ne veux pas taire ici l’exceptionnelle magnificence d’un citoyen de Padoue, le comte Giovanni de Lazara : [231] dès mon arrivée, il m’accueillit dans une très vaste maison, dont il signa même le bail, en témoignage d’une générosité telle qu’il me parut impossible de souhaiter plus grande faveur. Parmi les Vénitiens, Battista Nani, [232] procurateur de Saint-Marc, [233] surnommé la lumière de la République, s’est le premier montré mon protecteur, tant qu’il a vécu ; désormais, c’est Silvestro Valier, procurateur de Saint-Marc et président de l’Université, qui remplit cet office à mon égard ; [234] en 1678, avec ses collègues, il m’a attribué la chaire vouée à l’interprétation d’Avicenne, avec un salaire annuel de 300 ducats, [235] ce qui a été immédiatement confirmé par un arrêt du Sénat. [52][236]Trois ans plus tard m’advint un autre honneur, qui fut d’être promu à la dignité de chevalier, [237] que l’excellentissime Sénat me conféra très superbement, et je fus décoré du collier d’or par Alvise Contarini, sérénissime Doge de Venise. [238]
En l’an du Christ 1681, tandis que je me consacrais tout entier tant à enseigner mon art [Page 102 | LAT | IMG] qu’à l’exercer, et que je méditais déjà, l’esprit en paix, sur ma mort future, voilà que, deux fois dans la même semaine, des oiseaux de bon augure m’apportèrent à Padoue une très heureuse nouvelle. Et si elle m’était parvenue une troisième fois, je n’aurais pas laissé de m’exclamer, comme Philippe de Macédoine : [239] « Ô dieux, compensez par un léger malheur le bonheur de tant de succès ! » De Rome, de Paris, de Vienne et de Venise me parvenait la même rumeur disant que le roi très-chrétien, Louis vraiment le Grand, [240] dans son immense clémence, m’avait accordé sa grâce, dont j’avais jadis été exclu, sans savoir hélas par quel mauvais sort ! C’est ce que j’avais tenu pour le plus cher de mes souhaits, car jamais mon esprit, accablé plutôt que brisé, ne s’était résolu à perdre tout espoir ou tout désir de l’obtenir. [53] Dans la même période, la chaire de chirurgie étant devenue vacante, elle me fut attribuée par le triumvir qui dirigeait l’Université, Hier. Basadonna, [241] Io. Maurocenus, [242] et Nic. Venier, dont l’éminentissime Sénat confirma le décret sur-le-champ. [54]
[Calomnie allemande contre Guy Patin]
Je dois, je pense, ajouter à cela une autre nouvelle, bien qu’elle soit de moindre importance : des lettres reçues de la Faculté de médecine d’Iéna [243] m’avisaient d’exiger quelque réparation car j’avais, depuis quelques mois, à me plaindre vivement d’un certain Johann Conrad Axt [244] qui, à un petit livre de Arboribus coniferis imprimé là-bas en 1680, avait ajouté une lettre de Antimonio [245] où j’estimais qu’une très grave insulte avait été proférée contre la bonne réputation de mon père, ce que je n’aurais jamais pu tolérer. Cette très salutaire Faculté a contraint l’auteur à se rétracter et j’ai eu avis qu’on avait chargé les imprimeurs de supprimer la calomnie [Page 103 | LAT | IMG] par ces mots : À l’édition de ce traité de Arboribus, bienveillant lecteur, j’avais adjoint une Epistola de antimonio, où j’avais mis un conte au sujet du très illustre Guy Patin. Ayant découvert que cela était certainement faux, et sans doute ébruité par des gens jaloux de lui, j’ai pris soin de faire réimprimer l’Epistola ; j’en ai ôté la fable et reconnais hautement avoir insulté la mémoire de ce très brillant personnage. [55][246][247][248][249][250][251]
[Stoïque conclusion]
Ami lecteur, voilà ma vie, qui a été un tissu de bonheurs et de malheurs, et tu jugeras toi-même si elle devait être celée ou étalée au grand jour. Je pourrais néanmoins faire état d’innombrables autres faits qui l’ont agitée si j’avais la liberté de coucher sur le papier tout ce qui m’y est arrivé ; mais qu’il est donc ardu d’écrire sur soi-même ! Il est plaisant d’exposer les éminents mérites des autres, non sans en inventer parfois, s’ils n’en ont guère eu : tel n’est pas le sort ingrat de celui qui raconte sa propre vie, puisqu’il ne lui est pas même permis d’imaginer ces dons, pour autant qu’il en ait eu. J’ai relaté quantité de faits et de propos sans craindre d’être accusé de mensonge et, comme chacun le doit, je dédaigne la flatterie. Il y a encore deux choses dont je voudrais m’excuser, qui sont de m’être trop laissé aller, au fil de la plume, soit à la gratitude, soit à de douces réminiscences. Sache enfin que je ne partage pas l’avis de Brutus, [252] qui pensait que la vertu est la servante de la fortune, puisque je crois, comme Épictère, [253] que la fortune, étant donné sa frivolité naturelle, est une putain qui n’offre jamais gratuitement ses faveurs à personne : en vérité, la vertu est la seule maîtresse qu’il faille éternellement honorer. [56]J’éduque mes deux filles, Gabrielle-Charlotte et Charlotte-Catherine, [254] qui se sont vouées aux études, principalement pieuses, philosophiques et historiques, et avec lesquelles [Page 104 | LAT | IMG] j’ai coutume de converser très agréablement, comme si les très gracieux attraits de leur esprit dissipaient les affligeantes aigreurs d’âme qui m’envahissent parfois. [57] Pour elles comme pour moi, Quis scit quid serus vesper vehat : [255][256] Θεοι δε τε παντα δυνανται. [58][257]
[Autobibliographie]
Nous avons précédemment publié :Itinerarium Comitis Briennæ, [258][259] Paris, 1662, in‑8o ;
Familiæ Romanæ ex ant. numismatibus, [260] 1663, < Paris, > in‑fo ;
Traité des tourbes combustibles, [261] Paris, 1663, in‑4o ;
Introduction à l’histoire des médailles, Paris, 1665, Amsterdam, 1667, in‑12 ;
Thesaurus Numismatum, Amsterdam, 1672, in‑4o ;
Quatre relations historiques, Bâle, 1673, Lyon, 1674, in‑12 ;
Pratica delle medaglie, Venise, 1673, in‑12 ;
Suetonius illustratus, [262] Bâle, 1675 ;
De numismate antiquo Augusti et Platonis, [263][264] Bâle, 1675, in‑4o ;
Encomium moriæ Erasmi, cum fig. Holbenianis, [265][266] Bâle, 1676, in‑8o ;
De optima Medicorum secta, Padoue, 1676, in‑4o ;
De Febribus, Padoue, 1677, in‑4o ;
De Avicenna, Padoue, 1678, in‑4o ;
De Numismate ant. Horatij Coclitis, 1678, in‑4o ;
De Scorbuto, [267] Padoue, 1679, in‑4o ;
Iudicium Paridis, [268] Padoue, 1679, in‑4o ;
Le pompose feste di Vicenza, Padoue, 1680, in‑8o ;
Natalitia Iovis, [269] Padoue, 1681, in‑4o ;
Quod optimus Medicus debeat esse chirurgus, Padoue, 1681, in‑4o. [59]Auxquels on peut ajouter :
Lyceum Patavinum, Padoue, 1682. [a]
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Une mazarinade contre Théophraste Renaudot (1649)
Codes couleur
Citer cette annexe
Imprimer cette annexe
Imprimer cette annexe avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8227
(Consulté le 06/05/2024)
Le Voyage de Théophraste Renaudot, Gazetier, à la cour [a][1][2]
Maître fourbe, et plus menteur que ne fut jamais le plus subtil arracheur de dents qui soit dans le domaine du Pont-Neuf, [1][3] où diable allez-vous ? Tout le monde sait que le lendemain des Rois vous vous enfuîtes à Saint-Germain, [4] < dans la > crainte que vous aviez d’être enfermé dans les barricades, ou d’être enseveli dans l’un des tonneaux qui servirent de remparts à la défense des bourgeois de Paris, [2][5] lorsque le roi, quittant son palais, t’avait laissé seul dans les galeries de son Louvre, [6] où tu étais demeuré un moment pour apprendre ce qui se passait dans l’esprit, dans la pensée, dans l’intention des habitants. Ô dieux ! tu manques de nez, si ce n’est que les plus courts soient les plus beaux, ou que les plus puants soient les meilleurs, [7] comme l’on dit des fromages, [8] mais tu en eus cette fois, car les paysans révoltés étaient résolus de te faire mourir dans un tonneau de la plus fine merde qui se trouve dans les marais, ou dans la rue des Gravilliers. [3][9]
Mais dis-moi, en vérité, que vas-tu faire à Compiègne ? [10] L’on dit que le roi t’a mandé, [11] et qu’il a dessein de t’envoyer en Canada [12] apprendre de ces peuples la façon de dissimuler avec adresse, et faire passer des impostures pour des vérités ; [4][13] mais il veut que tu sois monté sur un âne, afin que ta personne, tes gazettes et ton voyage n’aient rien qui ne sente la bête. Les autres disent que c’est pour contenter l’humeur du prince de Condé, [5][14] qui désire que tu sois à la cour afin de rédiger par écrit ses plus belles actions, et le mettre au rang des conquérants, comme tu es au nombre des hommes illustres et des plus célèbres en méchanceté. À propos de ce discours, je me trouvai l’autre jour dans une compagnie où un jeune homme qui revenait d’Italie protesta que tu serais le très bienvenu à Rome, si tu voulais y aller pour enseigner aux Italiens les remèdes dont tu t’es servi pour te guérir de la vérole, [15] ou les moyens de bien empoisonner quelqu’un, [16] sachant qu’en ta personne, comme en celle de ta femme, [17] tu as excellé en ces deux secrets. Pour moi, je ne te conseille pas d’y aller, et peut-être gagneras-tu plus ici que là, pour des raisons que tu sais bien et qu’il ne faut pas dire. [6] Les âmes moins scrupuleuses croient que tu vas à Compiègne pour y apprendre quelque religion, parce que tu n’en eus jamais aucune, [18][19] et que celle des mahométans [20] t’est aussi bonne que celle des chrétiens : en effet, tu les approuves toutes et tu n’en rejettes pas une ; et tu ressembles proprement le poète Arétin qui disait du mal de tout le monde, excepté de Dieu parce qu’il ne le connaissait pas, et que même il ne voulait pas connaître. [7][21] L’on pourrait te comparer au caméléon qui reçoit toutes sortes de couleurs, mais qui ne prend jamais de blancheur : [8][22] tu connais toutes les malices, mais tu ignores l’innocence ; et de toutes les mauvaises qualités que tu possèdes, la moins banale est celle de mépriser la vertu. Les courtisans disent que tu vas à Compiègne pour composer un livre à la louange de la beauté, en faveur de mademoiselle de Beauvais, [9][23] parce qu’elle avait eu assez de complaisance pour dire un jour que si tu n’étais pas parfaitement beau, qu’au moins tu étais agréable, et que tu pouvais gagner par les charmes de ton discours ce que tu pouvais perdre par les déformités de ton visage et les puantes infections de ton nez pourri. Pausanias [24] dit qu’il y avait à Laida, ville de Grèce, une statue d’Esculape plus laide qu’un démon, qui était néanmoins respectée parce qu’elle rendait des oracles avec une voix assez harmonieuse et assez intelligible ; qui par après fut brisée par les citoyens de la même ville, à cause qu’elle avait prédit des faussetés. [10][25] Il en arrivera de même de ta personne, tu es déjà haï pour la difformité de tes yeux, de tes mœurs, de tes actions, de tes débauches infâmes, de tes saletés, de tes abominations ; tu ne manqueras pas à Compiègne d’écrire et d’annoncer mille malheurs à la ville de Paris ou au Parlement, qui n’a pas voulu rechercher ta vie, de peur qu’en la trouvant criminelle, il ne fût obligé de la mettre avec les charognes de Monfaucon. [26] Prends garde que les mensonges de ta Gazette [27] n’animent le peuple à te réduire en cendres. L’on demandait avant-hier, en compagnie de plusieurs peintres, ce que tu allais faire à Compiègne : les uns dirent que la reine [28] avait dessein de faire tirer ton portrait afin d’avoir toujours devant les yeux l’image d’un démon, pour lui ôter l’envie d’aller en enfer, où les objets sont si épouvantables que leur seule vue est capable de tourmenter les hommes et leur causer mille supplices ; les autres protestèrent que le grand maître, [29] qui sait presque tous les noms des diables et cocus, parce qu’il est connu des uns et des autres, souhaitait de savoir comment était fait celui qui tenta saint Antoine dans les déserts, [30] et que lui ayant dit que ton visage avait bien du rapport avec le sien, selon au moins que nous témoignent les tableaux qui représentèrent cette sainte histoire, sinon que tu n’avais point de cornes à la tête ; « Hé bien, répliqua le grand maître, ne faites aucune difficulté de lui en mettre, il est bien diable et cocu tout ensemble. » [11] Les autres, enfin, conclurent qu’il faisait voyage à la cour pour obliger le maréchal de Gramont, [31] qui l’a prié instamment de faire à part un volume du Mercure français [32] qui contienne l’histoire, la vie, les combats, les victoires, les mémorables actions de cet incomparable guerrier, qui gagne toujours en fuyant et qui est plus heureux au jeu qu’à la guerre. [12] Plutarque [33] dit que les princes ont été heureux, qui ont eu auprès de leurs personnes des hommes capables de décrire leurs belles actions ; Néron [34] ne pouvait rien faire que Sénèque [35] ne pût dire, et Sénèque ne pouvait rien dire que Néron, dans le commencement de son règne, ne pût aussi faire. [13] Le maréchal de Gramont a ce bonheur, il peut conquérir tout le monde, bien qu’il ne le fasse jamais, et Renaudot peut faire récit de ses prouesses, mais le plus grand miracle qu’ils puissent faire tous deux, c’est de guérir l’un de la vérole, et l’autre des gouttes. [36]
Viens-çà, vendeur de thériaque, [14][37] confesse ingénument et ne dissimule point : que vas-tu faire à la cour ? Sans doute Mazarin [38] a dessein de t’employer et te faire imprimer des arrêts contre le Parlement. Tu me diras, et il est vrai, que tu as perdu ton crédit à Paris, que ta vie y est en horreur à tout le monde, que tes impudicités y sont découvertes, tes effronteries reconnues, tes mensonges méprisés. D’ailleurs, tu sais que maintenant non seulement tu passes pour être peu versé dans les sciences, mais pour être ignorant tout à fait : deux cents esprits dont le moindre te surpasse en vertu, en doctrine, en expérience, ont écrit ces jours passés, avec autant d’admiration que d’éclat, qui ont donné au public les plus belles choses du monde et qui, par la splendeur de leur savoir éminent, ont enseveli sous les cendres d’un oubli éternel toutes tes œuvres et tes productions. Tu vois que ta Gazette ne marche plus, que le peuple, aussi bien que les curieux, sont désabusés de ces impostures. Tu veux l’aller débiter à la cour, où ta personne et tes mensonges seront toujours bien reçus tandis que Mazarin vivra. Marche, hâte-toi, on te pourrait ici couper les oreilles, après que le feu t’a brûlé le nez ! Mais prends garde ou de ne rien écrire contre le généreux duc de Beaufort, [39] ou de ne plus retourner ici, car sans doute on t’y jouerait un mauvais parti. [15] On tient pour assuré que le cardinal te demande avec instance, et il se persuade que tu lui rendras deux bons offices, il attend ce service de ta courtoisie et se promet de ta fidélité tout ce qu’il peut espérer d’un honnête homme comme tu es. Le premier sera de tant dire de bien de lui, de mander si souvent qu’il n’a autre dessein que de rendre le roi puissant et glorieux, que de rendre les peuples heureux et la France victorieuse, que de procurer une paix générale, que d’exterminer la race des monopoleurs [16][40] et d’abolir les maudites inventions qui ruinent les sujets sans enrichir le Domaine du roi ; [41] qu’à la fin, les peuples vaincus par ces fausses persuasions seront contraints de changer d’opinion, et de croire Mazarin l’auteur et l’appui de leur fortune, bien que son âme malicieuse et damnée ne médite que des vengeances et des cruautés. Ce perfide t’envoie donc quérir pour le justifier ! Mais je crois que tu auras bien de la peine à le faire, qu’un méchant ne saurait guère obliger un autre méchant, et que les peuples ne sont aucunement disposés à donner créance ni à ce que tu diras, ni à ce que fera Mazarin. Le second service qu’il prétend de vous, [17] c’est qu’étant à la cour, vous instruisiez ses nièces [42] à faire de si beaux compliments qu’elles puissent enfin par leurs discours attraper quelques princes et les obliger à les prendre pour femmes ; mais prenez garde que les dames de France qui y sont intéressées ne vous fassent danser quelque cabriole. Surtout, pour aller à Compiègne, ne vous servez pas de la monture de votre servante : [43] elle jure qu’elle est bien lasse de vous porter et qu’elle aime mieux boire au Robinet ; [18][44] elle ne vous porta l’autre jour que l’espace d’un quart d’heure dans votre imprimerie, et néanmoins elle était si fatiguée qu’elle n’en pouvait plus. Mais servez-vous de la Chaux, ce sera un âne monté sur une bête. [19]
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|
Guy Patin éditeur des Opera omnia [Œuvres complètes] d’André Du Laurens en 1628
Codes couleur
Citer cette annexe
Imprimer cette annexe
Imprimer cette annexe avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8229
(Consulté le 06/05/2024)
Parmi plusieurs éditions, françaises puis latines, de « Toutes les Œuvres » et des Opera omnia d’André i Du Laurens, [1][1] la plus remarquable pour nous est celle que Guy Patin a produite au cours de ses études de médecine et publiée à Paris en 1628. [2][2] La seule date que contienne cet ouvrage est celle du Privilège du roi, signé Lepec, à Étampes, le 28 septembre 1627, sachant que Patin a été reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris le 16 décembre suivant en présidant la thèse quodlibétaire du bachelier Georges Joudouin. [3][3]
Les pièces liminaires disséminées dans ce livre contiennent notamment deux épîtres de Patin, en tête de sa quatrième partie, [4]. Si on met à part les deux thèses qu’il a rédigées pendant ses études et un très douteux recueil de cantiques, [5][4][5] ce sont les premiers écrits à émaner de sa plume, antérieurs de deux ans à la plus ancienne lettre qu’on ait de lui (datée du 20 avril 1630). Ils présentent donc un double intérêt, littéraire et scientifique, pour un aperçu de son premier style latin et de ses idées médicales à l’aube d’une brillante carrière académique parisienne, avant les compromis auxquels elle l’a contraint.
Épître dédicatoire [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page aaa ij ro| LAT | IMG]
« Guy Patin, docteur en médecine de Paris, natif du Beauvaisis, adresse ses plus profondes salutations au très noble et très distingué Monsieur André Du Laurens, sieur de Ferrières, [6] fils unique de M. André Du Laurens, archiatre.Très distingué Monsieur, la singulière et éminente doctrine de feu Maître André Du Laurens, votre père, a tant alimenté l’admiration des hommes que sa renommée et sa gloire peu communes s’étendent jusqu’aux confins du monde habité, et que les nations étrangères envient à la France d’avoir été le lieu de sa naissance. Elles admirent et lisent les merveilles d’heureuse science dont il a empli ses livres et en tirent grand profit. À l’instar du moly d’Homère, [7] que Mercure [8] a donné à Ulysse, [9] ou de son bienfaisant népenthès envoyé par les dieux, [6][10][11] elles croient que ses brillants ouvrages contribuent au salut et au soulagement général du genre humain, et surtout de ceux qui souffrent. [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa ij} vo| LAT | IMG] Par leur richesse, il s’élève à ce degré de gloire, à ce faîte et sommet absolu en l’art de rémédier, auquel
.…………….pauci quos æquus amavit
Iuppiter, aut ardens evexit ad æthera virtus,
Diis geniti potuere. [7][12]Je dis cela en sachant bien que toutes ne les ont pas encore entièrement vues : soit parce que l’auteur en a écrit certaines parties en français ; soit parce qu’il ne les avait encore jamais publiées, ni même montrées aux siens qui, néanmoins, avec tendresse et douceur, recueillent, carressent et couvrent de baisers ce qu’il leur a été permis d’en voir. Il est toutefois légitime que le monde se plaigne de ne pas avoir la pleine disposition et jouissance des ouvrages d’un si grand homme, quand la France seule, pour l’honneur de l’avoir couvé en son sein, profite à l’envi de sa salutaire doctrine. Pour le bénéfice des nations étrangères, pour la gloire et l’embellissement personnels de l’auteur, et pour le prestige de notre pays, il m’a semblé ne pas avoir démérité en prenant la peine d’exposer à tous les regards, sous la forme d’un recueil unique, ses œuvres complètes dont les éditions avaient jusqu’ici été scindées et éparpillées. [8] J’ai aussi traduit de français en latin certains de ses opuscules, pour les rendre plus facilement accessibles à qui voudra. En outre, j’ai pris soin de mettre en lumière et de faire imprimer ceux de ses textes qui languissaient indignement dans les ténèbres. Puisque tout cela, très distingué Monsieur, est comme un héritage qui vous revient de plein droit, je vous dédie les œuvres de votre père, ou plutôt je vous les rends, et souhaite qu’elles voient le jour sous les auspices de votre très éminent nom. Il me semblait parfaitement juste de vous en prier avec insistance. Ma traduction latine des œuvres que votre père, le très brillant archiatre André Du Laurens, a écrites en français [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa iij} ro| LAT | IMG] respectent leur argumentaire, leur sens, leur raisonnement et leur plan, elles n’en diffèrent que par la diversité de langue ; tout comme sont le sang, le génie, l’ardeur et la propension aux vertus héroïques qu’un très célèbre père transmet à son très noble fils, au point presque que seuls l’âge et le métier [9] permettent de les distinguer l’un de l’autre. Nul ne peut émettre le moindre doute sur vos admirables talents s’il sait que vous êtes né d’un tel et si grand père. C’est pourquoi, afin de ne pas paraître ici pécher par excès, je cargue mes voiles et me tourne à nouveau vers vous, très distingué Monsieur, pour vous offrir de bon cœur ces opuscules. Que d’autres aient, comme on dit, l’usufruit de ce remarquable ouvrage, car la nature du savoir est telle qu’il profite à beaucoup de gens, sans ôter à celui qui en est le maître. Tirez gloire des splendides richesses dont vous êtes le seigneur et propriétaire légitime, et trouvez juste et bon le travail et les soins de celui qui, entièrement dévoué à votre famille, a déployés pour les colliger et les mettre en bon ordre.
Avis au lecteur [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa iij} vo| LAT | IMG]
« Guy Patin, docteur en médecine de Paris natif du Beauvaisis, salue le bienvellant lecteur.Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, ils ont toujours tenu pour juste que chacun doive consacrer toute sa force à faire partager à sa communauté tout fruit qui peut lui procurer profit et utilité. Je ne me suis donc ménagé aucun effort pour promouvoir l’édition de l’ouvrage que voici, en vue de rendre service aux philiatres qui étudient jour et nuit. Je me suis ainsi rendu compte que les précédentes parutions des œuvres médicales de M. André Du Laurens, jadis premier médecin du roi très-chrétien, et désormais très célèbre par toute l’Europe, sont devenues rares chez nous, et qu’une partie en est restée inédite. J’appris aussi que tous les amoureux de la médecine désiraient ardemment étudier son Anatomie et ses livres sur les Crises, [13] mais qu’en dépit de multiples impressions et réimpressions, à Lyon, Paris, Rouen, Francfort et plusieurs autres lieux, [11] ils étaient presque incapables d’en trouver des exemplaires à vendre en notre ville. Voilà pourquoi j’ai poussé nos libraires parisiens à se soucier de les remettre sous la presse et de les donner au public. En outre, son Anatomie, parue pour la première fois voilà trente-cinq ans, devait être revue et purgée des fautes qu’y avaient répandues l’ignorance et la négligence de ceux qui y avaient travaillé. [12][14][15] Pour honorer la mémoire d’un si grand homme et rendre service aux philiatres, j’ai donc voulu mettre à la disposition du public les œuvres complètes de notre très savant archiatre, après avoir pris soin de les éditer et de les regrouper, car elles sont admirables et fécondes par le sérieux de leur contenu, ce qui les rend ardemment recherchées par quantité de gens.
Plan complet de l’ouvrage [13]
J’ai attribué la première place à l’Historia Anatomica ; la deuxième au traité de Crisibus ; la troisième, au livre de Strumis ; [16] aux quatre traités, que notre auteur avait précédemment édités en français et que j’ai traduits en latin, 1. de Visus nobilitate, et eum conservandi modo, 2. de morbis Melancholicis, [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa iv} ro| LAT | IMG] eorumque curatione, [17] 3. de Catarrhorum generatione, eosque curandi ratione, [18] 4. de Senectute, eiusque salubriter tansigendæ modo, j’ai assigné la quatrième place ; puis mis à la cinquième des opuscules inédits de M. A. Du Laurens, tirés des leçons qu’il a dictées en 1587 et 1588, quand il enseignait aux chirurgiens, en la très célèbre Université de Montpellier, [19] que j’ai colligés et traduits en latin ; ces opuscules contiennent aussi trois traités, 1. de Arthritide, [20] 2. de Lepra seu Elephantiasi, [21] 3. de Lue venerea ; [22] j’y ai ajouté, en sixième lieu un court commentaire sur le livre de Galien qu’on appelle Ars parva, [23] touchant surtout à la partie sémiologique [24] de la médecine et tiré par M. Jean Aubery, [25] de Moulins, [26] disciple d’André Du Laurens, des leçons qu’il a dictées à Montpellier en 1589 et 1590 ; ce commentaire est écrit de la propre main de M. Aubery et j’y ai eu accès grâce à M. Gabriel Naudé, [27] très savant jeune Parisien qui est fort versé dans la lecture des bons auteurs, tant philosophes que médecins, et cette faveur doit lui valoir les remerciements de tous les philiatres ; [14] enfin, en septième lieu, se trouve un choix de 14 consultations médicales, [28] portant sur diverses affections et questions incertaines qui se rencontrent fréquemment en exerçant la médecine ; elles ont été recueillies par les soins zélés de M. Antoine Du Laurens, [29] avocat au Conseil privé du roi [30] et frère hautement méritant de notre très brillant auteur ; M. Aubery, [31] fils de Jean, qui est lui aussi natif de Moulins, me les avait remises afin qu’elles fussent imprimées. [15] À ces opuscules posthumes d’André Du Laurens, j’ai seulement ajouté de brèves notules pour illustrer et éclairer le sujet dont elles traitent, ainsi qu’un double index des chapitres et des faits mémorables pour te faciliter la consultation de chacun des traités. [16] Accepte sereinement, ami lecteur, le fruit de mon labeur, et puisse ta bienveillance à mon égard le défendre contre Zoïle [32] et son engeance de jaloux, ainsi que contre les morsures d’autres braillards impies et malveillants qui pourraient furieusement attaquer les mânes de notre incomparable auteur parce que sa fidèle plume a mal recopié quantité de choses parfaitement exactes et justes qui avaient été écrites avant lui ; [17] ou plus encore, parce qu’on peut trouver plus de deux mille erreurs flagrantes qui pullulent dans tous les chapitres de son Anatomie, dont la raison n’est pas seulement qu’il a divagué en écrivant, mais qu’il n’a même jamais vraiment disséqué un cadavre de ses propres mains ; ou enfin, ceux qui lui reprochent à tort et futilement de n’être pas bon grammairien, [18] et plus encore bon orateur ou bon philosophe, voire même bon médecin et bon anatomiste. Toutes ces inepties méritent à peine une réponse, tant elles sont absurdes et mensongères, comme je le démontrerai ailleurs le moment venu, si Dieu tout-puissant m’en donne occasion, Lui qui donne tout ; mais en attendant, je répliquerai à ces chicaneurs et calomniateurs [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa iv} vo| LAT | IMG] par les paroles de saint Paul au deuxième chapitre de sonÉpître aux Romains : “ Qui que tu sois, homme ! tu es inexcusable quand tu juges, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, car tu agis de même que lui en jugeant. ” [19][33] Je souhaite aussi que ces sombres et chagrins censeurs, ou plutôt ces iniques arbitres des ouvrages d’autrui, s’inspirent à l’occasion de Jules-César Scaliger, [34] ce très sage et grave prince des philosophes, quand il dit : Suam cuique laudem, laborum præmium, et relinquimus libenter, et concedimus cumulate, et deferimus liberaliter. Non ut quidam ignavi atque ingrati audent facere, ut alienis laboribus titulos imponant suos : tum gratiam quam debent, dissimulant superciliosi, aut eius abolent memoriam maleficiis, ne sui nominis propriæque fortunæ auctoribus quidpiam debuisse videantur. Ceterum novi isti homines, novi causarum iudices, conscientiam pro accusatore, pro iudice habituri sunt posteritatem, etc. ; [20] ce que notre Du Laurens peut dire avec vérité à son propre sujet. Nostrorum monimentorum vita, illorum nominis mors futura est. Studio atque magnanimite parandum, servandumque est regnum literarum, cuius anima Virtus, et Veritas est : non ambitionibus atque factionibus exercendæ coniurationes, etc. [20] Pareillement, je voudrais m’acquitter de ces Zoïle en citant ce propos de Sénèque : Non est quod tardiores faciat ad bene merendum turba ingratorum. Quam multi in-
digni luce sunt ? et tamen dies oritur ? [21][35] Peut-être aboieront-ils aussi après moi, pour n’avoir pas toujours été aussi fidèle que je devais, ou pour paraître avoir mis en latin quantité de phrases avec moins d’élégance et d’ornement qu’il y fallait ; mais je voudrais que ces Zoïle sachent de moi que :Ornari res ipsa negat, contenta doceri. [22][36]Je m’y suis pris sciemment et sagement ; j’y aurais mis plus d’élégance et emprunté un vocabulaire plus riche si j’avais préféré ma réputation à l’intérêt public et à la traduction fidèle des propos de Du Laurens. Que se récrient et se déchaînent donc ceux que je vois être nés pour blâmer le travail des autres, plutôt que pour exceller dans le leur, et pour qui
…………………….non Siculæ dapes
Dulcem elaborabunt saporem ! [23][37]De fait, ils méprisent tout, et prétendent avoir sous la main du bien meilleur ouvrage s’ils voulaient se donner la peine de le publier : qu’ils le publient donc avec ma permission, ou
…………………..rabie iecur incendente ferantur
Præcipites. [24][38]Je n’ai cure de leurs sarcasmes, je ne crains pas leurs railleries, [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaa v} ro| LAT | IMG] je serais bien plus marri de n’avoir pas été utile à une seule personne bienveillante et désireuse de s’instruire, que d’avoir vainement mis ce bienfait, dont ont accouché mon labeur et mes veilles, entre les mains de mille individus jaloux et orgueilleux. Je te prie donc, bienveillant lecteur, de trouver bon tout ce que j’ai fait et de le recevoir avec amitié, pour que cela te procure agrément et utilité. Quemadmodum enim nullum est tam plenum beneficium, quod non vellicare malignitas possit, ita etiam plenum angustum, quod non bonus interpres extendat. [25] Je ne doute pas que d’honnêtes gens n’accordent si peu que ce soit leurs faveurs à notre labeur, et que ceux à qui il pourra paraître moins estimable lui pardonnent d’eux-mêmes ses imperfections, car plaire à tout le monde a-t-il jamais été accordé à quiconque sous notre Soleil ? Je ne voudrais pas non plus que tu penses que j’aie œuvré par vaine ostentation, comme tant d’auteurs en ont coutume : je l’ai fait pour l’avantage du public et j’ai mis ce livre au jour dans l’idée que, si tu as le bonheur de comprendre son contenu et s’il reçoit ton approbation, j’accepterai désormais de toujours me consacrer à de plus grandes tâches qui seront utiles au public. Vale, ami lecteur et ne cesse pas d’aimer ton cher Patin. »
Épigrammes
Quatre poèmes latins, parsemés dans l’ouvrage, ont Guy Patin pour auteur ou pour dédicataire.
[Laurentii Opera omnia, 1re partie, page {ĩ ij} vo| IMG] Dans les pièces liminaires de l’Anatomie : [26]
In D. Andreæ Laurentii,
Archiatrorum Comitis, et Anatomicorum
omnium quotquot sint et fuerint,
Pimicerij et Antistitis com-
mendationem
epigramma.Fallopium Patavina colit ; Romana Columbum ;
Germana Albertum ; Flandria Vesalium ;
Bauhinum Basilea ; suum Veneti Parisanum ;
Bœtica Valverdam tollit ad astra suum :
Pauuium haben Batavi ; stat Sylvius in Parisina ;
At te, Laurenti, Gallia tota tenet.Guido Patinus, Bellovacus,
Doctor medicus Parisiensis.[En recommandation de Me André Du Laurens, comte des archiatres, chef et champion de tous les anatomistes présents et à venir.
Padoue honore Fallope ; [39] Rome, Colombo ; [40] l’Allemagne, Alberti ; [41] la Flandre, Vésale ; [42] Bâle, Bauhin ; [43] Venise, son cher Parisano ; [44] l’Espagne porte son Valverda [45] aux nues ; les Bataves ont Pavius ; [46] Sylvius [47] trône à Paris ; mais c’est toi, Du Laurens, que la France tout entière reconnaît pour sien. [27]
Guy Patin natif du Beauvaisis,
docteur de médecine de Paris].- [Laurentii Opera omnia, 3e partie, page {Aa iij v} vo| IMG] Dans les pièces liminaires des deux livres sur les écrouelles : [28]
In
Clariss. Celeberrimique Viri
D. Andr. Laurentii Archiatri
Tractatum de Strumis.Dum Christianus et potens Rex Galliæ
Tangente Strumas sanat acres dexterâ,
Summus Dynastes audit, et Asclepius :
Miranda sed dum Regis hæc Laurentius
Sermone docto prodit, et ortam polis
Aperire cunctis nititur potentiam,
Dubium relinquit, sitne Rex illustrior
Isto libello, sit vel ipse illustrior.Guido Patin, Bellovacus,
Medicus Parisiensis.[Sur le Traité des Écrouelles du très brillant et célèbre archiatre, M. André Du Laurens.
Quand le puissant et chrétien roi de France guérit les âcres écrouelles en les touchant de sa main salutaire, le Très-Haut l’exauce, comme le fait Esculape ; [48] mais quand un savant discours de Du Laurens expose ces miracles et s’efforce de révéler à la Terre entière le pouvoir inné du roi, il reste à se demander si le roi est plus illustre ou s’il est plus savant que ce petit livre.
- [Laurentii Opera omnia, 4e partie, page {aaaa v} ro| IMG] Dans les pièces liminaires des quatre traités : [30]
In Clariss. Viri
D. Patini Commendationem,
quod hæc D. Andreæ Laurentii
Opuscula Latinitate donaverit.Plurima Laurenti, ibi se debere fatetur
At quod in extremas celebris perveneris oras,
Quod peregrina tuam natio sensit opem.
Hoc assertori debes, mihi crede Patino,
Hoc velut auctori gens fere tota refert.I.D.N. Philosophiæ Professor
in Academia Parisiensi.[Recommandation en faveur du très distingué M. Patin, pour avoir traduit en latin ces opuscules de M. André Du Laurens.
La France, ô Du Laurens, reconnaît te devoir beaucoup car elle a la pleine jouissance de tes livres ; mais ta célébrité doit atteindre les contrées les plus lointaines, et toute nation étrangère comprendre tes œuvres. Crois-moi, tu dois cela à Patin, ton défenseur, dont presque tout le monde dit qu’il en est comme ton recréateur.
I.D.N. professeur de philosophie en l’Université de Paris]. [31][50]
- [Laurentii Opera omnia, 5e partie, page {aaaa iv} ro| IMG] Dans les pièces limaires des trois opuscules : [32]
V.C.D. Dom. Patino,
in Parisiensi Facultate
Doctori Medico, quod hæc
D. Laurentii Opuscula primus
omnium Latinitate donaverit.Morborum solitos cohibere medendo furorem,
Et Phlegethontæo naulos subducere Nautæ
Latonâ genitum, Téque, ô Caducifer Hermes,
Numina fecerunt veteres, cælóque locarunt.
Quod debet, Patine, tibi gens Gallica nomen,
Qui tristi revocas mandata cadavera busto ?
Nam dum Laurenti<i> voces facis esse Latinas,
Dans operi lucem, dans vitam luminis orbo,
Sola voce facis quod Dij potuêre medendo.Hoc veriss. virtutis encomium de se bene merito,
in primaria Galliarum civitate canebat,
Iul. Pilet Mesnard.,
Nannetensis 1627.[Au très distingué Maître Patin, docteur de la Faculté de médecine de Paris, pour avoir été le premier de tous à traduire en latin ces Opuscules de Du Laurens.
[Ô Hermès, porteur du caducée, [33][51] les antiques divinités t’ont façonné et placé au ciel, avec le fils de Latone, [34][52][53] qui dérobe ses cargaisons au Nautonier du Phlégéthon, [35][54][55] et avec ceux qui ont pour métier de contenir la fureur des maladie. À toi, Patin, le peuple de France ne doit-il pas une part de son renom quand tu ranimes des cadavres qu’a réclamés le triste tombeau ? En tournant en latin les mots de Du Laurens, tu éclaires un ouvrage orphelin, tu lui donnes la vie de la lumière, et par ta seule voix, tu égales le pouvoir des dieux à remédier.
Jules Pilet de La Mesnardière, natif du Pays nantais, a composé cet éloge que mérite bien la plus authentique vertu, en la capitale de France l’an 1627]. [36][56]
Scolies de Patin sur les traités de Du Laurens
Patin a enrichi ses versions latines de huit scolies [scholiæ, commentaires]. Celle qui m’a le plus intéressé suit le chapitre ii du traité de Lue Venerea. [37]
[Laurentii Opera omnia, 5e partie, page 63| LAT | IMG]
« Dénomination variable du mal vénérien en diverses nations. Je voudrais que les médecins parlassent du mal vénérien et de son traitement sans faire injure à tel ou tel pays. Beaucoup d’entre eux ont pourtant agi de la sorte dès l’éclosion de cette épidémie, en s’en prenant à ceux qu’ils pensaient à tort ou à raison les en avoir offensés, mais sans connaître son origine, sa cause et sa nature : de là vient que les uns l’appellent mal espagnol, d’autres italien et d’autres encore français, comme font les Italiens. [57] Outre ce nom de mal français que les Italiens lui ont donné, on a qualifié son remède d’italien ou de napolitain, comme l’unguentum Neapolitanum et l’opiata Neapolitana, et souvent d’indien, comme le lignum Indicum, [38][58][59][60] car la maladie a primitivement été amenée des Indes en Italie par les Espagnols ; et de là, en revenant chez eux après avoir pris Naples, les Français ont rapporté ce fruit napolitain ; mais que cela soit plutôt dit pour rire que pour mordre ! [39]Une épidémie indienne apportée par les Italiens. [13][61]
Nul n’ignore que le mal vénérien est une maladie nouvelle : jamais on ne l’avait vue en Europe avant l’an 1453 < sic > ; [40] mais elle y a été apportée pour la première fois par Christophe Colomb et ses associés ou serviteurs italiens à leur retour d’Inde, [41][62][63] et elle a été transmise aux femmes italiennes ; lesquelles, durant le siège de Naples, [42] en faisant leurs affaires avec les soldats français, leur ont à la fois cédé leurs parties honteuses et leur maladie honteuse. Une fois la ville prise, les Français revenant de guerre, ont donné la vérole à grand nombre d’autres Italiennes qu’ils ont rencontrées en chemin. Leurs maris, en remplissant avec elles leur devoir conjugal, ont reçu de leurs épouses ce qu’elle avaient reçu des Français, comme les Français l’avaient reçu d’autres Italiennes, qui l’avaient elles-mêmes reçu des compagnons d’armes de Christophe Colomb.De là vient que les Italiens, outrés et irrités contre les Français, pour les punir, donnent à leur propre maladie le nom de mal français. Ils disent que nos livres font étalage de ridicule vengeance quand on y blâme la naïveté des maris et la prostitution de leurs femmes : ceux-ci pour avoir ignoré l’origine de la vérole, et celles-là pour avoir désiré être culbutées par les Français.
Ridicule erreur de Brasavola. [13]
Brasavola, [64] se souvenant peut-être de cette insulte proférée contre ses ancêtres, a écrit un opuscule sur le mal de son pays, qu’il appelle français, [Laurentii Opera omnia, 5e partie, page 64| LAT | IMG] et dont il distingue 234 variétés différentes. [43] Si ce bonhomme n’a pas semblé perdre la tête en cet endroit, je tiens pour certain que, quand le mal a fait sa première apparition en Italie, les soldats français ont violé tant de ses parentes ou voisines que, pour perpétuer la trace de ces accouplements, il a laissé ces hiéroglyphes à la postérité ; [44] mais que cela soit dit en passant, sans faire injure à cette nation qui nourrit de très éminents personnages. ” Jean de Renou, médecin de Paris, a écrit tout cela en divers endroits de son antidotaire. [45][65] On y trouve aussi un élégant et plaisant, mais énigmatique hexastique composé par de Serres, [66] médecin de Lyon, sur la douteuse origine du mal vénérien :India me novit ;
iucunda Neapolis ornat ;
Bœtica concelebrat ;
Gallia ; mundus alit.
Indi, Itali, Hispani, Galli, vosque orbis alumni,
Deprecor ergo, mihi dicite quæ patria ? [46]Qui voudra en savoir plus sur l’origine de ce mal, lira Forestus, au 32e livre de ses Observationes et curationes medicinales, dans ses scolies sur l’observation i, [47][67] et Fallope, au chapitre 2 du traité qu’il y a spécialement consacré. » [48][68][69]
Aplomb d’un docteur régent frais émoulu de la Faculté de médecine de Paris
Âgé de 27 ans et tout juste coiffé du bonnet doctoral, Patin mettait au jour cet épais volume de doctrine médicale, principalement consacrée à l’anatomie, avec l’ambition d’en faire le premer recueil latin complet des œuvres de Du Laurens, gloire de l’Université de Montpellier.
Quant à la forme, son travail n’incite guère à s’ébahir :
- sans doute faute du privilège requis, l’Anatomie n’est pas illustrée, défaut majeur que ne compense pas l’opulent frontispice ; [49]
- les textes latins de Patin (épîtres, traductions et scolies), dont j’ai fourni de longs échantillons, font sentir en maints endroits une plume encore mal maîtrisée ; redites et tournures maladroites lui donnent un tour hâtif et mal relu, et en tout cas bien éloigné de celui qu’on verra briller plus tard ; [50]
- son extraordinaire bibliomanie commençait à poindre ; [70] ses emprunts aux autres auteurs sont nombreux et ordinairement référencés, exception faite des classiques de l’Antiquité païenne que tout lecteur était censé connaître par cœur ;
- son tempérament vif et querelleur jaillit dans l’Avis au lecteur quand il anticipe les attaques des Zoïle [51] contre ses laborieux efforts, mais cela est fort banal pour qui a l’habitude de ce genre de prose ;
- la pétulance et l’originalité auxquelles Patin doit son renom littéraire ne reluisent guère dans ces textes qui inauguraient sa carrière. [52]
Quant au fond, hormis ses vers sur les anatomistes de renom, [27] notre jeune docteur régent ne montrait aucune audace en éditant un auteur didactique qui respectait les canons du dogmatisme hippocratico-galénique : [71] je n’y ai lu ni découverte anatomique renversante, ni référence périlleuse aux remèdes chimiques, à l’exception du mercure dans la vérole, que nul ne contestait plus alors, mais sans mention de l’antimoine. [72] Mise à part la biographie contestée de Du Laurens que Patin a relatée, [53] il l’a toujours tenu pour le plus brillant des docteurs de de Montpellier, en dépit des ouragans que la rivalité de cette Université avec la Faculté de Paris a plus tard soulevés.
Rien, à ma connaissance, ne permet de dire sûrement pourquoi Patin s’est précipité dans cette édition dont les mérites ne furent guère reconnus, si on en juge sur l’absence de toute réimpression de son ouvrage. [54] Elle ne fut pas accompagnée de patronages bien solides :
- on n’y voit pas l’ombre d’une approbation que la Faculté de médecine de Paris (dont le doyen était alors Nicolas Piètre) [73] attribuait ordinairement à ses docteurs régents ; [55]
- aucun des maîtres les plus vénérés de Patin, le susdit Piètre, René Moreau, [74] Philibert Guybert, [75] Jean ii Riolan [76] ou Nicolas Bourbon le Jeune, [77] n’a gratifié son livre d’une dédicace, pas plus que ne firent ceux qu’il tenait pour ses amis les plus chers, comme Gabriel Naudé ou Charles Guillemeau ; [78] seuls Jean de Nully, son camarade d’école à Beauvais, et le tout jeune Hippolyte-Jules Pilet, qui n’ont occupé qu’une modeste place dans la correspondance ultérieure de Patin, l’ont honoré de quelques vers.
Patin semble donc bien avoir agi de sa propre initiative, sans soutien académique, dans le vain espoir de briller et de marquer avec éclat son entrée dans la prestigieuse Compagnie des docteurs de Paris, après les rudes années de chétive existence que la brouille avec ses parents lui avait values. L’auteur qu’il avait choisi, très fameux premier médecin de Henri iv, et la dédicace à son fils, Antoine ii Du Laurens, pourraient trahir des ambitions médicales à la cour. [56][79] Ce ne fut qu’un coup d’épée dans l’eau dont Patin lui-même n’a tiré aucune gloire dans la copieuse suite de ses écrits. Un prudent oubli fut la seule conséquence avérée de sa témérité, sans doute mêlée de rancœur et d’ingratitude. Patin sut néanmoins se faire pardonner ce pas de clerc et parvint à retrouver les bonnes grâces de Riolan ; [57] et en dépit de ce premier essai peu concluant, il a sa vie durant contribué à mettre au jour les ouvrages d’auteurs qu’il admirait. [58]
|
|
"Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |

|
Une réalisation
de la BIU Santé |

|